
[Télécharger le PDF de l’article du catalogue]
Voir aussi sur le site de l’APRES : “Pourquoi l’homme approximatif ?”

[Télécharger le PDF de l’article du catalogue]
Voir aussi sur le site de l’APRES : “Pourquoi l’homme approximatif ?”
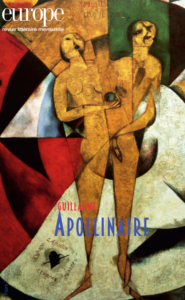
Mensuelle, Europe ne fut pas toujours, comme aujourd’hui, une revue littéraire. S’occupant de culture et d’idées politiques, on conçoit que les noms des écrivains et des poètes n’y figurent pas en permanence, et qu’elle ne se soit pas préoccupée d’établir un classement des valeurs littéraires dès son apparition, en 1923. D’autant plus que, tournée vers l’Europe et, pour ainsi dire, le monde entier, les Français ne devaient absolument pas occuper le devant de la scène. Fondée par des anciens du groupe de l’Abbaye et des amis de Romain Rolland, elle était plus préoccupée de revendication et de justice sociale que d’avant-garde. Néanmoins, elle ne pratiquait pas d’ostracisme envers l’avant-garde contemporaine, qu’elle regardait d’un œil souvent amusé, parfois horrifié, en attendant le moment où, une fois leur gourme jetée, ces jeunes, tel Philippe Soupault, viendraient la rejoindre. N’oublions pas que son premier numéro publiait un inédit du comte de Gobineau !
S’adressant à un public que l’on peut qualifier globalement « de gauche », sans risque d’être démenti, composé d’instituteurs, d’autodidactes, mais aussi de cadres, d’ouvriers organisés, de lecteurs éclairés qui ne demandaient qu’à l’être davantage, elle se devait de lui apporter des éléments d’information et de réflexion, lui découvrant de larges perspectives vers des cultures étrangères et dressant d’indispensables panoramas sur l’histoire des idées, des influences réciproques, d’un pays à l’autre, des esthétiques à l’œuvre ici et là. À ses débuts, la publication de textes étrangers contribua vivement à sa diffusion. Si bien qu’au bout d’une centaine d’années d’existence, elle occupe une place notable dans le champ culturel français. Qu’elle le veuille ou non, elle a procédé à un classement des valeurs et elle contribue, aujourd’hui encore, à la « panthéonisation » de certains auteurs, tant étrangers que français, et à leur divulgation en France, notamment à travers ses numéros spéciaux. À tel point que ceux-ci sont devenus la norme.
Pour vérifier chacune des assertions précédentes, nous disposons d’un outil incomparable, que bien des chercheurs nous envient. Cette source exhaustive, c’est le DVD de la revue, en texte intégral, reproduisant à l’identique toute la collection des livraisons de 1923 à l’an 2000, en mode image et en mode texte par conséquent. Un spécialiste de la mesure lexicale (lexicométrie), Étienne Brunet, l’a ainsi caractérisé : « de 1923 à 2000 il y a 860 numéros, compte tenu d’une suspension entre 1939 et 1945. Cela fait 13 mètres de rayons dans une bibliothèque, ou, si l’on compte en unités plus petites, 7 500 auteurs différents, 28 000 articles, 140 000 pages et 58 millions de mots. On se rapproche des sommets gigantesques de l’Encyclopaedia Universalis (6 025 auteurs, 30 000 articles, 52 millions de mots), et du Grand Larousse du XIXe siècle (90 millions de mots). »
Ainsi, l’amateur d’Apollinaire s’assure immédiatement que le nom du poète y apparait 3 224 fois, ce qui en fait l’un des plus fréquents dans l’ensemble indiqué, bien après Romain Rolland, cela va de soi, mais bien avant tous ses contemporains (il faudrait aussi tenir compte de la trentaine d’apparitions du dérivé apollinarien). C’est pourquoi le titre de cet article s’est imposé à moi, mathématiquement, si je puis dire. Apollinaire est un champion d’Europe par sa présence sous la plume des rédacteurs, par son aura chez les lecteurs, et peut-être, implicitement, parce qu’il n’a pas dédaigné, de son vivant, l’idée européenne, lui que la biographie montre européen avant tout, lui qui vécut « À travers l’Europe vêtue de feux multicolores ».
Surpris de l’étonnante réception critique du poète par la revue Europe, j’établirai la place qu’il occupe dans les 860 numéros considérés, j’analyserai ensuite les œuvres saillantes de son répertoire, pour, enfin, m’attarder sur l’image que les collaborateurs de la revue donnèrent de lui.
***
En quoi Apollinaire est-il le champion d’Europe ? Eh bien, tout simplement, parce qu’il est l’auteur le plus fréquemment nommé des membres de sa génération. J’appellerai génération d’Apollinaire, au sens que Thibaudet donnait à ce terme dans son Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, tous les auteurs nés entre cinq ans avant, et jusqu’à cinq ans après lui. Voici, dans l’ordre des fréquences décroissantes, le relief que donne, aux dix premiers, le corpus considéré (c’est-à-dire toutes les livraisons de la revue de 1923 à 2000) : Apollinaire = 3 224 occ., Max Jacob = 2 524, Jules Romains = 1 464, Giraudoux = 1 368, Ramuz = 1 349, Raymond Roussel = 1 171, Victor Segalen = 842, François Mauriac = 823, Valery Larbaud = 817, Jules Supervielle = 724… Ce qui signifie, si l’on s’en tenait à ces seules fréquences, qu’il faudrait consacrer un numéro à Jules Romains, à Giraudoux et à Ramuz, après l’avoir fait pour Max Jacob et Apollinaire.
Quoi qu’on puisse penser des comptages, ce classement donne une image remarquable de la considération que la revue porte à certains écrivains de cette génération, tel Jacques Chardonne, tant prisé par un ancien Président de la République, ou bien le Paul Géraldy de Toi et moi (recueil qui figurait dans toutes les bibliothèques des familles) avec un score de 18 occurrences. Pour divers que soient ces contemporains, aucun n’est aussi considérable et considéré qu’Apollinaire, le fait est évident.
Le second, Max Jacob, que l’on peut tenir pour son frère d’armes, en dépit des variations de leur amitié, épouse une courbe de fréquence tout à fait parallèle à celle d’Apollinaire, à cette différence près que le dossier Jacob précède de neuf ans celui que la revue a consacré à Apollinaire, et qu’il est plus fortement question du premier en 1949, en raison des nombreux articles évoquant son destin tragique.
Mais, dira-t-on avec raison, de tels scores doivent toujours être relativisés. Ainsi, Romain Rolland, champion toutes catégories, apparait-il 6 671 fois, en incluant un numéro spécial (n° 109-110, 1955) consacré à ce père tutélaire. On notera avec curiosité la fréquence accordée à un Claudel, à qui fut dédié un dossier en 1982, soit 2 242 occ., Gide n’atteignant que 2 183 occ. et Péguy, 1 836, à peine plus que Jarry son « conscrit », né la même année que lui, soit 1 696 occ.
Plus jeunes que lui, ses voisins les plus proches ne lui font aucune ombre. Cendrars n’a que 1 975 occ. (tout en y incluant un dossier en 1976) ; Reverdy seulement 1 182 occ. en dépit d’un numéro double en 1994 ; sans parler du dévoué André Salmon (191 occ.), non plus que de Pierre Albert-Birot, injustement moqué par ses contemporains, les surréalistes.
On notera, au passage, que le fait de consacrer un numéro à un écrivain accroît systématiquement sa fréquence dans la revue d’un millier d’occurrences.
***
Ainsi, notre poète occupe bien la première place dans sa génération et même au-delà. La haute fréquence de son nom ne signifie pas qu’il apparaisse dans la revue d’une façon également répartie dans les 218 articles où il est nommé, de 1923 à l’an 2000. La statistique année par année (qu’un graphique traduirait plus éloquemment), montre des pics de fréquence en 1953, 1958, 1966, 1970, 1982, etc. Il va de soi que la haute fréquence de 1 100 occ. en 1966 correspond, comme indiqué précédemment, à la livraison entièrement consacrée au poète. Inversement, il y a des années totalement creuses, où il n’est jamais nommé (en 1928, 1929, 1930, 19332, 1934…). D’autres où il l’est à peine : 4 fois en 1949, 9 fois en 1965, l’année-même qui précède le numéro dédié à son œuvre !
Pour résumer cette prise de vue chronologique, disons qu’il est nommé 62 fois dans la période d’avant-guerre (1923-1939), dont 29 fois en 1924, essentiellement dans la chronique que René Lalou lui consacre, pour le cinquième anniversaire de sa mort. Chronique mitigée, sans réserve pour le poète d’Alcools, très critique envers le théoricien de « l’Esprit Nouveau » !
Il est nommé 1 748 fois dans la période 1946-1968, majoritairement dans le n° 451-52 de 1966, déjà signalé, auquel je consacrerai un examen particulier ci-après.
À la reprise de la revue, après de si dures épreuves nationales, nul ne s’étonnera de voir Aragon parler d’Apollinaire conjointement avec Max Jacob au sujet du poème en prose dans ses « Chroniques du Bel-Canto » (avril 1946, p. 106) et Claude Roy dresser en 1948 un panorama des livres récemment parus d’André Rouveyre, Louise Faure-Favier, André Billy, Aegerter et Labracherie, à la recherche d’un « lyrisme du discontinu » parfois capté par Apollinaire.
Poursuivant ce décompte, je relève qu’entre 1969 et 1984, il y a 1 031 occ. de ce nom choisi, dont 278 en 1970 et 222 en 1982, surtout dans le numéro de juin-juillet, tranchant de « Cubisme et littérature ».
À noter un net recul pour la dernière période : de 1985 à 2000 inclus, il n’y a que 383 occurrences du patronyme, dont 67 en 1993 et 57 en 1997, ce qui est tout de même six fois plus que durant l’avant-guerre !
Soit, dira-t-on, Apollinaire est fort souvent nommé dans votre revue. Mais cette haute fréquence ne dit pas si c’est en bien ou en mal, pour le louer ou pour en médire !
Je regrette de ne pouvoir reproduire ici, comme on fait dans les études bibliques, un tableau de la totalité des « concordances » (index alphabétique, ligne par ligne, des 3 224 apparitions du patronyme Apollinaire, avec sa localisation dans la collection complète de la revue) afin d’en dégager, d’un seul coup d’œil, la valeur (positive ou négative) et l’usage. Malgré la gageure, je me hasarderai toutefois à montrer, à titre d’exemple, ce qu’on pourrait lire pour la première période (1923-1939), avec un tri à la gauche du mot vedette :
2910329e| s de Strawinsky , de Picasso , d’ Apollinaire ? Plutôt faubourg Saint –
3523999d| in des coups d’ oeil complices d’ Apollinaire , de ses sous – entendus ,
3523997b| nous nous arrêtions aux images d’ Apollinaire : Ta langue poisson roug
3523996h| emblait très fort à ces images d’ Apollinaire à la boue près , à la merd
3827779i| jours été . Les grandes ombres d’ Apollinaire et de Reverdy y planent pa
3727080a| souvent les poèmes de Fagus ou d’ Apollinaire : c’ est une mélodie d’ un
3727046b| ses communicants , à la poésie d’ Apollinaire et de Fargues . Mais depui
3930025a| Manuel poétique d’ Apollinaire , par Jeanine MOULIN ( Les
3829048e| ne note curieuse sur le Séjour d’ Apollinaire en Rhénanie , par E . – M
2910616e| piration font de lui une sorte d’ Apollinaire italien . En dehors de ses
3930350e| ci : notez au passage des vers d’ Apollinaire de Montherlant , de Reverd
3523996i| ne . Et j’ ai pourtant à dire qu’ Apollinaire mentait , parce que dans l
3115404f| isation , quand ils demandèrent à Apollinaire clé graver à la Sorbonne L
3828781i| t avec ceux gui , de Dioseoride à Apollinaire , ont fait servir la litté
242286a| s la dédicace de l’ Hérésiarque , Apollinaire donnait ses contes pour «
264720j| oux , Morand , Larbaud , Proust , Apollinaire … Bref , ni chronologie ré
241885c| ition , vrai Baedeker universel , Apollinaire était un esprit essentiell
277679g| vention du ressort et du détail . Apollinaire a accroché là , à de modes
242284d| une époque féconde en doutes . Apollinaire nous propose une oeuvre ,
241885b| un véritable « esprit nouveau » ? Apollinaire , qui a tant chéri la myst
241885i| autre , c’ est en grande partie à Apollinaire qu’ on le doit . A lui , e
242285f| nébuleuses … Or c’ est un autre Apollinaire qu’ on nous somme d’ admir
242284g| t richesse profonde . Il y a chez Apollinaire une incontestable virtuosi
241885e| térature européenne . J’ ai connu Apollinaire à ses débuts . C’ était al
242284c| e la piété qui pousse les amis d’ Apollinaire à lui apporter leur témoig
265730b| lant , baptisé du nom chrétien d’ Apollinaire , ceci , votre portrait en
231502a| CHRONIQUES 497 au « côté d’ Apollinaire » ; des survivants de l’ è
242286h| prit nouveau » ! Tout le drame d’ Apollinaire est là . Le poème final de
242285h| qui vient , dans l’ esthétique d’ Apollinaire , d’ un Picasso et d’ un B
242284d| alaisée . L’ origine étrangère d’ Apollinaire entre ici en ligne de comp
299987d| mour de Picasso , l’ imitation d’ Apollinaire doivent empêcher M . Cocte
242284b| Duhamel définissait l’ oeuvre d’ Apollinaire « une boutique de brocante
242287a| , qu’ elle recouvre les singes d’ Apollinaire ! A lui , nous devons – mi
253301j| dont , depuis . Mallarmé , depuis Apollinaire , il court , chez les poèt
242285b| e des poèmes – conversations dont Apollinaire fut l’ inventeur . Et nous
242284a| es paroles graves : ils ont égalé Apollinaire à Rimbaud . Cependant pers
242284a| GUILLAUME APOLLINAIRE Le cinquième anniversaire
241885b| et , faire un maître de Guillaume Apollinaire ? Et n’ a – t – on pas été
242284a| iversaire de la mort de Guillaume Apollinaire a provoqué des manifestati
299969j| de Maurice Scève ou de Guillaume Apollinaire au moment – du pourboire .
242286e| ent un infranchissable intervalle Apollinaire rêva d’ être un enchanteur
242286f| e bel Amicitioe sacrum qu’ est l’ Apollinaire Vivant d’ André Billy , il
242531c| ines publiées dans le Mercure par Apollinaire . Il ne faudrait pas , e
242285j| stériles imitateurs . Reste pour Apollinaire – l’ honneur d’ avoir invo
242285i| nomme le cubisme littéraire , si Apollinaire en fut l’ instigateur , el
242285e| abilement Villon et Verlaine . Si Apollinaire tenait tout entier dans le
242285h| nie de cet étonnant jongleur ; si Apollinaire avait vraiment le sens de
242285c| oque qui obscurcit tout débat sur Apollinaire . Ses dévots en sont respo
3320214a| ARTS ) . Vers 1910 , Guillaume Apollinaire et quelques poètes découvr
3829056c| gate l’ image fidèle de Guillaume Apollinaire , « la cétoine au coeur de
3727077d| est dans les poèmes de Guillaume Apollinaire que les échos des ancienne
3523996a| t au destin surprenant Guillaume Apollinaire était , au temps où j’ ava
3930190d| hique du pont Mirabeau dont parle Apollinaire , l’ héliotrope d’ Arthur
3726774a| Après avoir publié sur Apollinaire , Max Jacob , Mallarmé , d
3523998b| e officiel qu’ ambitionnait jadis Apollinaire , Marinetti déclare dans L
3523996e| TT RATURE 475 fruit défendu . Et Apollinaire nous apparaissait , derriè
2910364a| es vers oscillent entre Moréas et Apollinaire , préconise dans son roman
3930163d| époque de Braque et de Picasso et Apollinaire va mourir . Il y a Max Jac
3523996f| a guerre est jolie Mais pourtant Apollinaire pratiquait avec une habile
2910527g| t – on pas une métaphysique chez Apollinaire qui n’ en parle pas ? Et ,
À noter que, sur la machine, un simple clic me renvoie au contexte intégral, ce qui me permet de constater que le « nom chrétien d’Apollinaire » fait partie d’un récit d’Isaac Babel, et ne nous concerne pas ici (il y a 9 occ. du prénom Sidoine, et le fait qu’il soit compté dans la fréquence totale n’a guère d’incidence sur un grand ensemble de 3224 occ.). Un examen superficiel du tableau montre que le poète est, d’emblée, désigné par son patronyme seul, sans prénom, signe incontestable de notoriété. Poussant plus loin, on relèvera les noms les plus proches d’Apollinaire, et les termes qui l’accompagnent le plus fréquemment : images, esthétique, poétique… La vertu de tels outils n’est, heureusement, plus à démontrer (encore que peu nombreux soient ceux qui s’en servent). Dans le souci de situer Apollinaire parmi les préoccupations des collaborateurs de la revue Europe, je m’attarderai plus précisément sur les diverses catégories de textes le nommant.
***
La première, la plus évidente, est celle des documents qui portent la signature du défunt. Elle se trouve dans trois fac-similés autographes, insérés dans le numéro spécial de 1966, puis au bas du manifeste L’Antitradition futuriste, imprimé reproduit selon la même technique en mars 1975. Dans tous les cas, ce sont des documents rares, des manuscrits de poèmes (« Apothéose », fragment – Coll. Chobot ; « Exercice » – à G. Turpin. Coll. Adéma), ou une lettre (Carte-lettre de mars 1916, Coll. Madeleine Pagès) confiés par Jacqueline Apollinaire, André Salmon, Pierre-Albert Birot, et surtout son biographe-collectionneur, Pierre-Marcel Adéma, qui avait largement ouvert ses archives. Sous une couverture reproduisant une aquarelle de Max Jacob, l’illustration de ce n° 451-52 est d’autant plus remarquable qu’avant les années 2000 la revue ne comportait guère d’illustrations. C’est dire le prix qu’on attachait à l’écriture même du poète, sans parler de la qualité des documents inédits, montrés au lecteur pour la première fois.
Viennent ensuite les études et les articles, de ce premier dossier consacré à l’Enchanteur lui-même, qui fit réellement date : il coïncidait avec le programme des agrégations de Lettres, et beaucoup s’en souviennent encore.
La structure des numéros spéciaux de la revue imposait, à l’époque, une présentation par son responsable éditorial, une situation de l’écrivain dans son époque et une chronologie. Cette livraison ne déroge pas à la règle, avec une introduction de Pierre Gamarra qui, de retour de Géorgie, dresse, sous le titre « De faïence et d’escarboucle », un curieux parallèle entre Apollinaire et le huitième centenaire du poète national Roustaveli, auteur d’un poème de 7 000 vers, Le Chevalier à la peau de tigre, dont le peuple est capable de réciter spontanément de longues laisses (Gamarra m’a lui-même récité, sinon la totalité de La Légende des siècles, du moins Le Petit roi de Galice de Victor Hugo, en y mettant le ton et la respiration ; il eût été capable de faire de même pour ce chevalier-là, si on lui en avait donné le temps). Ce qui le conduit à réfléchir sur la notion de popularité, qui caractérise désormais Apollinaire, et sur le mélange de classicisme et d’anticipation, formule même de la modernité. La « Couleur du temps », brossée à grands traits par Maurice Bouvier-Ajame, ne manque pas d’être utile à ceux qui ne croient pas que la poésie sort tout habillée du cerveau de l’artiste. Enfin la chronologie, établie par Michel Décaudin, remet les pendules à l’heure, sur bien des points controversés.
Dans le cadre de ce dénombrement, il serait impertinent d’examiner chaque contribution par le détail. Qu’on me permette de reproduire le sommaire, tel qu’il se présente au lecteur :
Jacques Gaucheron, Etoile Apollinaire, 31
Michel Décaudin, Un chapitre impossible, 36
Jean-Claude Chevalier, Apollinaire et le calembour, 56
P.M. Adéma, “Le Festin d’Esope”, 78
Franz Hellens, Apollinaire avec le recul, 86
Claudine Chonez, Apollinaire parmi nous, 97
Simone Delesalle, Le langage d’Apollinaire, 105
Roger Chateauneu, Inventer l’alphabet du phénix, 112
Pierre Lagrue, Guillaume et Blaise, 118
Hélène Henry, Guillaume et Max, 124
Roger Navarri, Poète du déracinement, 132
Henri Meschonnic, Illuminé au milieu d’ombres, 141
Françoise Han, Images du futur, 169
Noémie Blumenkranz Onimus, Vers une esthétique de ” La Raison ardente “, 173
Georges Dupeyron, Espace et temps, 193
Bernadette Morand, L’absence et la guerre, 202
Lionel Follet, L’amour malheureux, dans “Les Sept Épées”, 206
Frédéric Robert, Apollinaire et ses musiciens, 239
Durey Louis, “Belle clarté, chère raison”, 248
Jean-Claude Chevalier, Apollinaire et la critique, 251
Marie-Louise Coudert, Apollinaire 66, 257
Albert Fournier, Des pied-à-terre au pigeonnier, 295
Il est difficile d’y déceler un principe d’organisation, tant les articles thématiques se mêlent aux études historiques et aux approches plus techniques, sinon le fait que la place d’honneur revient à un poète familier de la revue, lequel, par une image forestière, indique à la fois la place incontestable qu’occupe Apollinaire dans les lettres contemporaines, mais exprime aussi ses propres réticences (comme n’y manquèrent pas certains disciples immédiats d’Apollinaire), à l’égard de sa conception de la modernité, de l’ordre et de l’aventure. C’est, toute proportion gardée, ce qu’exprime, quelques pages plus loin, un autre poète, Franz Hellens, « avec le recul », comme il dit. Nul doute que le jugement de Georges Duhamel, comparant la poésie d’Apollinaire à une boutique de brocanteur, pèse encore sur plusieurs esprits, qui s’efforcent alors de le contredire, ainsi Lionel Follet qui tente avec conviction d’éclairer l’intermède insolite des « Sept Épées ».
Ainsi, les études d’histoire littéraire, au sens large du terme, ne manquent pas de signaler les points obscurs de son œuvre-vie (Décaudin), marquent les rapports conflictuels du poète avec ses complices Max et Blaise, montrent son rôle comme animateur de revues, analysent avec finesse les matériaux qui étaient donnés à lire à l’époque, tel le recueil des lettres à Madeleine Pagès, Tendre comme le souvenir (Bernadette Morand). Albert Fournier poursuit une entreprise savoureuse qui consiste à situer les écrivains dans leurs demeures et à faire entrer, en quelque sorte, la littérature par la promenade, qu’elle soit réelle ou imaginaire.
Mais ce qui, à mes yeux, fit date, et qu’on ne retrouvera plus guère dans la revue, ce fut la publication d’un travail d’équipe : celui que menaient Jean-Claude Chevalier, Simone Delesalle, Henri Meschonnic et leurs collègues à la faculté des Lettres de Lille. Car tel était leur lieu d’exercice. Je puis témoigner de leur réflexion collective, de leur souci d’employer un vocabulaire scientifiquement justifié, moi qui les ai souvent vus travailler dans la Flèche du Nord. Je ne devais pas tarder à descendre, eux à poursuivre leurs débats jusqu’à Lille. Le résultat revêt la forme d’articles autonomes mais interdépendants. C’était l’époque où la linguistique tendait à occuper tout le terrain des études littéraires. Elle s’avance ici à découvert, avec un sourire bienveillant, voire séducteur. Simone Delesalle en explorant tous les pouvoirs de la métaphore, Jean-Claude Chevalier en exposant une théorie, dont l’urgence se faisait sentir, du calembour créateur. Quant à Meschonnic, il lui revenait de tout dire, en raison d’une méthode qu’à l’époque j’aurais qualifiée de structuro-globale, ce qu’il m’aurait aussitôt refusé, afin d’y opposer sa conception du rythme comme totalité.
Un troisième groupe de contributions donnait sa couleur spéciale à la revue Europe, que l’on n’imagine pas renfermée sur son territoire. Apollinaire était ainsi vu de Prague, ou de Géorgie. Hubert Juin y relevait les traces de sa Wallonie natale, N.I. Balachov donnait une leçon sur les cosaques Zaporogues, enfin Michèle Loi y nommait la génération des jeunes poètes chinois tournés vers l’occident, et se référant explicitement à Apollinaire, au moment même où ladite « révolution culturelle » s’en prenait aux suppôts de l’étranger1.
***
La qualité exceptionnelle d’une telle livraison ne saurait faire oublier les cent-quatre-vingt autres articles mentionnant le poète d’Alcools durant toute la période considérée. Pour aller à l’essentiel, je ne mentionnerai que les textes le désignant par leur titre. Le DVD nous le permettant, nous mettrons de côté les notes de lecture pour analyser les articles de fond.
Signe indubitable de notoriété, trois poètes, appartenant à des générations différentes, lui consacrent chacun un poème. Ce sont, tour à tour, Anatol Stern2, ex-avant-gardiste polonais, qui prétendait avoir découvert la filiation napoléonienne du poète, évoquant en 17 chants la trajectoire du bon Guillaume, à la manière de « Zone » ; puis Walter Lowenfels3, poète américain, dont l’élégie (en anglais) avait été d’abord publiée en 1930 par Nancy Cunard chez Hours Press, sa petite maison rurale d’édition, traduite par Charles Dobzynski, lui-même poète fort attaché à la revue et partisan de l’adage baudelairien selon lequel le meilleur commentaire d’un texte est encore un poème.
Proches de ces hommages poétiques, viennent les évocations de son milieu, de sa vie quotidienne, avec le témoignage d’Henri Hertz4, récemment disparu, rappelant sa capacité à prendre le ton des gens rencontrés, son intérêt pour les Juifs, sa fantaisie comme journaliste, les aventures du Festin d’Ésope. Il concluait par son indéfectible foi en l’avenir. Piéton de Paris à sa manière, Albert Fournier5 rendait compte, au lendemain de sa mort (le 21 août 1967) d’une visite à Jacqueline Apollinaire, en décrivant ce qu’il nommait le musée Apollinaire, tout en répétant les assurances données par son neveu sur l’accès à la collection. Auparavant, un certain Laurent6 (qui ne donne que l’initiale de son prénom) rapportait sa participation à la réunion internationale de Stavelot, sa visite des lieux historiques où le jeune Apollinaire et son frère avaient vécu, sous la houlette de Pierre Adéma, et recensait la plupart des poèmes nés en cette Ardenne féconde.
Parmi les articles de fond, dirons-nous, apparaît d’abord, en prolongement de son important essai intitulé Plaisir poétique, plaisir musculaire, un curieux document convoqué par André Spire7. Il s’agit d’un texte fort circonstancié de George Sand protestant contre l’usage de la majuscule au début de chaque vers. Pour Spire, la disparition de ces majuscules est bien plus importante que celle de la ponctuation, initiée par Apollinaire sur les épreuves d’Alcools (récemment publiées par Tristan Tzara en 1953). Dix ans après, dans le volume consacré à l’année 1914, Roland Pierre8 commente la formidable création poétique d’Apollinaire pendant la guerre, et, bien évidemment, son exclamation « Ah Dieu ! que la guerre est jolie ». C’est qu’il pense à l’avenir, aux nouveaux domaines à explorer. Calligrammes désespère A. Breton, tandis qu’Aragon ne voulait y voir que l’ironie et la provocation indirecte. Et Couleur du temps, représentée après son décès, dit tout l’espoir qu’il place dans l’amour. C’est aussi à l’occasion d’un dossier consacré cette fois à Picasso que Michel Pierssens9 avance une opinion tranchée sur Apollinaire critique d’art. Il rappelle leur rencontre au Bateau Lavoir, renvoie une idée reçue selon laquelle Apollinaire aurait expliqué le cubisme. Poète, celui-ci donne une critique impressionniste, et il évolue vers le cubisme. Son commentaire, de plus en plus lyrique, n’explique pas mais accompagne l’élan créateur du peintre. Dans la dernière période analysée, l’érudition s’affiche en tant que telle. Quatre articles viennent ainsi éclairer le lecteur d’Europe. Le premier, d’un hispanisant, examine « Les Sources espagnoles d’Apollinaire dans Les Trois Don Juan »10, et montre chez Apollinaire une connaissance très fine de l’espagnol. Le second, dans l’ordre chronologique, met un point final à l’interrogation sur « L’Écriture cubiste d’Apollinaire »11. Le numéro entier étant consacré au cubisme littéraire, l’auteure recherche les affinités entre peinture cubiste et poésie d’avant-garde à travers les ouvrages qui se trouvaient dans sa bibliothèque. Elle fait ressortir la notion de « nécessité intérieure », employée par Kandinsky dans Du spirituel dans l’art, qui aura une belle fortune par la suite, chez Breton notamment. Mais surtout elle met en valeur l’influence d’un ouvrage de Gaston de Pawlowski, le Voyage au pays de la 4e dimension, qui ouvre sur une mise en cause de l’ordre de la lecture, favorisant l’apparition des Calligrammes. La même livraison nous donne un exemple de « Lecture du cubisme par deux poètes : Apollinaire et Reverdy »12. Les poètes ont su dire la théorie du cubisme mieux que les peintres et théoriciens. D’où une application en deux volets, opposant Apollinaire à Reverdy. Apollinaire met en évidence le « réel comme représentation » et le « travail-matière ». Enfin, dans le numéro consacré à Fernand Léger, Michel Décaudin insiste sur l’importance du second titre dans l’essai d’Apollinaire, Méditations esthétiques, où le poète distingue les peintres nouveaux, sous la bannière du cubisme13.
Chacun sait que la période considérée fut riche en republications des œuvres d’Apollinaire, et en publications d’inédits, ce dont les lecteurs sont le plus avides, notamment au sujet de ses lettres intimes, de ses carnets, et des œuvres dites licencieuses, qui lui permettaient de vivre honnêtement. Ce qui a donné lieu à une dizaine de recensions, dénommées notes de lecture dans la revue (ndl dans le DVD). On en relève dix entre 1948 et 2000, traitant de la publication d’œuvres d’Apollinaire lui-même.
La première est une brève notule, signée de Jacques Gaucheron, nouveau venu dans l’équipe d’Europe, dans les fourgons d’Aragon14. Il se réjouit d’une publication attendue depuis vingt ans, celle d’Ombre de mon amour (chez Pierre Cailler, Genève, 1948). Après tant d’exégèses savantes, il y trouve un bain de fraîcheur, ce qui ne résout d’ailleurs pas le mystère qui émane du poète, qu’il convient d’aimer en bloc, sous toutes ses formes, et surtout sans aucune censure. Il y a là un ensemble de matériaux qui invite à la poursuite des recherches, conclut-il.
La seconde, sous la plume d’Alain Guérin, salue la publication intégrale de Que faire ?, « excellent feuilleton » dit-il, d’autant plus qu’il est préfacé par Jean Marcenac, l’un des piliers de la revue d’après-guerre15. Couleur du temps : il considère que la poésie, ce qu’on nomme justement l’Esprit Nouveau, place désormais son espoir dans la science, et cite le fameux Lysenko, tant apprécié par Aragon pour ses théories génétiques, ce qui fit plonger Europe dans le stalinisme pour dix années, et lui colla une fâcheuse réputation ! Heureusement, Apollinaire ne devait pas faire les frais d’un tel sectarisme, comme le prouve le numéro spécial qui lui fut consacré en 1966, illustrant, par là-même, le nouveau cours d’Europe.
Auparavant, Marc Le Bot commente les Chroniques d’art publiées par L.-C. Breunig, souligne leur immense intérêt pour la connaissance du goût et de la société du temps, appelle à retoucher l’image du poète, son éclectisme, son rôle dans le développement de l’art contemporain, comment il se fait l’écho de ses amis16.
C’est à nouveau Jacques Gaucheron qui, dans la lignée de ce numéro, rend compte des Lettres à Lou, éditées et annotées par Michel Décaudin, qu’il salue en retraçant la genèse du volume résultant de « l’étrange intermède », pour reprendre l’expression du préfacier17. À ses yeux, poèmes et lettres sont inséparables, et la poésie s’éclaire de l’expérience sensuelle, laquelle réinvente l’amour, dans une âme et dans un corps. Comme on le voit, l’analyse est loin du vocabulaire marxiste. Gaucheron distingue deux versants dans cette correspondance : le premier, du 28 septembre 1914 jusqu’en mars 1915, c’est-à-dire jusqu’au moment où Apollinaire est au front. Le second où Lou devient invisible, où le poète projette un livre qu’il intitulerait « Correspondance avec l’ombre de mon amour ». Comme rien n’est simple, passe alors l’ombre mentale de Madeleine, qu’il rêve de former à sa main. Le commentateur souligne, pour finir, la révision des valeurs poétiques à laquelle l’ouvrage nous soumet.
Par la suite, les notes de lecture rendront compte de la correspondance d’Apollinaire. Une notule de Max Allau sur les lettres du poète à sa mère et à son frère relève le caractère bien connu de la mère, exigeante et toujours inquiète, en insistant sur la personnalité d’Albert, frère admiratif et généreux18. La note des Virmaux sur la correspondance du poète avec Picasso19 mentionne la curiosité croissante du public pour ce genre d’écrits intime, espérant percer un secret, et par conséquent toujours déçu. Ici, l’apport est incontestable, par les dessins dont Picasso parsème ses messages, par les poèmes qui viennent étayer ceux d’Apollinaire. Surtout, c’est la nature exigeante de cette amitié qui s’exprime, heureusement éclairée par les notes minutieuses de Pierre Caizergues, à l’évocation de toute une génération. Dans la même veine, la Correspondance Cocteau-Apollinaire, présentée par les mêmes érudits, est élogieusement signalée par Jean Pandolfi20. Il y voit revivre tout un pan de la vie artistique et littéraire de Noël 1916 au 5 novembre 1918.
Dans le même numéro, Jean-Paul Corsetti rend compte du Journal intime d’Apollinaire, publié par Michel Décaudin21. Brièvement, il en dit combien il reflétait les diverses facettes du poète, sa curiosité, son goût de l’étrange et du singulier. Il concluait : « Un livre singulier et divertissant et un fort bel objet bibliophilique. »
Il faut dire ici combien la recension d’une publication dans Europe est aléatoire, dépendant parfois d’un service de presse qui mésestime la revue, ou, inversement, d’une équipe fluctuante de recenseurs, ce qui, dans tous les cas, aboutit à des incohérences. Ainsi, on aurait pu penser que la nouvelle publication des Œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade devait susciter la publication d’un compte rendu à la parution de chacun des volumes. Ce ne fut pas le cas, ce qui ne signifie pas, au contraire, que l’auteur d’Alcools ait été méprisé. C’est donc le deuxième tome des Œuvres en prose qui suscite la réflexion de Max Alhau22. Il souligne le vœu d’unité chez le critique d’art Apollinaire, dont les Méditations esthétiques se concentrent sur cette formule : « J’aime l’art d’aujourd’hui parce que j’aime avant tout la lumière et tous les hommes aiment avant tout la lumière, ils ont inventé le feu. » Quant à la critique littéraire, Alhau en montre la triste évolution vers un certain patriotisme. Et de conclure sur la remarquable érudition des présentateurs, Décaudin et Caizergues. C’est le même Max Alhau qui, l’année suivante, rend compte du tome III des œuvres en prose23. Celui qui comblera le plus la curiosité du lecteur, tant avec les écrits anecdotiques que les érotiques (Les Diables amoureux), voire pornographiques (Les Exploits d’un jeune don Juan), de telle sorte que « la surprise du lecteur n’est jamais déçue ».
L’apollinarien exigeant voudrait sans doute qu’Europe signale ou rende compte, dans ses Notes de lecture, de tous les textes du poète, ou des ouvrages à lui consacrés. Il conviendra avec moi que dix signalements durant la période considérée, c’est loin d’être négligeable. D’autant plus qu’il faudrait y inclure deux notes sur des monographies. La première, en mars 1946, signale avec sympathie le petit livre d’André Rouveyre sur son ami, publié chez Gallimard24. Il n’en va pas de même avec la seconde, rendant compte de l’essai de Robert Couffignal dans la collection « Les Écrivains devant Dieu »25, que Jacques Gaucheron dénonce vigoureusement comme « un abominable petit livre », totalement faux, notamment dans son analyse de « Zone ».
***
L’image d’Apollinaire dans la revue Europe est loin d’être négligeable, tant quantitativement que qualitativement. Pour de multiples raisons, ne serait-ce que sa position au cœur des avant-gardes qui explosèrent après la Première Guerre mondiale, le poète d’Alcools et de Calligrammes devint, en quelque sorte, la pierre de touche de la poésie contemporaine, au-delà des articles qui lui furent explicitement consacrés. On se réfère constamment à lui, à propos de chaque écrivain de la génération qui lui succéda, tant pour dire la dette contractée à son égard, que la déférence dont elle témoigna. Ainsi dès la deuxième ligne de l’article que Georges Sadoul consacre à Paul Éluard (juil.-août 1953, p. 39) : il avait eu le défaut de mourir trop tôt… Il en est de même dans les dossiers consacrés à Tzara, à Breton, etc.
Certes, il n’apparait pas une « École Apollinaire », du moins pas dans cette revue. Encore que, par sa seule présence au Comité, Aragon ait pu en rappeler la figure tutélaire, nul n’a cherché à l’attirer vers soi. Au contraire, il semble que, pour échapper à cette tentation, les directeurs successifs aient délibérément donné la parole aux universitaires, aux chercheurs, aux meilleurs connaisseurs du poète, en évitant toute polémique, toute agressivité, et, inversement, toute sanctification.
À cet égard, il serait intéressant de connaître, de la même façon, et durant la même période, l’attitude du Mercure de France, qui publia le premier « La Chanson du Mal-Aimé », aussi bien que de La Nouvelle Revue Française. Reste que nul n’était mieux placé pour enchanter la revue Europe, que le poète qui, dans Calligrammes, annonçait les « Sons de cloches à travers l’Europe ».
Henri BÉHAR
1 En voici la référence : Brett Vladimir, « M. de Kostrowitzky à Prague », 273/ Juin Hubert, « Apollinaire et la Wallonie », 276/ Balachov N.I., « Apollinaire et les Zaporogues », 281/ Boitchidzé Gaston, « Apollinaire en Géorgie », 283/ Loi Michelle, « Apollinaire en Chine », 285
2 « La Maison d’Apollinaire », janv. 1970, p. 196.
3 « Apollinaire, une élégie », juin-juil. 1977, p. 143-148.
4 « Guillaume Apollinaire », janv. 1970, p. 132.
5 « Jacqueline Apollinaire », nov. 1967, p. 213
6 « Guillaume Apollinaire en Ardenne », nov. 1950, p. 111.
7 « George Sand précurseur d’Apollinaire », juin-juil. 1954, p. 22.
8 « Guillaume Apollinaire et l’avenir », mai-juin 1964, p. 155.
9 « Apollinaire, Picasso et la mort de la poésie », avril-mai 1970, p. 178.
10 Sanchis-Banus José, sept. 1976, p. 161.
11 Claude Debon, juin-juil. 1982, p. 118-126.
12 Denis Milhau, juin-juil. 1982, p. 44.
13 Michel Décaudin, « Léger, Apollinaire et les Futuristes », juin-juil. 1997, p. 97.
14 Jacques Gaucheron, « Apollinaire Guillaume, Ombre de mon amour, Genève, Pierre Cailler », 04/1948 p. 123.
15 Alain Guérin, « Guillaume Apolinaire : Que faire ? », 02/1951 p. 99.
16 « Guillaume Apollinaire critique d’art », fév.-mars 1962, p. 254.
17 Jacques Gaucheron’ « Apolinaire, Lettres à Lou », 06/1970 p. 268.
18 Max Alhau, « Apollinaire Guillaume : Correspondance avec son frère et sa mère », 06-07/1988 p. 220.
19 Alain et Odette Virmaux, « Picasso, Apollinaire : Correspondance », 06-07/1993 p. 217
20 Jean Pandolfi Ndl : Caizergues Pierre, Décaudin Michel : Correspondance Cocteau-Apollinaire, mars 1992, p. 215.
21 Jean-Paul Corsetti, « Apollinaire Guillaume : Journal intime », 03/1992 p. 214.
22 Max Alhau, « Apollinaire Guillaume : Œuvres complètes en prose, tome II (Pléiade, Gallimard) », 03/1992 p. 213.
23 Max Alhau, « Apollinaire : Œuvres complètes en prose, tome III (Pléiade, Gallimard) », 08-09/1993 p. 212.
24 Apollinaire. André Rouveyre 03/1946 p. 119.
25 Apollinaire. Robert Couffignal 12/1967 p. 310.
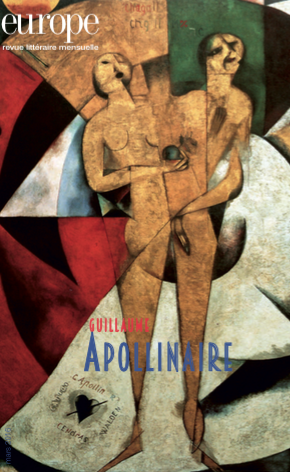
Le dossier consacré à Guillaume Apollinaire ayant été réalisé par nos soins, j’en fournis ici la composition.
Mars 2016 GUILLAUME APOLLINAIRE Europe revue littéraire mensuelle.
[Télécharger le sommaire de la revue Europe et l’article en PDF]
Henri Béhar, 2015, HL63, Sur une page autobiographique de Jarry, Hommage à Jean-Jacques Lefrère.
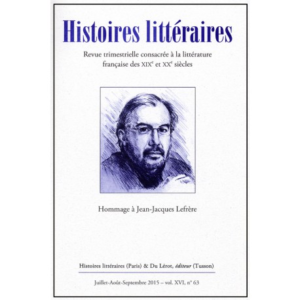
Numéro coordonné par Jean-Paul Goujon
Henri Béhar – Patrick Besnier – Chantal Bigot – Julien Bogousslavsky – Anne Borrel – Philippe Chauvelot – Alain Chevrier – Bertrand David – Sylvain-Christian David – Jean-Louis Debauve – Catherine Delons – Philippe Didion – Jacques Duprilot – René Fayt – Patrick Fréchet – Jean-Paul Goujon – Roger Grenier – Jean-Marc Hovasse – Maurice Imbert – Nelly Kaplan – Jean-Pierre Lassalle – Claude Makowski – Bertrand Marchal – Jean-Louis Meunier – Laure Murat – Steve Murphy – Eric Nicolas – Benoît Noël – Jean de Palacio – Marie-France de Palacio – Gilles Picq – Michel Pierssens – Olivier Roussel – Claude Schopp – William Théry – Daniel Zinszner
Illustration de couverture : Jean-Jacques Lefrère par Bertrand David
En m’annonçant la création d’Histoires littéraires, Jean-Jacques Lefrère me demanda de lui adresser quelque inédit surréaliste ou de même farine. Je n’en avais pas sous la main. Chaque fois que nous nous rencontrions, il renouvelait sa demande, toujours insatisfaite, hélas pour nous deux.
Pour me faire pardonner, s’il est encore possible, voici ce qu’à proprement parler on ne peut nommer un inédit, puisque le texte en a été imprimé de longue date, en 1902 exactement, mais le fac-similé d’une page manuscrite de premier jet de : Le Surmâle, roman moderne d’Alfred Jarry. L’existence de ce manuscrit avait été portée à la connaissance du public lors de l’Expojarrysition, à Paris, en mai-juin 1953. Il était ainsi décrit :
« Ce manuscrit relié, en parfait état de conservation, comprend 337 feuillets format 20 X 15. Signé. La numérotation des pages a été modifiée au moins deux fois par Jarry lui-même (chiffres au crayon bleu et rouge). Visiblement plusieurs feuillets ont été ajoutés après une première élaboration. Jarry prend soin de signaler à la page 163 (devenue 181) puis à la table des matières : « Il y a 324 pages de manuscrit (il y a 7 bis à partir de la page 161). » En réalité finalement, c’est bien 337 feuillets qu’on y trouve, se suivant dans l’ordre. Le texte est ainsi tout à fait complet. »
Suivait la mention « Coll. Bérès », ce qui signifie que ce manuscrit était alors la proprété du libraire-collectionneur-bibliophike Pierre Bérès.
Heureux les visiteurs de cette historique exposition, à la galerie Jean Loize à Paris, qui purent admirer ce manuscrit directement utilisé par l’imprimeur, comme l’attestent le nom de l’ouvrier chargé de la composition, à chaque changement de typographe, et des marques au crayon bleu et rouge d’imprimerie !
Frustrés les visiteurs de cette exposition historique, comme d’ailleurs de toute exposition livresque, puisqu’ils devaient se contenter de contempler une reliure placée sous verre ou, au mieux, une double page inamovible !
Frustrés les amateurs de Jarry, et surtout ses éditeurs successifs, qui espéraient tenir ce document entre leurs mains, sans y parvenir.
Pourtant, je ne crois pas que Pierre Bérès le leur eut refusé, s’ils avaient argumenté. Au vrai, il s’en défit le 25 mars 1991, lors d’une vente à Drouot, où la bibliothèque de Laval s’était portée acquéreur. C’est donc dès cette année-là que les amateurs auraient pu prendre connaissance du contenu, s’ilis s’étaient rendus dans la ville de naissance de Jarry. Un peu plus tard, ils n’avaient même plus besoin de se déplacer, puisque la totalité de ce document était numérisée et installée sur le serveur de la ville, lui-même accessible par le réseau1.
On connaît, en gros, le propos de ce roman. Après avoir prouvé dans Messaline, par des références historiques incontestables, que le désir humain ne fait que croitre à chaque fois que l’on pratique l’acte sexuel, ne pouvant s’éteindre que par la mort du sujet, Jarry veut opérer la même démonstration, située dans le futur, à propos d’un homme. Comme son qualificatif le laisse entendre, le Surmâle est capable de dépasser « l’Indien tant célébré par Théophraste », dont nous entretient Rabelais, et qui le faisait 70 fois en 24 heures.
Magnanime, j’ai choisi de reproduire le folio 276 de cet ensemble qui en comporte 337. Il fait partie du chapitre XII, intitulé « O beau rossignolet ». C’est le moment où les sept femmes, mobilisées pour l’expérience, et enfermées par l’héroïne qui s’est substituée à elles, ont enfin pu se libérer. Persuadées que rien ne s’est passé entre les deux amants avant leur propre irruption, elles assistent, en guise de mise en bouche (si je puis dire), à une scène de fellation.
Voici donc la page manuscrite, suivie de sa transcription diplomatique, telle du moins que nous l’autorisent nos actuels traitements de texte :
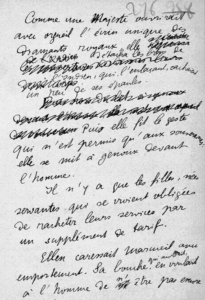
216
Comme une m Majesté ouvrirait
avec orgueil l’écrin unique des
diamants royaux, elle elle repoussade l’Indien détacha les bras depuis hors du lit à genoux
devant l’homme elle ravala un orgueil
de souverains
les bras
l’Indien, qui, l’enlaçant, cachaient
demi corps
un peu de ses épaules.
Puis hors du lit à genoux
devant l’homme elle ravala son orgueilet noblement Puis elle fit le geste
qui n’est permis qu’aux souveraines,
elle se mit à genoux devant
l’homme.
Il n’y a que les filles, nées
servantes, qui se croient obligées
de racheter leurs services par
un supplément de tarif.
Ellen caressait Marcueil avec
qui mordait,
emportement. Sa bouche, en voulaitne
à l’homme de n’être pas encore
Quels sont les enseignements d’un tel document ?
D’abord, et ce n’est pas inutile quand on connait les ragots qui ont couru sur les rapports de Jarry avec Rachilde, l’auteure de Monsieur Vénus (1884), celle-là même qui le qualifiera de Surmâle de lettres (1928). Ne disait-on pas qu’outre ce petit service qu’elle lui rendait à la demande, elle se substituait à lui pour rédiger des passages entiers de ses romans, afin de lui montrer comment « écrire comme tout le monde » ? Or, il n’y a pas de doute sur l’authenticité de la graphie, du moins pour ceux qui ont lu des centaines de pages manuscrites de l’auteur ou ses papiers officiels.
Ensuite, mais ce n’est pas nécessairement dans l’ordre chronologique, on voit Jarry à l’œuvre, comme si l’on assistait à une cinétique de l’écriture. Tel mot, telle proposition, à peine posés, sont effacés, pour être recopiés à l’identique quelques lignes plus loin, et cela non pas lors d’une relecture, mais bien dans le mouvement même de la rédaction.
Contrairement à ce que l’on imagine en lisant un passage scabreux, les biffures ne dissimulent aucune énormité, aucun terme que la morale réprouve et que l’auteur serait tenu de supprimer en vue de la publication.
En conclusion, cette page donne une représentation visuelle de Jarry au travail, de son contrôle du texte, de sa rapidité d’écriture.
Dès lors que la totalité du manuscrit est disponible sur Internet, qu’il est possible à tout un chacun de le comparer au texte imprimé, convient-il encore de le publier en fac-similé intégral, comme cela a pu se faire, avec des moyens classiques, pour d’autres œuvres2 ?
C’est évidemment indispensable pour l’amateur, et même l’érudit, qui se réjouira de pouvoir tenir en mains un document semblable au manuscrit de travail original, avec ses dimensions vraies, sa texture, ses taches et ses ratures, et, en supplément au programme, ss transcription littérale.
Hélas ! ce l’est moins pour le grand public, qui n’est pas habitué à manipuler de tels documents. Non qu’il faille créer une hiérarchie des manuscrits, en fonction de la qualité du texte final, de sa réputation, de son classement dans l’opinion publique, ou même de la difficulté relative que présente chaque manuscrit autographe, mais, plus simplement, parce que l’étude d’ensemble de celui-ci, qui se révèle fort intéressante pour l’attitude de Jarry au travail, ne laisse espérer aucune révélation, aucun repentir autre que ce qu’en avaient pu relever l’auteur du catalogue et, plus récemment, Henri Bordillon3 à propos du changement de papier, des deux écritures, de l’attention particulière portée au titre des chapitres, de la prolitérisation du nom de Marcueil.
En somme, le lectorat actuel s’en remet aux conclusions des savants, et ne demande pas à y aller voir par lui-même. Attitude regrettable, pourtant fort compréhensible. De même, il demande un robot de bonne qualité, sûr, obéissant aux injonctions humaines, et ne se soucie pas de se procurer les bleus des ingénieurs ou les rapports des différents essais pour savoir comment il a été conçu.
On s’en tiendra donc, aujourd’hui, à ce complexe : édition originale (ou reproduite à l’identique) +numérisation du manuscrit +édition critique contenant un examen des variantes.
De même que nos aînés, au XIXe siècle, ont mis des années à nous habituer au protocole d’édition qu’ils avaient fixé, il nous en faudra autant pour intégrer les moyens que nous donnent les progrès technologiques.
Voir le texte intégral des Gestes et opinions du Docteur Faustroll patapphysicien, établi et annoté par Alain Chevrier dans les Œuvres complètes d’Alfred Jarry, Classiques Garnier, tome III, p. 45-212.
****
Jean-Jacques Lefrère, co-fondateur de la revues Histoires Littéraires , biographe de Lautréamont, Rimbaud, Laforgue, etc., est mort le 16 avril 2015.
La revue qu’il dirigeait de main de maître entend lui consacrer un numéro d’hommage.
En attendant sa parution prochaine, j’ai retrouvé cette recension de son Arthur Rimbaud, Fayard, 2001. Destiné à la revue Europe, qui me l’avait commandé, il ne parut point, pour d’obscures raisons tenant à la localisation de la maison Rimbaud à Aden. Et Jean-Jacques, qui l’avait lu, en fut attristé. Le voici tel qu’il fut composé, sans aucune modification, en personnel hommage à ce bouillant défenseur des Lettres.”
Bien entendu, le lecteur commencera par feuilleter l’album photographique supposé montrer Rimbaud à Aden, tant est puissante l’attraction de la photographie. Les auteurs sont sûrs d’y reconnaître le poète parmi les hôtes d’Hassan Ali à Sheick-Othman. Est-ce Rimbaud ce jeune homme raide, au cuir tanné, au cheveu court, vêtements de coutil blanc, appuyé sur son fusil la crosse au pied ? Supposons-le et contemplons Aden du temps qu’il y était commerçant, grâce à cet ensemble de photos prises vers 1880, confrontées, à quelque distance, à la même vue prise aujourd’hui, en noir et blanc pour rester dans le ton. On n’y voit plus de chameaux, les constructions s’étendent anarchiquement, dominées par quelques minarets, la maison de César Tian (qui fut le premier commerçant français à s’implanter là en 1869) est à l’abandon, et celle de Bardey, qui employa Rimbaud, a disparu, remplacée par un immeuble anonyme, agrémenté de quelques climatiseurs disparates. Et l’ex Centre culturel français ouvert sur les lieux mêmes où Rimbaud demeura, est devenu le « Rambow Tourist Hotel ». Photos à l’appui, Lefrère établit qu’on s’est trompé de quelques dizaines de mètres en inaugurant avec de grands effets médiatiques cette éphémère Maison Arthur Rimbaud, pour le centenaire de sa mort, en 1991. Quoi qu’il en soit, la tristesse domine, et l’on comprend l’exclamation du jeune homme écrivant aux siens : « Il faut être bien forcé de travailler pour son pain, pour s’employer dans des enfers pareils ! ».
Mais ce jeune homme que je dis est-il le même que le poète ? Oui, affirme Lefrère sans hésiter dans le deuxième ouvrage qui se veut une biographie strictement factuelle, conduite dans l’ordre chronologique, avec le moins possible d’anticipations. C’en est fini du système d’oppositions duelles concernant Rimbaud : voyant ou voyou, poète maudit ou mystique à l’état sauvage, esclavagiste ou saint martyr, système solaire ou trou noir. Comme le préconisait cet autre poète de la révolte, Tristan Tzara, pour le centenaire de sa naissance, c’est l’unité d’une vie que Lefrère considère, sans rien gommer des oppositions et des renoncements.
Un constat, tout d’abord : de son vivant, Rimbaud n’a publié ou laissé publier que six écrits (« Les Étrennes des orphelins » dans La Revue pour tous, janv. 1870 ; « Trois baisers », dans La Charge, août 1870 ; « Les Corbeaux », dans La Renaissance littéraire et artistique, sept. 1872 ; le recueil Une saison en enfer imprimé à ses frais en Belgique, octobre 1873 ; le rapport sur l’Ogadine, dans les Comptes rendus des séances de la Société de Géographie, février 1884, des notes sur une expédition au Choa dans Le Bosphore égyptien en août 1887). Par ailleurs, il a marqué de son dédain la publication de certaines Illuminations et de « Vers nouveaux » dans La Vogue en 1886, réunis en plaquette la même année par Verlaine. C’est dire d’emblée son ambivalence à l’égard de la chose littéraire : il veut être publié, que ce soit comme poète ou comme explorateur, puis se désintéresse de son œuvre, comme si, étant allé jusqu’au bout d’une expérience, il laissait à d’autres le soin d’en tirer la conclusion pour l’avenir.
Rimbaud n’a pratiquement pas connu son père, capitaine d’infanterie, ancien chef du bureau arabe de Sebdou (Algérie), qui abandonnera le foyer conjugal vers 1860, à la naissance de son quatrième enfant, Isabelle. Son absence semble avoir donné lieu à une idéalisation, de la part du fils, et à une identification partielle, au moins par la quête des pays désertiques et la connaissance des peuples orientaux. Sa mère, Vitalie Cuif, drapée dans une dignité bourgeoise, manifestera une très grande autorité sur ses enfants. Mais, contrairement à l’image simpliste répandue à son sujet, elle est toujours restée très proche d’Arthur, tolérant tous ses écarts, pour incompréhensibles qu’ils fussent à ses yeux.
Dès l’âge scolaire, Arthur se montre un écolier doué de grandes facilités. Comme tous ses semblables de même condition sociale au même âge (voir Flaubert ou Jarry) ses productions personnelles illustrent parfaitement la culture potachique, compromis entre la culture classique des parents et de l’école, et la culture populaire des milieux fréquentés durant les vacances.
Rimbaud saute la classe de 5ème. Virtuose en vers latins, il adresse une lettre au Prince impérial à l’occasion de sa première communion ; il obtient le premier prix au concours académique en 1869, et ses chefs d’œuvre sont régulièrement publiés dans le Bulletin de l’Académie de Douai. Ses compositions scolaires montrent chez lui une très grande facilité mais aussi une certaine originalité, ses goûts, ses ambitions, ses désirs s’exprimant à travers le jeu conventionnel des vers.
En 1870, en classe de Rhétorique, la rencontre d’un jeune professeur suppléant de Lettres, Georges Izambard, l’amène à la littérature la plus moderne et le conduit à vouloir acquérir une gloire littéraire. En se vieillissant un peu, il écrit à Théodore de Banville, le chef de file de l’École parnassienne, et lui envoie trois poèmes de facture parfaite, dont la teneur est faite pour convenir au Parnasse contemporain où il espère, vainement, être publié.
Première fugue : à seize ans, en pleine guerre franco-prussienne, Rimbaud se rend à Paris par le train. Sans billet, il est arrêté et jeté en prison à Mazas le 31 du mois d’août. Izambard le fait libérer et l’accueille à Douai. C’est là qu’il recopie pour un jeune poète local, Paul Demeny, ses premiers poèmes, en vue, là encore, d’une prompte publication. Une semaine après son retour au domicile maternel, deuxième fugue : il reprend la route, à pied, jusqu’à Bruxelles. Revenu à Douai, il complète le cahier Demeny avec des sonnets réguliers composés en chemin : « La Maline », « Au Cabaret-vert », « Ma bohème », qui disent sur un ton familier « l’aise » de ce vagabondage automnal, la poésie de la marche, toujours plus avant, le cœur plein de cette nature qui le pénètre par tous les sens.
L’occupation prussienne est cause de vacances prolongées pour les écoliers. Rimbaud fait de longues promenades en forêt avec son ami Ernest Delahaye, auquel il aurait dessiné une société future : « Toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, les chemins tortueux deviendront droits et les raboteux seront aplanis. On rasera les fortunes et l’on abattra les orgueils individuels. Un homme ne pourra plus dire “Je suis plus puissant, plus riche”. On remplacera l’envie amère et l’admiration stupide… par la paisible concorde, l’égalité, le travail de tous pour tous ». Puis, c’est sa troisième fugue, il séjourne à Paris, du 25 février au 10 mars 1871, dans des conditions misérables, se présentant à des journalistes. Il est de retour à Charleville avant la proclamation de la Commune de Paris, pour laquelle il prend aussitôt parti.
Rien ne dit qu’il soit retourné à Paris s’engager dans les corps-francs. Du moins, ses contemporains le croyaient-ils. Tout en citant l’abondante littérature relative à cette prétendue quatrième fugue, Jean-Jacques Lefrère en doute, dans la mesure où Rimbaud lui-même n’en a soufflé mot (p. 247).
En tout cas, il est à Charleville lors de la Semaine sanglante (21-28 mai). Outre un hypothétique projet de Constitution communiste, il y écrit coup sur coup, à Georges Izambard le 13 mai, à Paul Demeny le 15, les lettres désormais connues sous le nom de « lettres du Voyant », qui énoncent sa poétique nouvelle, accompagnées des poèmes « Le Cœur supplicié », « Chant de guerre parisien », « Mes petites amoureuses » et « Accroupissements », à titre d’illustration. Comme traversé par une soudaine illumination, Rimbaud s’exprime dans la hâte, de façon désordonnée, suivant les mouvements de son cœur et de son âme, pour dire la fonction du poète à venir, chargé, par élection, de cultiver ce don inné qu’est l’inspiration. La seconde de ces lettres précise : « La première étude de l’homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière […] Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Il faut comprendre que le poète se considère comme « le suprême Savant », celui qui explore méthodiquement l’inconnu, par des voies irrationnelles. Après avoir été moyen d’expression, la poésie est donc activité de l’esprit et instrument de connaissance, projection en avant, marche au progrès. Et Rimbaud annonce un langage universel, qui serait compréhensible par tous : « Cette langue sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfum, sons, couleurs, de la pensée accrochant de la pensée et tirant ». À la femme il prédit un rôle éminent, lorsqu’elle sera émancipée, et distingue quelques uns de ses prédécesseurs qui furent de vrais voyants : Baudelaire et Verlaine.
Il écrit à Demeny le 10 juin 1871, lui demandant de brûler tous les vers qu’il lui a confiés auparavant : « brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d’un mort… » Tel Max Brod, soumis à une pareille injonction de Kafka, celui-ci n’en a rien fait, et c’est grâce à lui que nous pouvons lire le premier Rimbaud.
Celui qui « travaille à se faire voyant » n’a pas renoncé à l’idée d’être un poète reconnu. Il adresse à Banville un nouveau poème ironique où les lys sont des « clystères d’extases », : Ce qu’on dit au Poète à propos de fleurs, signé d’un pseudonyme plaisant, et dès septembre, par l’intermédiaire de Charles Bretagne (p. 309), prend contact avec Verlaine à qui il adresse ses dernières productions. Enthousiaste, ce dernier lui répond : « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend », et propose de le loger chez lui. Rimbaud vient à Paris avec, en poche, divers poèmes qui vont assurer sa réputation, notamment « Le Bateau ivre », et peut-être le sonnet « Voyelles » qui par sa perfection formelle et le mystère de ce qu’il désigne a suscité bien des interprétations contradictoires. Lefrère les élude en énumérant les précurseurs de la vision colorée (p. 433).
Dès lors, Rimbaud est vite intégré au groupe des poètes nouveaux, baptisés les Vilains Bonshommes, devenus, pour la plupart d’entre eux, les Zutistes. Il les étonne par sa facilité, ses excès en tout. Ses contributions à l’Album Zutique, révélées depuis 1943, montrent sa virtuosité dans le parodique, les « vieux-Coppée », le graveleux et l’obscène. Citons quelques titres : « Conneries », « État de siège ? », « Les Remembrances du vieillard idiot », le « Sonnet du trou du cul » composé avec Verlaine, « Nos fesses ne sont pas les leurs… ». N’exagérons pas leur importance : ils confirment la précocité de Rimbaud et l’étendue de sa palette mais ils n’étaient pas destinés à la publication, pas plus que les autres, constitués en recueil malgré lui. Plus certainement, c’est de son séjour au local des Zutistes que date son ascendant sur Verlaine et sa mauvaise réputation d’homosexuel. Les excès de Rimbaud et de Verlaine scandalisent leur famille et leurs amis, même les poètes, d’autant plus que Verlaine est marié et qu’il vient d’avoir un enfant. Les deux amants connaîtront deux années de vie commune et d’errances, entrecoupées de séparations et de repentirs. Au chapitre intitulé « le repas des communards », Lefrère consacre un long développement au Coin de table, tableau de Fantin-Latour sur lequel ils figurent tous deux, immortalisant à la fois le peintre et ses modèles.
Au printemps de 1872, Rimbaud retourne à Charleville après un détour par Arras, sur lequel le biographe reste ignorant (p. 456). Il fréquente la bibliothèque municipale où il lit toutes sortes de livres : « J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littérature démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs », écrira-t-il. Il compose des « Études néantes », qu’il recopie en mai, durant un nouveau séjour, relativement secret, à Paris. Lefrère nous apprend que Verlaine a logé son « giton des Ardennes » (p. 468, l’expression passe mal aux oreilles de certains rimbaldiens) rue Monsieur-le-Prince. Si on a pu recueillir l’ensemble que les éditeurs intitulent « Derniers vers » ou « Vers nouveaux », divers textes semblent à jamais disparus : son Cahier d’expressions dont parlait Richepin, des poèmes en prose, et La Chasse spirituelle objet d’une théâtrale mystification en 1949.
Le 7 juillet 1872, Rimbaud et Verlaine fuient en Belgique, où ils demeurent deux mois, puis « le drôle de ménage » séjourne à Londres, parmi les émigrés de la Commune, sur qui le biographe est intarissable.
Au printemps de l’année suivante, Rimbaud se replie dans la ferme familiale de Roche, rencontrant le dimanche Verlaine et Delahaye près de la frontière belge. Il compose encore des vers, et les premiers textes de ce qui deviendra Une saison en enfer qu’il nomme un « Livre païen » ou « Livre nègre ». C’est peut-être de cette époque aussi qu’il faut dater deux ébauches en prose : « Les Déserts de l’amour », relation onirique des expériences précédentes, et une suite évangélique, ou proses johanniques, réécrivant le Nouveau Testament, ou plutôt en comblant les silences.
Dès le 28 mai, les deux compères, passés par la Belgique, se retrouvent à Londres, où ils essaient de survivre en donnant des leçons de français. Après une violente querelle, Verlaine s’enfuit pour Bruxelles, puis il demande à Rimbaud de le rejoindre, annonçant à tous qu’il va se suicider. Le 10 juillet, il tire un coup de revolver sur son ami, le blessant à la main. L’affaire de Bruxelles, « est un des faits divers les plus fameux de l’histoire littéraire » (p. 595) dit Lefrère qui retourne aux archives policières pour la conter et l’interpréter par le menu : on lira l’effarant rapport d’experts sur l’examen corporel de Verlaine (p. 617). Celui-ci sera condamné à deux ans de prison, bien que Rimbaud ait retiré toute plainte. Le jeune homme revit son « pitoyable frère » à sa sortie de prison, et l’aurait rossé de la belle façon (mais Lefrère n’en croit rien) au cours d’une promenade à Stuttgart, où il apprenait l’allemand, ce qui signe leur rupture définitive à la fin février. Pourtant Verlaine, qui l’avait introduit dans le monde littéraire, et aimé dans le déchirement, ne cessera de se préoccuper de son oeuvre, présentant « Voyelles » et « Le Bateau ivre » dans la revue Lutèce en 1883, lui consacrant une part importante dans son étude sur Les Poètes maudits en 1884, rédigeant la notice des Illuminations (dont Rimbaud lui avait confié le manuscrit en Allemagne) deux ans après, puis la préface aux Poésies complètes en 1895, chez Vanier, l’éditeur des Décadents.
De retour à Roche, Rimbaud y achève en un mois, dans la fureur et l’exaltation, le recueil de poèmes en prose, Une saison en enfer, qu’il fait imprimer en Belgique, ayant convaincu sa mère d’avancer les frais d’édition. « Mon sort dépend de ce livre… », écrit-il à l’ami Delahaye, dans la perspective d’une carrière littéraire à laquelle il n’a pas renoncé. Il retire les exemplaires d’auteur, qu’il distribue à quelques amis parisiens. Mais, par manque d’argent, l’ensemble du tirage reste en dépôt chez l’imprimeur Jacques Poot, à Bruxelles, où un collectionneur le découvrira au début du vingtième siècle.
À l’époque où Rimbaud est supposé avoir achevé les Illuminations, il se trouve en Angleterre avec le poète Germain Nouveau qui l’aide à recopier certains de ses poèmes. Il vivote de leçons de français et cherche un emploi de précepteur. À la fin de 1874, il rentre à Charleville. À partir de là commence une ère d’errances et de vagabondages, qui a intrigué tous ses admirateurs, y compris Verlaine qui le désigne comme « l’homme aux semelles de vent », par allusion à ses qualités de marcheur infatigable. Mais surtout, il se détourne définitivement de la poésie, pour devenir un homme d’action, déclarant à un compagnon qui l’informait de la publication de ses poèmes dans La Vogue, en 1886, qu’il ne voulait plus entendre parler de ces « rinçures » !
Avec la même passion qu’il a vouée à la poésie, Rimbaud veut se consacrer à l’industrie. En 1875, il envisagera de passer le baccalauréat es sciences en candidat libre (p. 728). Il apprend les langues étrangères. Après l’Allemagne, il séjourne un mois à Milan. Frappé d’insolation sur la route de Livourne à Sienne, il est rapatrié à Marseille, où il aurait tenté de s’engager dans les troupes carlistes et de passer en Espagne. Et le voilà de retour à Charleville où il se place comme répétiteur et envisage de devenir Frère des Écoles chrétiennes, pour enseigner en Extrême-Orient ! La mort de sa jeune sœur Vitalie l’affecte : à son enterrement, il paraît le crâne rasé. Puis il repart pour Vienne, où il se fait voler. Retour à Charleville, départ vers la Hollande. Il s’y engage dans l’armée coloniale, va jusqu’à Sumatra, déserte, s’embarque sous un nom d’emprunt sur un navire écossais qui le mène à Liverpool en passant par l’Irlande. En décembre 1876, il est de retour à Charleville. Dès les beaux jours, il repart à l’étranger. Agent recruteur pour les Hollandais, employé de cirque en Suède et en Norvège. À l’automne, il s’embarque à Marseille pour l’Égypte. La maladie l’oblige à débarquer en Italie. Il passe à nouveau l’hiver chez les siens. Puis second départ vers l’Orient à partir de Gênes afin, croit-il, d’économiser sur le transport. Franchissant à pied le Saint-Gothard, un jour de tempête de neige ; il s’embauche comme contremaître dans une carrière de marbre à Larnaca (Chypre). Disputes avec les ouvriers, fièvre typhoïde, il est contraint de se rapatrier à Roche où il passe l’été. Nouvelle tentative de départ en automne, nouvel accès de fièvre à Marseille, nouveau repli à Roche pour l’hiver. En mars 1880, il regagne Chypre où il est engagé comme chef de travaux pour la construction du palais du gouverneur. En juillet, il démissionne, peut-être à la suite du meurtre d’un ouvrier, qu’il aurait commis dans un mouvement de colère. Cet épisode, revisité par Lefrère (p. 778), reste toujours aussi hypothétique. C’est alors qu’il s’embarque pour l’Arabie.
Aden, port sur la mer Rouge, le voit employé par la maison Bardey, comptoir d’import-export. De là, il est envoyé tenir l’agence d’Harar, en Abyssinie. Il y restera dix années sur lesquelles on est surpris d’avoir tant de détails, entrecoupées de séjours à Aden, et d’explorations dans les territoires alors peu connus de l’Ogadine et du Choa. Assoiffé de connaissances, il apprend les langues vernaculaires, se fait envoyer des livres techniques et scientifiques les plus récents, un outillage de photographe très perfectionné dont il apprend seul le maniement. Il veut toujours être le meilleur en tout, et particulièrement dans les techniques modernes. Mais, tel Bouvard et Pécuchet réunis, rien de ce qu’il entreprend ne peut réussir. La poisse. En 1884, il vit maritalement avec une femme d’Abyssinie dans une maison d’Aden. Un jour, à la fin de 1885, il flaire la bonne affaire en revendant un lot de fusils hors d’âge au roi Ménélik qui dispute à son suzerain le trône du Négus. Son associé meurt prématurément ; le gouvernement français, soucieux de se ménager de bons rapports avec les Anglais, refuse l’exportation d’armes, et finit par l’accorder. Rimbaud tente seul l’aventure. Il court après Ménélik qui lui prend sa livraison à bas prix et le condamne à payer les dettes de son associé… Après de vaines tentatives de départ en Extrême-Orient, il retourne à Harar installer une agence commerciale. « Je m’ennuie beaucoup, toujours ; je n’ai même jamais connu personne qui s’ennuyât autant que moi » écrit-il aux siens. En 1891, il souffre du genou droit. Obligé de s’aliter, il dirige ses affaires de sa terrasse. Dur à la peine, il se résout enfin à se faire soigner à Aden. En douze jours, sous des pluies torrentielles, à travers trois cents kilomètres de désert, une équipe de porteurs mène sa litière au port de Zeilah où il s’embarque pour Aden. Le médecin britannique suspecte un cancer du genou. Il arrive à Marseille, hôpital de la Conception où, le 27 juin, il est amputé. De retour à Roche pour sa convalescence, son état ne fait qu’empirer. Il retourne à Marseille en compagnie de sa sœur Isabelle. Dès le lendemain, il doit être hospitalisé. Entièrement paralysé, il dicte une lettre délirante au directeur des Messageries maritimes, où il demande à être porté à bord du prochain navire en partance pour Aden. Il s’éteint quinze jours après s’être confessé, pour faire plaisir à sa sœur, pense Lefrère (p. 1165).
Ironie du sort, à l’heure de sa mort paraît Reliquaire. Poésies de Rimbaud, édition procurée par Rodolphe Darzens, retirée du commerce à la suite d’un conflit avec l’éditeur et la famille de Rimbaud. S’étant détourné de la poésie quinze ans auparavant, avait-il pour autant renoncé à l’écriture ? Il ne semble pas, comme le prouvent les nombreuses lettres qu’il adresse à sa famille, où il annonce à mainte reprise son désir de relater, en vue d’une publication, ses expéditions dans les contrées inconnues. « Car je vais faire un ouvrage pour la Société de géographie, avec des cartes et des gravures, sur le Harar et le pays des Gallas » écrit-il le 18 janvier 1882. Cette intention se concrétisera par un rapport publié deux ans après, et une suite de notes dans un journal égyptien. En d’autres termes, de son vivant, Rimbaud se fait autant connaître comme explorateur que comme poète. Pas plus, pas moins. Il appartiendra à d’autres de recueillir ses poésies et de les publier, de la même façon qu’on trouvera dans sa correspondance personnelle tous les éléments d’une aventure où « la réalité rugueuse » est notée avec concision et précision, sans littérature, si l’on ose dire, dans un but de connaissance. Mais, dans les deux cas, ne s’agit-il pas de la même volonté exprimée dans les lettres du Voyant ?
Unité de Rimbaud, donc, ce qui ne veut pas dire simplicité. Le suivant pas à pas, sans idée préconçue, Jean-Jacques Lefrère en montre toute l’ambivalence. On appréciera la scrupuleuse démarche du biographe fournissant toutes les pièces du dossier, les replaçant dans leur contexte en les analysant, rectifiant les légendes, rétablissant les lieux exacts avec une faconde jaculatoire. Faisant fi des théories du texte, il revient à l’histoire littéraire positive. Mais au fait, Rimbaud n’était-il pas poète ?
Henri BÉHAR
26/07/2001
1 Voir le document fourni par la Société des Amis d’Alfred Jarry:
http://alfredjarry.fr/oeuvresnumerisees/PDFJarry/Jarry_BM_Laval_51754.pdf
2 Pensons, par exemple, à la beauté du cahier autographe d’Arcane 17 offert par André Breton à sa femme, Elisa, publié par mes soins chez Biro éditeur, en 2012.
3 “Marcueil dans le texte”, L’Étoile-absinthe, n° 132-133, 2015.
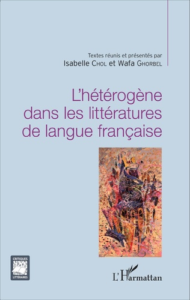
Cet ouvrage interroge la pertinence du concept d’hétérogénéité dans l’étude de la littérature francophone. Le mot « hétérogène » est entendu comme ce qui donne à voir une relation dynamique avec ce que la langue et la société instituent comme homogène. . L’auteur rend ainsi compte de la façon dont le texte littéraire participe d’une pensée critique qui met en question les discours dominants, tant au niveau des représentations sociales que des formes esthétiques, et qui interroge de ce fait nos propres outils d’analyse.
Date de publication : 1 novembre 2015
Broché – format : 15,5 x 24 cm • 296 pages
ISBN : 978-2-343-07386-6
EAN13 : 9782343073866
EAN PDF : 9782336395036
S’agissant de l’’hétérogène dans la littérature, on pense immédiatement à Jarry autant qu’à Bataille, et, par conséquent, à la communication d’Helga Finter sur « Ubu hétérologue » prononcée lors du colloque international du TNP, en mai 1985. L’article consignant sa pensée reste malheureusement peu connu car il fut publié dans un ouvrage un peu confidentiel, les cahiers de l’Association des Amis d’Alfred Jarry2. Son sous-titre, « remarques sur la littérature et le mal » indiquait d’emblée qu’elle se plaçait sous l’égide de Georges Bataille, puisqu’elle considérait qu’Ubu roi en son entier marque le retour du refoulé de l’enfance. Ubu est l’hétérogène, autrement dit la merde ; celui qui prétend tout à la fois la répandre et l’éliminer. Cependant, à mon sens, les personnages y nomment la merdRe, production phantasmatique, et non l’excrément lui-même, ce qui invalide une bonne partie du propos. Je ne le discuterai pas ici, et porterai plutôt mon attention sur une œuvre explicitement revendiquée par Alfred Jarry, qui répond exactement aux objectifs de cet ouvrage.
Il me semble, en effet, que l’hétérogène se manifeste encore plus violemment, de manière éclatante et avec moins d’ambiguïté, dans Les Gestes et opinions du Dr Faustroll, pataphysicien, du même auteur. Précisons qu’Ubu et Faustroll sont des confrères, étant tous deux docteurs en ’pataphysique. En outre, la paternité de ce roman « néo-scientifique » y est totalement reconnue et assumée, mais différée puisque, écrit et achevé en 1898, le volume n’est pas publié du vivant de Jarry par sa décision souveraine et son entière volonté.
Je me propose donc de montrer comment ce texte, évidemment complexe, est hétérogène sur au moins trois plans : au niveau spatio-temporel ; au niveau narratif ; au niveau culturel enfin. Cette complexité, l’incapacité du lecteur à la dominer, expliquant la relative ignorance où il se maintient depuis sa première édition en 1911 chez Fasquelle.
J’ai déjà mentionné ce fait, assez rare dans la production littéraire, que le volume a paru, posthume, parce que l’auteur, peut-être mécontent de deux refus successifs de ses éditeurs, l’a différé jusqu’après sa mort, par la note finale qu’il apposa sur le manuscrit vendu à Louis Lormel en 1898: « Ce livre ne sera publié intégralement que quand l’auteur aura acquis assez d’expérience pour en savourer toutes les beautés3 ». L’adverbe « intégralement » se rapporte au fait que certains chapitres en ont paru en revue avant son décès. On m’objectera l’exemple de Kafka, de dix ans plus jeune que Jarry, dont la quasi-totalité de l’œuvre est posthume. Mais il y a une très grande différence entre le fait de demander, par testament, la destruction totale de ses manuscrits (même si l’exécuteur testamentaire n’en a pas tenu compte), et celui de reporter une publication post-mortem !
Prenons donc l’ouvrage tel qu’il nous est parvenu. Dès la page de titre, il se présente comme un hapax, un cas unique dans la littérature française, par sa qualification générique, jamais reprise. Quels traits définitoires peut-on donner d’un genre qui n’a qu’une seule occurrence ? On connait, à la même époque, le roman scientifique promu par l’éditeur Hetzel, mais point de néo. Ici, l’imagination prend son vol.
De fait, chaque mot du titre pose un problème. Si l’on présume la signification du terme « gestes » ou du substantif « opinions », l’alliance de mots « Gestes et opinions » constitue encore un hapax, pour relater les actions et les pensées d’un personnage, le Docteur Faustroll, dont le nom est lui-même un composé du Dr Faust+Troll, autrement dit deux êtres de légende, avant le détournement du dernier par Internet ! Or, nous apprendrons que le héros est né et mort à la même date, puisqu’il est dit à la fin du chapitre XXXV : « Ainsi fit le geste de mourir le docteur Faustroll, à l’âge de soixante-trois ans. » Ce qui suppose que l’acte de mourir est aussi un geste déterminé par sa propre volonté !
Pour connaître la spécialité dudit docteur, il faut donc ouvrir le livre et y rechercher les définitions de cette science, ou bien se souvenir qu’Ubu s’est déjà qualifié de la même façon dans une œuvre antérieure de Jarry : « M. Ubu. – Ceci vous plaît à dire, monsieur, mais vous parlez à un grand pataphysicien. » (Ubu intime, L’Autoclète, 1893).
Si l’on voulait étudier, à la manière de M. Bakhtine, le chronotope de l’œuvre4, ce que je n’ai pas loisir de faire ici, on mesurerait bien vite une autre étrangeté : c’est que l’espace ne se contente pas d’être discontinu, feuilleté comme un livre, mais qu’il ouvre d’emblée sur la troisième dimension (le volume), et je dirais même qu’il tend vers la quatrième dimension, l’espace-temps qui est exactement la définition du chronotope dans l’esprit du critique russe. Je cite :
A travers l’espace feuilleté des vingt-sept pairs, Faustroll évoqua vers la troisième dimension :
De Baudelaire, le Silence d’Edgar Poe, en ayant soin de retraduire en grec la traduction de Baudelaire.
De Bergerac, l’arbre précieux auquel se métamorphosèrent, au pays du Soleil, le rossignol-roi et ses sujets.
De Luc, le Calomniateur qui porta le Christ sur un lieu élevé… (chap. VII)
Par un prélèvement discret dans les textes du passé, Faustroll fait revivre les beautés de l’imaginaire individuel de ses prédécesseurs, constituant, en quelque sorte, un florilège de ces citations qui aident à vivre et à occuper pleinement l’espace-temps. Encore faudrait-il connaitre chacun des livres constituant la bibliothèque du Docteur !
Par un simple regard porté sur la page de titre du volume et quelque plongée rapide dans le texte, surgissent les difficultés de compréhension, tant il est hétérogène. Il n’est que temps d’entrer dans le récit et, là encore, d’en marquer l’étrangeté.
Les actions et pensées que nous avons vues annoncées au seuil de l’ouvrage sont contées par un narrateur et sous une forme exceptionnelle, puisqu’il s’agit d’un exploit d’huissier, c’est-à-dire, selon la définition du Littré, un « acte que l’huissier dresse et signifie pour assigner, notifier, saisir ». D’où la création de René-Isidore Panmuphle, huissier de justice près le Tribunal civil de la Seine. Son patronyme donne à entendre qu’il incarne le Mufle5, c’est-à-dire le Bourgeois, en sa totalité. Et c’est bien son procès-verbal qui nous est donné à lire, sur papier timbré d’abord (Jarry a pris soin de dessiner le timbre à la main sur son manuscrit), puis sur papier libre, pour éviter, écrit-il, les trop grands frais qu’entraineraient de telles écritures légales, contenant un bon nombre d’énumérations et de listes. L’exploit s’arrête à la fin du livre VII, le reste du roman étant constitué de lettres reproduites et de fragments, vraisemblablement trouvés dans la chambre de Faustroll.
Autre particularité, qui éloigne le héros des grands voyages de la littérature, depuis l’Odyssée jusqu’à Pantagruel, le voyage qu’effectue Faustroll en compagnie de l’huissier et du singe papion Bosse-de-nage est strictement immobile :
L’as n’est pas seulement mû par des pelles d’avirons mais par des ventouses au bout de leviers à ressort. Et sa quille roule sur trois galets d’acier dans le même plan. Je suis d’autant mieux persuadé de l’excellence de mes calculs et de son insubmersibilité, que, selon mon habitude invariable, nous ne naviguerons point sur l’eau, mais sur la terre ferme.
Les îles auxquelles ils abordent sont des livres, ainsi, au chapitre XII, intitulé : « DE LA MER D’HABUNDES, DU PHARE OLFACTIF, ET DE L’ÎLE DE BRAN OÙ NOUS NE BÛMES POINT », qui indique clairement son contenu scatologique. Une lecture savante mettra en évidence le nom du dédicataire, pris ici comme cible, car il est bien affirmé que ce « n’est pas seulement une île, mais un homme ». Le chapitre suivant, et donc l’escale suivante, est au « PAYS DE DENTELLES », transposant littérairement l’art d’Aubrey Beardsley, dont Jarry s’est enthousiasmé, se plaisant à évoquer les gravures par des mots « le paradoxe de jour mineur se levait d’Ali-Baba hurlant dans l’huile impitoyable et l’opacité de la jarre »
Ce faisant, nous avons abordé, implicitement du moins, le goût des images chez Jarry, et sa pratique de la transposition d’art ou, plus précisément de l’ekphrasis, ce qui, en soi, n’a rien d’original, à commencer par le bouclier d’Achille chez Homère, mais qui revêt ici un caractère incongru, dans la bouche d’un huissier. L’usage excessif qu’il en fait confine à l’étrangeté : nous sommes alors bien au-delà du symbolisme. Ainsi de cette carte confiée par l’habitant d’une des îles visitée, qui
représentait au naturel, figurée en tapisserie, la forêt où s’adossait la place triangulaire : les frondaisons incarnates au-dessus de l’herbe d’azur uniforme, et les groupes de femmes, la vague de chaque groupe, avec sa crête de bonnets blancs, se brisant sans fracas au sol, dans un cercle excentrique d’ombre aurore. (chap. XIV)
dont il est aisé de comprendre qu’il s’agit d’une peinture d’Émile Bernard à Pont-Aven, représentant le Bois d’amour, porté en titre du chapitre. Il faudrait poursuivre avec les autres chapitres, qui ne se bornent pas à la transposition visuelle, traitant aussi des sons et des odeurs. Et je ne résiste pas au plaisir de citer ceci, où tout le monde aura reconnu le Gauguin des Marquises :
Hors de l’entrelacs des seins jeunes et des croupes, des sibylles constatent la formule du bonheur qui est double : Soyez amoureuses, et Soyez mystérieuses. (chap. XVII)
Nous atteignons ainsi à un univers baudelairien, à la différence qu’ici la Nature est devenue le Livre ! À se demander si la ’Pataphysique dont se réclame le Dr Faustroll n’est pas, tout simplement, le produit d’une rêverie prolongée devant une œuvre d’art !
L’énoncé que l’on trouve au Livre II, et qui est apparemment de l’auteur lui-même, le laisse entendre :
DÉFINITON: La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité. (chap. VIII)
Et, plus loin dans le même chapitre :
la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général.
Encore qu’il y ait beaucoup à en dire, mon propos n’est pas ici d’expliquer (autant que faire se pourrait) cette science d’origine potachique qui envahit le théâtre par les soins du Père Ubu6, mais bien de pointer une pataphysique en actes (ou en gestes, si l’on préfère), tel ce trait de Faustroll relevé par son huissier attitré :
Ce matin-là, il prit son sponge-bath quotidien, qui fut d’un papier peint en deux tons par Maurice Denis, des trains rampant le long de spirales; dès longtemps il avait substitué à l’eau une tapisserie de saison, de mode ou de son caprice. (chap. II)
Où il est patent que l’amour de l’art a conduit le savant docteur à se contenter du papier peint en deux tons par Maurice Denis !
Dans le même ordre d’idées, je mentionnerai l’un des nombreux collages, cette pratique littéraire née des manipulations picturales, consistant à intégrer un fragment textuel dans son œuvre, pour le faire sien, et lui conférer toutes les vertus qu’on voudra. En voici un exemple, parmi tant d’autres, qui convoque la lettre de Pierre Loti, que Jarry détestait :
| est-ce la dernière fois que le regret de tante Claire se produira en moi avec cette intensité et sous cette forme spéciale qui amène les larmes, puisque tout s’apaise, puisque tout devient coutume, s’oublie, et qu’il ya un voile, … Loti, Le Livre de la pitié… | que le regret de Latente Obscure se produira en moi avec cette intensité et sous cette forme spéciale qui amène les larmes, puisque tout s’apaise, puisque tout devient coutume, s’oublie et qu’il y a un voile… Jarry, Faustroll, XXX. |
Peut-être convient-il maintenant de revenir à la première partie du roman, et de donner le portrait du personnage dressé par son homme de loi ?
A cet âge-là, lequel il conserva toute sa vie, le docteur Faustroll était un homme de taille moyenne, soit, pour être exactement véridique, de (8 x 1010 + 109 + 4 x 108 + 5 x 106) diamètres d’atomes; de peau jaune d’or, au visage glabre, sauf une moustaches vert de mer, telles que les portait le roi Saleh; les cheveux alternativement, poil par poil, blond cendré et très noir, ambiguïté auburnienne changeante avec l’heure du soleil; les yeux, deux capsules de simple encre à écrire, préparée comme l’eau-de-vie de Dantzick, avec des spermatozoïdes d’or dedans. (chap. II)
S’il voulait que ce fragment soit compris du lecteur actuel, le commentateur devrait expliquer chacun des traits pour le moins hétérogènes notés ici. Ainsi, Faustroll est né adulte, tout comme le P.H. (modèle du Père Ubu), mais il meurt l’année même de sa naissance. De fait, il apparaît sur terre avec sa création par le livre. Sa taille, calculée à partir du diamètre d’un atome isotope, est évalué à 1,1.10-10m ; on peut en juger à la mesure de son lit, « long de douze mètres » (chap. IV). D’autres commentateurs concluent qu’il aurait la taille de Jarry lui-même, soit 1,61 m. Trace des usages juridiques, l’huissier écrit bien « unes moustaches », avec l’article indéfini pluriel, en usage dans le français classique pour ce qui va par paire. Il porte moustache à la façon du Roi de la mer figurant dans les Mille et une nuits (531 et 549e nuits). Quant à « l’ambigüité auburnienne », elle ne réfère pas à la couleur des cheveux mais à l’alternance des poils, à l’instar du régime pénitentiaire du même nom, alternant le travail collectif et le séjour en cellule. Enfin, l’encre simple à écrire se distingue de l’encre de Chine et des encres d’imprimerie. Les capsules fournies par le droguiste sont semblables à l’Eau-de-vie de Dantzig, obtenue par « infusion d’écorces de citrons et de macis dans l’eau-de-vie ordinaire, avec addition de feuilles-d’or », selon Pierre Larousse ; mais point de spermatozoïdes !
Pourtant, comme je l’ai supposé dans mes Cultures de Jarry (PUF, 1984), il n’est pas certain qu’une explication de chacun des mots inusités, rares ou difficiles, puisse faire saisir l’étrangeté de ce portrait, qui mêle le langage scientifique au vocabulaire technique du droit et à la fantaisie poétique, à l’aide d’associations multiples, pour dire simplement que Faustroll est un homme ordinaire fixé à l’âge de 63 ans sous la plume de son mémorialiste. Ainsi, l’hétérogénéité du récit, la variété des voix narratives, qui devrait lui donner les lumières du diamant, aboutit à une sorte d’incompréhension, par quoi l’hétéro gêne toujours.
En somme, je postule que pour goûter toute la saveur de cette œuvre extrêmement élaborée et portant à l’extrême la quête de l’originalité symboliste, il faut, non seulement s’imprégner des ouvrages contemporains, s’informer de l’état de la science et de la connaissance à l’époque de son écriture, mais encore savoir faire jouer entre eux tous ces niveaux de culture.
Cette approche culturelle des textes est d’autant plus compliquée ici que le lecteur se trouve aux prises avec un grand nombre de cultures s’entrelaçant de telle sorte qu’on a du mal à les identifier.
Pour la clarté de l’exposé, je distinguerai, dans l’ordre, un niveau de culture populaire, sinon traditionnelle, du moins telle qu’une certaine catégorie d’intellectuels voulait la promouvoir et la revaloriser à la fin du xixe siècle ; puis ce qui relève des humanités, ce qui s’enseignait à la même époque et constituait le bagage culturel des hommes instruits, dans quelque discipline que ce soit ; enfin ce qui ressortit de la science, entendue dans sa plus grande extension.
De la première relève, par exemple, l’image d’Épinal, ou son équivalent, consignée par l’huissier dénombrant les illustrations saisies dans la chambre de Faustroll : « une vieille image, laquelle nous a paru sans valeur, saint Cado, de l’imprimerie Oberthür de Rennes » (chap. IV). Image naïve et populaire d’autant plus intéressante aux yeux de Jarry qu’elle donnait dans ses marges une légende bretonne, selon laquelle le saint ici honoré aurait trompé le diable pour construire un pont reliant l’île à la terre ferme1. Il y a des années, j’avais émis l’hypothèse que les « Treize Images » ou Clinamen, une série de fresques produites par la Machine à Peindre manœuvrée par le Douanier Rousseau provenaient d’une collection d’images d’Épinal que nous n’avons pas encore identifiées, illustrant des passages de l’Histoire Sainte : « Nabuchodonosor changé en bête », « Le Bouffon », « Sortant de sa félicité, Dieu crée les mondes », etc. (Clinamen chap. XXXIV). On peut aussi penser à une Bible historiée du moyen-âge, et encore à des peintures de Paolo Uccello ou Lucas Cranach pour de telles séquences, ou encore lorsque « Dieu défend à Adam et Ève de toucher à l’arbre du bien et du mal ». Il est vrai que les artistes en question sont rien moins que populaires, mais leurs œuvres, copiées, maintes fois reproduites, apparaissent désormais comme des œuvres populaires. (Dernièrement, on a proposé d’y voir un écho des films muets nouvellement conçus par Georges Méliès.)
C’est pourquoi je mettrai dans la même catégorie L’évêque marin Mensonger : « Sa mitre était d’écailles et sa crosse comme le corymbe d’un tentacule recourbé; sa chasuble, que je touchai, tout incrustée de pierres des abîmes, se levait aisément devant et derrière mais par la pudique adhérence du derme assez peu par-delà le surgenou » (chap. XXV), tout droit sorti du livre sur les poissons du savant de la Renaissance, Ulysse Aldrovandi, dont les planches ont suscité l’admiration collective (Bologne, 1613), de même que la Bête marine provient de la Cosmographie de Sébastien Munster (1544), d’où Jarry avait aussi tiré la reproduction de l’hippopotame dans Perhinderion.
S’il est vrai que ces savants de la Renaissance ne font pas partie intégrante de la culture populaire, certaines parties de leurs œuvres ont été fort répandues depuis, par divers opuscules, des almanachs, au point qu’elles font partie intégrante des croyances du peuple. Plus complexe, puisque directement issue de la culture populaire, l’œuvre de Rabelais relève de la même catégorie, bien qu’elle fasse partie, au temps de Jarry déjà, des programmes scolaires. Rabelais lui fournit ses épigraphes des chapitres XVI : « S’enquestant quelz gens sçavans estoient pour lors en la ville, et quel vin on y beuvoit. » Gargantua, et XXXI : « Comment as-tu nom ? – Maschemerde », répondit Panurge, Pantagruel, livre III. Le vin d’une part, la scatologie d’autre part, ne sont-ce pas là des motifs courants dans la culture populaire ?
La forme seule, et la grande distance temporelle entre la publication des ouvrages de Rabelais et leur utilisation par Jarry, les déporte vers l’enseignement secondaire, ce qu’en gros on nommait les « humanités », autrement dit les classes de lettres.
C’est du temps du lycée que date, chez Jarry, l’excellente habitude de se référer directement au dictionnaire encyclopédique, et même d’intégrer ses données à son propre texte. Ainsi de l’un des sens du mot « ha ha » emprunté à la Métromanie de Piron cité par le Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse, et même la suite :
C’est à dessein que nous avons omis de dire, ces sens étant fort connus, que ha ha est une ouverture dans un mur au niveau de l’allée d’un jardin, un trou-de-loup ou puits militaire destiné à faire écrouler les ponts en acier chromé, et que AA se peut encore lire sur les médailles frappées à Metz. Si l’as de Faustroll eût un beaupré, ha ha eût désigné la voile particulière placée sous le bout-dehors. (chap. X)
La pratique scolaire se complique lorsque le narrateur aligne une série de quarante-deux citations en grec prélevées chez Platon, qui toutes sont des appuis du discours, du genre « Sûr !, Mais encore », etc.
Cette forme de culture savante, d’origine scolaire, imprègne la totalité de l’ouvrage, quelle que soit la voix qui s’exprime. Elle est complétée par des éléments scientifiques, de ceux que l’on apprend dans les cours de mathématiques et de physique-chimie, Jarry en retenant plutôt les curiosités, les expériences divertissantes. Ainsi de la formule de l’encre sympathique avec laquelle est prétendument écrit le manuscrit de Faustroll :
Panmuphle, huissier, commençait de lire le manuscrit de Faustroll dans une obscurité profonde, évoquant l’encre inapparente de sulfate de quinine aux invisibles rayons infrarouges d’un spectre enfermé quant à ses autres couleurs dans une boîte opaque. (chap.VII)
En l’occurrence, ce n’est pas ici un souvenir scolaire, mais un emprunt à Lord Kelvin, lequel écrit exactement ceci :
Le phénomène se produit d’une manière très belle avec le sulfate de quinine. Une expérience intéressante consiste à écrire sur un écran de papier blanc avec le doigt, ou un pinceau, trempé dans une dissolution de sulfate de quinine. Les traits sont tout à fait invisibles dans la lumière ordinaire ; mais si l’on projette sur l’écran un spectre dont la portion ultra-violette invisible couvre la région sur laquelle on a écrit avec le sulfate de quinine, les caractères apparaissent, émettent une lumière bleuâtre, l’obscurité régnant autour d’eux2.
Visiblement attiré par ce qu’on dirait la physique amusante, qui n’en est pas moins très sérieuse et à l’origine de bien des découvertes, Jarry s’intéresse aussi aux recherches d’un savant peu ordinaire sur les phénomènes de capillarité :
Il est vraisemblable que vous n’avez aucune notion, Panmuphle, huissier porteur de pièces, de la capillarité, de la tension superficielle, ni des membranes sans pesanteur, hyperboles équilatères, surfaces de nulle courbure, non plus généralement que la pellicule élastique qui est l’épiderme de l’eau. (Chap. VI)
Ce Charles Vernon Boys (1855-1944), dédicataire dudit chapitre, avait publié ses conférences, traduites en français3 chez le même éditeur scientifique que Kelvin, Henry Gautier-Villars, qui se trouvait être une relation de Jarry et le fournissait en livres attrayants.
De telles sources savantes peuvent échapper au lecteur, qui n’en perçoit pas moins l’application qu’en fait Jarry à des inventions textuelles originales. La vérité est que les commentateurs ont toujours été mis sur la piste de l’élément déclencheur par Jarry lui-même, qui place un indice dans son texte, une sorte d’encodage indiquant ce qu’il faut rechercher, par exemple le nom du savant comme dédicataire du chapitre. Mais le lecteur, qui ne serait pas au fait de telles pratiques, en reste désorienté, incapable qu’il est de faire la différence entre la pure invention et le véritable raisonnement scientifique.
Pour conclure, il convient d’indiquer un élément omniprésent dans Faustroll, contribuant fortement à l’hétérogénéité du texte, qui ne relève d’aucune de ces cultures en particulier et pourtant les englobe toutes. Je veux parler de l’érotique – ce qui nous rapproche de Bataille – qui investit l’ensemble narratif, et que Jarry résume magnifiquement dans un prétendu fragment emprunté à Ibicrate le géomètre sous la formule suivante :
Éros étant fils d’Aphrodite, ses armes héréditaires furent ostentatrices de la femme. Et contradictoirement l’Égypte érigea ses stèles et obélisques perpendiculaires à l’horizon crucifère et se distinguant par le signe Plus, qui est mâle. (Chap. XXXIX)
Il renvoie implicitement à l’une de ses premières œuvres publiée par Jarry, à César-Antechrist, « où se trouve la seule démonstration pratique, par l’engin mécanique dit bâton à physique, de l’identité des contraires », le féminin et le masculin, les signes − et +, n’étant que la représentation symbolique de ladite unité. Le dernier chapitre de Faustroll, affirme le principe d’équivalence cher à Hermès Trismégiste et aux alchimistes (avant de devenir un dogme essentiel du surréalisme) par lequel les contraires s’identifient et fusionnent entre eux. Suit alors, et c’est bien là que tendait toute la démonstration de Jarry – et la mienne par conséquent – un savant calcul de la surface de Dieu, répondant par avance (pataphysiquement dira-t-on) aux inquiétudes métaphysiques de Bataille, à la définition suivante : « Dieu est le plus court chemin de zéro à l’infini ».
1. Voir une reproduction intégrale en couleurs dans Jarry en ymages, Paris, Le Promeneur, 2012, p. 35.
2. Voir William Thompson (Lord Kelvin), Conférences scientifiques et allocutions, Paris, Gauthier-Villars, 1893, n. 1, p. 136.
3. Bulles de savon, quatre conférences sur la capillarité faites devant un jeune auditoire, traduit par Ch. Ed. Guillaume, Paris, Gauthier-Villars, 1892, 144 p.
1. Pour le colloque de Gafsa, le 5 avril 2012, j’ai présenté et commenté, sous le même titre, un ensemble d’une quarantaine de diapositives organisées sous le logiciel Powerpoint. Il n’était pas question de les reproduire ici. D’où cette transposition, sans aucune illustration, reprenant mon propos initial à la lettre.
2. Helga Finter, « Ubu hétérologue : remarques sur la littérature et le mal », L’Étoile absinthe, actes du colloque du TNP réunis par Henri Béhar et Brunella Eruli, Tournées n° 25-28 1985, p. 31-41.
3. Mention manuscrite autographe figurant sur le Ms L (Lormel). Par la suite, nous renvoyons à l’édition numérique procurée par nos soins à l’adresse suivante : http://www.alfredjarry.fr/amisjarry/documents/Textes%20en%20ligne/faustroll.htm
4. Voir : Maikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978.
5. On se référera utilement à Henri Béhar, « Du mufle et de l’algolisme chez Jarry », Romantisme, 1977, n°17-18. Le bourgeois. p. 185-201.
6. Je l’ai fait ailleurs, dans mon Jarry dramaturge, Paris, Nizet, 1980, édition revue et augmentée sous le titre La Dramaturgie d’Alfred Jarry, Paris, Honoré Champion, 2004.

Texte publié dans la section « Correspondance » de la revue :
Aujourd’hui, les médias ne bruissent que de l’édition prochaine, annoncée par les éditions Fayard, de Mein Kampf [Mon combat], tombant dans le domaine public cette année.
Faut-il, en cette période de régression mentale caractérisée, redonner la parole au plus criminel des hommes ?
Les uns protestent, au nom de milliers de morts.
Les autres, dont je suis, pensent, comme Apollinaire, qu’il faut tout publier.
Publier, oui. Mais pour quels lecteurs ? Les esprits adultes, sachant reconnaître la performativité d’un texte, ont le droit de connaître la bibliothèque de base du nazisme. Faut-il pour autant en écarter les autres ?
À cet égard, je me souviens des difficultés que je rencontrai lorsque, préparant cette anthologie critique sur Dada, qui finirait par être publiée, avec la collaboration de Michel Carassou, sous le titre Dada, histoire d’une subversion (Fayard, 1990, 2005). Sachant qu’Hitler avait annoncé qu’il ferait sa fête à Dada dès son arrivée au pouvoir, il me fallait trouver le passage exact de Mein Kampf où cette menace était consignée.
La bibliothèque la plus proche, pour moi, était alors celle de la Sorbonne. Je n’avais qu’un étage à monter pour me procurer cet ouvrage maudit. S’il y avait bien une fiche à cet auteur et à ce titre dans la salle de bibliographie, l’ouvrage, ou plus exactement, sa traduction française, ne se trouvait pas sur les rayons, auxquels j’avais un droit d’accès direct, comme tous les professeurs titulaires.
Je m’en ouvris au directeur de cet établissement interuniversitaire, et lui demandai d’éclairer ma lanterne sur cette disparition matérielle. Ne fermait-on pas régulièrement les salles pour raison d’inventaire, à la recherche des ouvrages non restitués, disparus, mais pas pour tout le monde ? Et quand bien même un lecteur indélicat se serait approprié le volume, n’avait-on pas le moyen de le remplacer ?
Ce cher directeur m’expliqua alors qu’à la Libération, un comité d’épuration s’était constitué de lui-même pour mettre un certain nombre de titres à l’abri des lecteurs. L’Enfer politique, quoi.
Fort de mes convictions rationnelles, je lui demandai de combler le vide. Ce qu’il fit aussitôt, me prévenant dès l’arrivée de l’ouvrage, muni d’un papillon qui, conformément à la loi, mettait le lecteur en garde contre les effets morbides d’une telle lecture.
Voici le passage que j’en tirai concernant Dada :
« Si le jugement sur Dada porté par Camus traduit une compréhension qui ne peut manquer de surprendre, celui d’Adolf Hitler en revanche, en parfaite conformité avec ses convictions intimes, traduit la menace que Dada faisait peser sur la culture : ‘’Mais un tel développement [de l’épidémie dadaïste] devait finir un jour ; en effet, le jour où cette forme d’art correspondrait vraiment à la conception générale, l’un des bouleversements les plus lourds de conséquences se serait produit dans l’histoire de l’humanité. Le développement à l’envers du cerveau humain aurait ainsi commencé… mais on tremble à la pensée de la manière dont cela pourrait finir » (Adolf Hitler : Mon combat (1924), Nouvelles Editions Latines, 1984, p. 258). Hitler l’avait compris, Dada entendait bien provoquer « un effondrement culturel ». Prétendant défendre la culture, lui-même devait provoquer un tout autre effondrement qui donnerait encore raison à Dada. Pour défendre les valeurs d’une « culture » et des intérêts particuliers, le dictateur allait causer la mort de millions d’hommes. A l’inverse, Dada s’attaquait à ces valeurs et à ces intérêts au nom de la vie, d’une vie qui serait pleinement vécue par tous les hommes. » (p. 42)
Aujourd’hui, Dada a clairement triomphé sur son adversaire nazi. Le centenaire de sa naissance à Zurich devrait marquer cette victoire, par des cérémonies publiques à la hauteur de l’événement.
En sera-t-il toujours de même ?
Si, en 1979, un jugement de la Cour d’appel enjoignait aux Nouvelles Éditions Latines de publier la seule traduction autorisée de Mein Kampf munie d’un avertissement, le fait que l’original entre dans le domaine public au 1er janvier 2016 entraîne que n’importe qui pourra l’éditer comme il le voudra, de le faire retraduire, et de le proposer à la vente sans aucun avertissement. D’autant qu’il ne peut être visé par la loi sur la liberté de la presse, ni par son complément dit Loi Gayssot (qui ne porte que sur la contestation des crimes nazis).
Une seule observation, mais de taille : les libraires interrogés nous disent tous que la mise en vente d’une traduction française ne serait pas une bonne affaire commerciale.
Je le répète : seules des raisons intellectuelles justifient la mise à disposition des lecteurs de cet ouvrage infâme. Mieux vaut qu’il soit accompagné d’un important appareil critique, rédigé par les meilleurs historiens, comme l’annoncent les éditions Fayard.
Reste, hélas, que nul éditeur n’est maître de la qualité de la lecture, ni des égarements ou détournements auxquels elle peut conduire. Heureusement, les lois françaises ne sont pas seulement faites pour la protection des animaux.
Henri BÉHAR
19 octobre 2015
Voir le site du Bulletin de la société : Bulletin de la Société J.-K. Huysmans
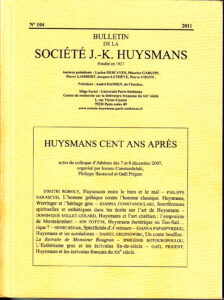
Dimitri ROBOLY. Huysmans entre le bien et le mal…3
Philippe BARASCUD. L’homme gothique contre l’homme classique. Huysmans, Worringer et l’héritage grec…15
Ionna CONSTANDULAKI. Interférences spirituelles et esthétiques dans les écrits sur l’art de Huysmans…29
Dominique MILLET-GÉRARD. Huysmans et l’art chrétien : l’empreinte de Montalembert…37
Ion ZOTTOS. Huysmans ésotérique ou Éso-Sati….rique ?…51
Henri BÉHAR. Spécificités d’A rebours…69
Ioanna PAPASPYRIDOU. Huysmans et les surréalistes…85
Daniel GROJNOWSKI. Un conte bouffon : La Retraite de Monsieur Bougran…93
Iphigénie BOTOUROPOULOU. L’Esthétisme grec et les écrivains fin-de-siècle…101
Gaël PRIGENT. Huysmans et les écrivains français du XXe siècle….107
Cette brochure publie les actes du colloque d’Athènes les 7 et 8 décembre 2007, à l’occasion du centenaire du décès de l’auteur d’A Rebours.

Lire le texte numérisé d’A rebours : https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%80_rebours/Texte_entier
[Télécharger le PDF de l’intervention d’Henri Béhar]
[Au colloque d’Athènes, cette communication avait la forme d’une présentation de trente-trois diapositives commentées oralement. La simple reproduction d’une suite d’images sous PowerPoint n’ayant aucun sens dans une revue, je me suis résolu à publier un texte continu, au risque de figer ce qui n’était à l’origine qu’une proposition de lecture portant sur des analyses assistées par ordinateur.]
Ces propos résultent des recherches et des réflexions de l’équipe Hubert de Phalèse (Paris III-CNRS) qui, pour l’occasion, a produit un ouvrage destiné principalement aux candidates et candidats au concours d’agrégation de 1972. Ce groupe, ainsi dénommé en référence à l’auteur d’une concordance de la Bible publiée au XVIIe s. précédée des consignes indispensables à ses yeux pour fournir un travail cohérent.
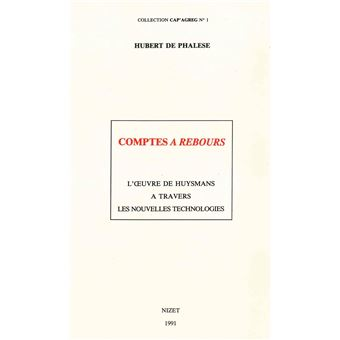
Cette collection Cap’Agreg se propose de fournir à l’étudiant qui prépare les concours du professorat les matériaux les plus directement utiles à son travail, dans le domaine des études littéraires, fournis par les outils informatiques actuellement disponibles (banques de données, disques optiques numériques, logiciels d’analyse textuelle). Dans chaque ouvrage, il trouvera pré-traitées les données informatiques qui, autrement, lui demanderaient un surcroît dé préparation. À propos d’A Rebours de J.-K. Huysmans, sont rassemblées des informations historiques sur la période, les écrivains, les genres et les thèmes littéraires ; des fiches sur la structure du vocabulaire, les mots d’époque (décadence, névrose, hystérie, fin de siècle), sur les principaux thèmes de l’œuvre. On trouvera en outre, dans Comptes à rebours, un glossaire doublé d’une concordance des mots rares ou difficiles, un florilège des opinions émises sur Huysmans et le personnage de des Esseintes, une bibliographie et l’index des noms propres qui manquait à l’édition de référence. Ainsi pourra-t-on se garder des trois péchés qui généralement entachent les études littéraires : l’anachronisme, l’émanatisme, la confusion du moi social avec le moi écrivant. Ambition qui, par-delà les concours, devrait concerner tous les amateurs de Belles-Lettres soucieux de s’ouvrir aux technologies nouvelles.
La Librairie Nizet ayant fermé sa porte définitivement, l’ouvrage n’est plus disponible à cette enseigne, mais on le trouve encore dans les bonnes librairies. On peut le lire en version numérique ici:
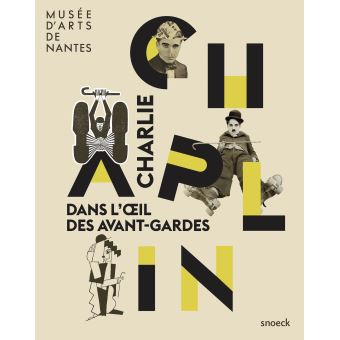
[ article à télécharger en PDF]
« Charlot-Dada » : texte repris dans : Essai d’analyse culturelle des textes, Paris, Classiques Garnier, p. 113-121. Collection : Théorie de la littérature, n° 24.
Ainsi que: https://melusine-surrealisme.fr/henribehar/wp/?p=1077
Lire le texte de Rutebeuf: De Charlot le Juif QUI CHIA EN LA PEL DOU LIÈVRE :
Sujet de fascination pour les artistes du monde entier dès 1914, à la naissance du personnage de Charlot, et profondément conscient des problématiques de son temps, Chaplin affirme des préoccupations esthétiques et thématiques fortement partagées par les artistes d’avant-garde.


Il est l’une des premières stars internationales du cinéma, Charlot, vagabond aussi drôle qu’émouvant, devient dès son apparition en 1914 la coqueluche du monde occidental, s’emparant des salles obscures et s’affichant dans les journaux et les publicités. Mais le personnage créé par Charlie Chaplin n’est pas qu’un phénomène médiatique et populaire. Le cinéaste a aussi une influence directe sur les artistes de son temps, dont il partage bon nombre de réflexions et préoccupations.
L’exposition propose ainsi une lecture inédite des œuvres d’avant-garde à travers du cinéma de Charlie Chaplin. De Fernand Léger à Marc Chagall, d’Alexander Calder à René Magritte, près de 200 œuvres provenant de collections du monde entier se déploient au regard du cinéma chaplinien.
Découvrez les échanges affirmés, les simples échos ou dialogues inconscients entre les artistes qui prirent ensemble le virage de la modernité, à l’heure de la naissance du cinéma comme septième art.
L’une des premières stars internationales du cinéma, Charlot, vagabond aussi drôle qu’émouvant, devient, dès son apparition en 1914, la coqueluche du monde occidental, s’emparant des salles obscures et s’affichant dans les journaux et les publicités. Mais le personnage créé par Charlie Chaplin n’est pas qu’un phénomène médiatique et populaire. Le cinéaste eut aussi une influence directe sur les artistes de son temps, dont il partage bon nombre de réflexions et préoccupations.
L’exposition Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes propose ainsi une lecture inédite des œuvres d’avant-garde au travers du cinéma de Charlie Chaplin. De Fernand Léger à Marc Chagall, d’Alexander Calder à René Magritte, près de 200 œuvres provenant de collections du monde entier se déploient au regard du cinéma chaplinien et redessinent les échanges affirmés, les simples échos ou dialogues inconscients entre les artistes qui prirent ensemble le virage de la modernité, à l’heure de la naissance du cinéma comme septième art.
Direction éditoriale : Claire Lebossé
Auteurs du catalogue : Claire Lebossé, Commissaire d’exposition ; Zoé Isle de Beauchaine, Auteur ; Musée d’arts de Nantes (Nantes), Directeur de publication, rédacteur en chef
Daniel Banda, Henri Béhar, Francis Bordat, Olivia Crough, Zoé Isle de Beauchaine, Morgane Jourdren, Claire Lebossé, José Moure, Charlotte Servel.
Couverture : Nicolas Hubert
© Musée d’Arts, Nantes, 2019
© Éditions Snoeck, Gand, 2019
28 € / 978-94-6161-557-2

L’exposition se propose de mettre en parallèle des œuvres cinématographiques de Charlie Chaplin et des productions des avant-gardes, mêlant extraits de films, peinture, photographie, sculpture et documents. De la découverte de Charlot par Fernand Léger en 1916, au numéro spécial Disque vert de 1924 consacré à Chaplin, en passant par l’invention du concept de “7e art” par Ricciotto Canudo en 1919, qui identifie immédiatement Chaplin comme le premier artiste du médium, l’intérêt des avant-gardes pour ce nouveau moyen d’expression et particulièrement pour Chaplin permet de souligner de nombreuses porosités…
Date de parution : 17/10/2019
Editeur : Snoeck Publishers
Collection : Beaux Arts
Voir commentaire dans Historia: https://www.historia.fr/charlot-dada-en-est-fana
et aussi : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/01/28/chaplin-avant-garde/
Voir aussi un ensemble d’illustrations Dada évoquant Charlot: https://dadarockt.wordpress.com/page/6/?archives-list=1
Et les conseils de la BnF : https://gallica.bnf.fr/conseils/content/dada
Outre le recueil de Philippe Soupault, édité par Plon en 1931 :
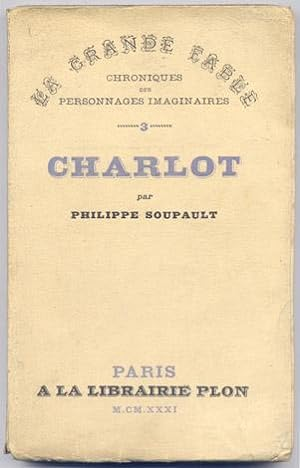
et la revue Le Disque vert :
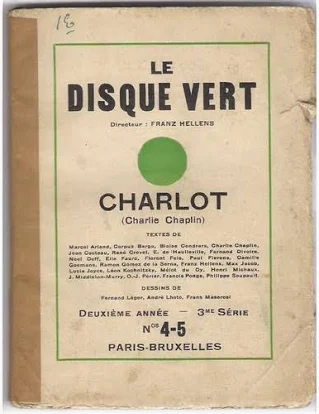
lire « Dadaïsme, surréalisme et chaplinizam, Bojan Jović » dans la revue serbe Nadrealizam : http://nadrealizam.rs/fr/en-focus/recherche-dadaisme-surrealisme-et-chaplinisme
Cahiers Albert Cohen N°25
Albet Cohen : la littérature à l’épreuve
Mathieu Bélisle & Philippe Zard
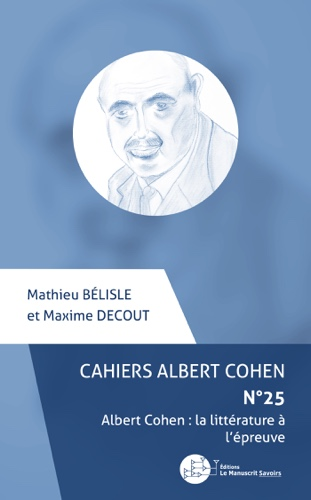
Au nom d’Albert Cohen est attachée l’image d’une œuvre inclassable, qui échappe à toutes nos normes, qui bouscule nos habitudes de lecteur. Radicalité comique, lyrique, polémique : on trouve là une façon souveraine et absolument inattendue de renouveler le genre romanesque. Si l’écrivain a affirmé avoir cessé de lire dans la trentaine, son œuvre est pourtant marquée par ce qui pourrait tenir lieu d’une lutte avec et contre la littérature. Car ses textes regorgent d’allusions, de citations, de parodies, de pastiches, de réécritures parfois dissimulées, parfois affichées, où l’écriture se questionne elle-même dans le miroir de celle des autres. Les études réunies ici auscultent les nombreuses facettes de ce rapport avec la littérature, questionnent le rôle des modèles et contre-modèles, des influences et des inspirations, qui déterminent la manière inédite dont Cohen construit tant son esthétique qu’une éthique de la littérature.
===> Ce volume consigne les communications prononcées au colloque Albert Cohen : la littérature à l’épreuve, les 28 et 29 mai 2015, à Université Lille, sous la direction de Mathieu Bélisle et Maxime Decout. Voici mon intervention :
Je ne sais pas s’il vous est déjà arrivé de lire au début d’un article que l’auteur se référait à, je cite, « la méthode d’Henri Béhar ». C’est assez surprenant, car, si je reconnais avoir tenté de divulguer la méthode Hubert de Phalèse, élaborée collectivement, et dont je ne suis que le vulgarisateur, je n’ai jamais revendiqué une approche de la littérature portant mon nom. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, dit-on !
Au cours de ma carrière active, j’ai tenté de systématiser deux manières d’aborder le fait littéraire : la méthode Hubert de Phalèse, d’une part, qui repose sur un certain usage des outils numériques, et l’analyse culturelle des textes, d’autre part. Aujourd’hui, je voudrais les articuler toutes deux à propos de l’œuvre d’Albert Cohen, en montrant comment, partant de l’estomac, celui-ci en arrive à traiter de l’interdépendance de toutes les parties du corps, et donc, à l’instar de Rabelais, à la pensée.
La méthode Hubert de Phalèse fut mise au point avec mes étudiants à partir des années quatre vingt du siècle passé1. Elle comporte plusieurs phases successives, indispensables, à mes yeux, pour qui veut étudier un texte à la lettre. Ensuite, vient le moment de construire un dictionnaire caractéristique du vocabulaire de l’auteur, et, plus précisément, des mots difficiles (je veux dire par là qu’ils sont inconnus de l’élève idéal du secondaire, auquel le professeur est censé s’adresser) ou dont le contexte modifie le sens usuel.
En un mot, il s’agit, à l’aide de l’outil informatique, de rechercher systématiquement les termes impliqués par ce vocabulaire, de prélever les occurrences dans leur contexte, de constituer une sorte de dictionnaire, sans omettre les nuances de chaque emploi. La mise en série permet de signaler les variations les plus subtiles d’un terme, de voir comment il contraste avec son entourage.
Même si la démarche est automatisée, il n’y a rien de mécanique ici, puisque l’objectif final est bien d’interpréter un texte, d’en venir à une herméneutique intégrale de l’œuvre-vie d’Albert Cohen. J’ajoute que les citations prélevées exigent un va et vient : de la table à la bouche, de la nourriture au texte, et réciproquement.
De même que pour la méthode Hubert de Phalèse, j’ai, à plusieurs reprises, tenté de codifier la méthode d’analyse culturelle des textes2. Le simple énoncé des termes dit comment il faut comprendre la chose.
Mais, direz-vous, dès lors qu’un texte est écrit en bon français, comme l’est à première vue celui d’Albert Cohen, pourquoi parler d’analyse culturelle ? Cohen n’est-il pas, quelle que soit la nationalité inscrite sur son passeport, un digne représentant de notre littérature ?
Certes ! Toutefois, comme pour tout écrivain français ou francophone, son œuvre ne saurait se passer de nos analyses.
Ici, je dois vous faire part de la rage qui m’a pris à la lecture de certaines informations erronées trouvées sur Internet et même dans certains livres prétendus savants. Ainsi, une lectrice sensible à la beauté du Livre de ma mère prétend-elle « interpréter » un passage, qu’elle cite tout du long, en lui adjoignant la recette de l’agneau à la grecque. Bon ça ! mais le malheur est que la recette mélange la viande et le fromage, ce que la maman du petit Albert, Madame Louise Cohen, qui n’ignorait aucun des préceptes de sa religion (qu’elle transmit oralement à son fils) n’eut jamais fait cela ! Etre circonspect, il le faut toujours. Nul besoin d’être circoncis pour le savoir ! Est-ce trop demander que d’exiger qu’une personne qui ajoute son grain de sel à l’admirable prose de l’écrivain, de se renseigne un peu avant d’écrire, et surtout que, catholique, elle lise l’Ancien Testament, chose recommandée par le Pape lui-même, depuis Vatican II, indispensable pour la compréhension de la littérature française ! Les athées ne s’y trompent pas, quant à eux.
Tel autre nous procure la recette de la moussaka de la même façon, en prétendant suivre celle de Mangeclous, mais en y ajoutant une sauce béchamel qui n’est pas dans le texte, qui n’a rien à y voir, toujours en raison des interdits alimentaires consignés dans le Lévitique, transmis de génération en génération par les femmes !
Tel autre encore, autoproclamé spécialiste d’Albert Cohen, trouve dans le parler de Mariette, la vieille bonne suisse, des traces de judéo-espagnol et de yiddish, là où ne sont que des mots du vocabulaire rhéto-roman, plus précisément du romanche, une des quatre langues officielles de la Suisse !
C’est dire qu’il ne suffit ni de bonne volonté, ni de diplômes universitaires, pour comprendre, aujourd’hui, ce que Cohen a voulu signifier, consciemment ou non. Voilà pourquoi je me suis senti obligé de recommander, à nouveau, une analyse culturelle des textes d’Albert Cohen, assistée par ordinateur, dont je donnerai ici une brève illustration.
Originaire de Corfou, Albert Cohen invite le lecteur à la table de son enfance. Comme tous les orientaux, ce juif séfarade ne se contente pas d’y faire servir les plats de sa tradition familiale : il les nomme, les décrit, il va même jusqu’à en donner la recette ! Et ceci pour être certain d’être bien compris. Sa littérature n’est pas seulement nourrissante intellectuellement : comme l’œuvre rabelaisienne, elle enseigne tout un univers moral et politique en flattant Messere Gaster.
Pour rester dans le délai imparti, je me bornerai ici à l’étude de trois éléments : la culture biblique ; la fête ; la langue.
Mangeclous est le Panurge des temps modernes. Pour comprendre son comportement, pour goûter (c’est le cas de le dire) la nourriture qu’évoque Albert Cohen dans ses livres, il faut s’imprégner d’un minimum de la culture « israélite » (pour employer son vocabulaire, du temps de la III’ République).
Héritier de la caste sacerdotale, comme son nom l’atteste, baigné de culture rabbinique par un père romaniote, nous dit-on ; fortement attaché à sa mère, la gardienne de la Loi, il mentionne, comme en passant, ce qui conditionne l’appréhension du monde par ses personnages. Ainsi Saltiel le sage écrit-il à son neveu Solal qu’à Londres les autobus « ont la couleur de la viande saignante, abomination aimée des païens, et si tu te maries comme mon cœur le désire, recommande à ta délicieuse épouse de bien saler la viande et même de la laver avant de la cuire afin d’en ôter le sang qui pourrait y rester » (Val.275). Cette sainte horreur du sang – la vie – est conforme aux règles du Lévitique (17.10-16), et à leurs conséquences pratiques consignées dans La Table dressée (Choulhan Aroukh), le code alimentaire élaboré à Safed au xvie siècle par Joseph Caro. C’est la raison pour laquelle Mangeclous étalant la nourriture pour le pique-nique sort des « saucisses de bœuf garanties de stricte observance » (BDS, 559). De bœuf, donc, car ses amis ne sauraient manger du porc, interdit par la religion. Lui-même s’accorde bien « Quelques tranches de jambon, qui est la partie pure et israélite du porc » (BDS, 216), ou encore « Comment, tu manges du porc ? souffla Salomon épouvanté. – Le jambon est la partie juive du porc, dit Mangeclous » (Val.253) plutôt par provocation, geste d’un esprit fort !
À Londres même, Mangeclous et ses cousins ne consomment que des nourritures dites cacher, admises par la Loi. Il sort de deux couffins ce petit en-cas qu’il s’est procuré chez un juif levantin :
« Quatre paires de boutargues dont par droit léonin je me réserve la moitié ! Pas d’opposition ? Adopté ! Douze gros calmars frits et croustillants mais un peu résistants à la dent, ce qui en augmente le charme ! Huit pour moi car ils sont ma passion suprême ! œufs durs à volonté, cuits durant toute une journée dans de l’eau garnie d’huile et d’oignons frits afin que le goût traverse ! Ainsi m’assura le noble épicier traiteur et coreligionnaire, que Dieu le bénisse, amen ! …Allons, messieurs, à table ! Branle-bas de mangement ! » (BDS, 559)
Tous ces produits, venus du bassin méditerranéen, sont l’arrière-plan sur la table religieusement dressée par Albert Cohen qui, cela mérite d’être noté, n’emploie aucun nom local pour les dénommer, à l’exception du loucoum, lui-même dans une graphie très francisée. Portant barbe et calotte, voyez-les manger, ces cousins de Céphalonie, l’île mythique qui n’a évidemment rien à voir avec l’actuelle Corfou !
Il ne faut pas s’y méprendre : en dépit de leur constante fantaisie, les Valeureux sont bien de leur époque, ils louent le Dieu unique et sont naturellement religieux. Ainsi lorsque Solal évoque son enfance (tout comme le narrateur), c’est au premier soir de la fête commémorant la sortie d’Égypte qu’il songe, décrivant au style indirect libre chaque étape du repas rituel (lui-même conçu pour marquer chaque épisode du récit historique) y mêlant mot pour mot le texte sacré :
« …ô mon enfance à Céphalonie ô la Pâque le premier soir de la Pâque mon seigneur père remplissait la première coupe puis il disait la bénédiction, dans Ton amour pour nous Tu nous as donné cette Fête des Azymes anniversaire de notre délivrance souvenir de la Sortie d’Égypte sois béni Éternel qui sanctifies Israël, j’admirais sa voix après c’était l’ablution des mains après c’était le cerfeuil trempé dans le vinaigre après c’était le partage du pain sans levain après c’était la narration mon seigneur père soulevait le plateau il disait voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d’Égypte quiconque a faim vienne manger avec nous que tout nécessiteux vienne célébrer la Pâque avec nous cette année nous sommes ici l’année prochaine dans le pays d’Israël cette année nous sommes esclaves l’année prochaine peuple libre, ensuite parce que j’étais le plus jeune je posais la question prescrite en quoi ce soir est-il différent des autres soirs pourquoi tous les autres soirs mangeons-nous du pain levé et ce soir du pain non levé j’étais ému de poser la question à mon seigneur père alors il découvrait les pains sans levain il commençait l’explication en me regardant et je rougissais de fierté il disait nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte et l’Éternel notre Dieu nous en a fait sortir par Sa main puissante et Son bras étendu, » (BDS, XCIV, 753)
Je n’ai pas l’intention d’expliquer mot à mot ce morceau d’anthologie sans ponctuation, ni de fournir une analyse sémiotique de la cérémonie1. Cependant, le lecteur, faute d’avoir assisté à ce repas de fête, doit en connaître le substrat, un certain nombre d’indications relevant de ce que l’on peut, à bon droit, nommer la culture juive, à commencer par l’autre nom que les juifs donnent à cette cérémonie, la fête des Azymes (hag amatsot).
Tout d’abord, il faut savoir que la fête de Pâque commémore plusieurs événements en même temps, traditionnels d’une part, historiques de l’autre. Elle revêt une double signification, fête agreste à l’origine, elle est devenue fête commémorative de la sortie d’Égypte.
Solal se remémore le rituel du dîner familial, le premier soir de la Pâque. En français, on écrit Pâque au féminin singulier, ce vocable étant supposé transcrire le mot hébreu Pessach, qui désigne le passage de l’ange de la mort, qui épargna les maisons des hébreux quand Dieu fit mourir les premiers nés d’Égypte. L’accent circonflexe porte la trace du S étymologique (en latin et en grec). Il est devenu facultatif depuis une réforme (manquée comme elles le sont toutes) de l’orthographe. L’expression la Pâque juive, opposée à la fête chrétienne de Pâques, sonne comme un pléonasme, en tout cas par écrit, puisque l’article défini et l’absence de s final devraient suffire à démarquer les deux religions. Hélas, la question se complique avec la fête célébrée par les Églises orthodoxes (grecques et russes) qui usent de la même graphie que les juifs ! De ce fait, la précision s’impose parfois, au risque de la redondance. Ici, Albert Cohen aurait pu translittérer le mot hébreu Pessah, en raison du contexte évoqué. Mais nous avons vu qu’il tend à réduire au strict minimum les emprunts lexicaux, surtout les emprunts à l’hébreu.
Ensuite, la table est mise. La mère a allumé les bougies, elle a disposé au centre un plateau contenant une côte d’agneau grillée, symbole de l’offrande pascale, l’holocauste, l’animal autrefois sacrifié, avant la destruction du Temple ; un œuf dur, symbole du deuil, en souvenir de la destruction du Temple ; les herbes amères (maror) rappelant les dures conditions de l’esclavage ; le harosset (mortier) représentant les travaux de construction auxquels les hébreux étaient soumis en Égypte ; trois matsot commémorant la sortie d’Égypte ; et quatre coupes de vin qui seront bues à différentes étapes de la soirée, les hommes étant accoudés sur le côté gauche, en signe de liberté.
N’ayons garde d’oublier la place vacante, réservée au prophète Élie, supposé devoir annoncer la venue du Messie. En cette attente, elle peut être occupée par un pauvre.
Les rabbins comptent 15 étapes dans le déroulement de la soirée. Solal n’en retient que la moitié. Permettez-moi de vous y renvoyer.
Tout en évoquant ses souvenirs d’enfance, avec tout ce qu’ils comportent d’affectif, Solal relève le caractère pédagogique de cette mise en scène commémorative. En même temps, il y célèbre la mémoire de son père, sa belle voix de cantor. La locution « le seigneur père » détone en français. C’est un calque du judéo-italien parlé par la mère, aussi bien que du judéo-espagnol généralement pratiqué par les colonies juives en Grèce.
Ce père majestueux n’est donc pas exactement celui de l’écrivain, mais on ne peut se dispenser d’y voir un hommage à celui qu’il a fort mal traité dans l’ensemble de son œuvre, au profit de la Mère.
Malgré la précision du souvenir, et le déroulement rigoureux de la cérémonie, le Narrateur (et par voie de conséquence Solal) en a omis un certain nombre de phases, notamment celle, tragique, qui nomme les dix plaies d’Égypte, dont les Hébreux furent épargnés. Les assistants détournent le visage de la table, le père, tout en lisant à haute voix, verse de l’eau d’une aiguière pour symboliser le miracle divin.
1. Celle-ci nous a été fournie, magistralement, par Jean-Pierre Goldenstein dans Lingistique et discours littéraire, théorie et pratique des textes, Paris, Larousse, 1983, 351 p.
Or, les deux livres mentionnés ont paru après ce qu’on nomme improprement l’Holocauste ou, tout aussi mal, la Shoah (anéantissement en hébreu) ou encore le génocide. Après l’esclavage millénaire, le Narrateur écrit dans la mémoire de la destruction massive : « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz, et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêtés à Nice, gazés à Auschwitz » (Val.225).
C’est le même qui, dans un cauchemar, voit sa mère dans la France occupée, ramassant dans la rue de vieilles hardes pour les mettre dans une valise contenant une étoile jaune (LM, 114). Le même encore, qui se remémore la disparition de sa mère à Marseille, tandis qu’il était à Londres.
Impossible de rien comprendre aux sentiments et aux comportements des uns et des autres si l’on ne voit qu’ils se détachent sur un tel arrière-plan. Mais il y a plus, et sans doute plus intimement inscrit dans leur chair. C’est que, s’ils n’ont pas connu la persécution directe ni la Shoah (ce vocable est absent de Belle du Seigneur et des Valeureux), ils savent ce que furent les pogroms que subirent toutes les communautés juives de Russie, de Pologne ou de l’Empire ottoman. Par-delà ses risibles manies, c’est bien ce qui pousse Mangeclous et ses coreligionnaires à l’accumulation de nourritures, en dépit du côté tartarinesque de l’action :
« Les Juifs se hâtèrent de faire sceller des barreaux à leurs fenêtres et amassèrent, tout comme en temps de pogrome, force provisions : farine, pommes de terre, pains azymes, macaronis, pains de sucre, œufs, saucisses de bœuf, chaînes de piments, d’oignons et d’aulx, boulettes de tomates séchées au soleil et marinées dans l’huile, graisse d’oie et jarres d’eau, viandes fumées, purgatifs et médicaments. » (Mangeclous, 88)
En somme, l’œuvre carnavalesque ne s’explique que par son contraire, l’évocation de la mort programmée. Non point la mort naturelle de l’homme, mais celle qui a été décidée au nom d’on ne sait quelles aberrations de l’esprit, lors de ladite Conférence de Wannsee, le 22 janvier 1942.
La veillée de Pâque s’achève par des chants traditionnels, à valeur pédagogique et morale. Il se nomme Had gadia (en hébreu, ou plus exactement, en araméen), et raconte l’histoire d’un petit chevreau que mon père m’a acheté pour deux blanchets. Et le chat est venu, qui a mangé le petit chevreau que mon père m’a acheté pour deux blanchets. Et vint le chien qui mordit le chat qui mangea le petit chevreau que mon père m’acheta pour deux blanchets. Puis vint le bâton qui frappa le chien qui mordit le chat… La kyrielle se poursuit jusqu’à l’arrivée de l’ange de la mort, qui égorge le sacrificateur qui a tranché la vie du bœuf, etc. Mais ce n’est pas le dernier mot : enfin vint Dieu, béni soit-il, qui égorgea l’ange de la mort qui… pour deux blanchets.
On voit quelle morale les petits enfants peuvent en tirer, et même les adultes, comprenant que nul n’occupe une place qui ne puisse lui être contestée par plus fort que lui.
Cette comptine, à proprement parler, de tradition séfarade, est chantée en judéo-espagnol, mais aussi en hébreu et en yiddish. Dans son récit, Solal ne semble pas s’en souvenir. Néanmoins, l’ange de la mort est évoqué à plusieurs reprises par les Valeureux. Ainsi Mangeclous explique l’avarice de Mattathias par la peur que lui procure l’idée de l’ange de la mort :
« De plus je comprends pourquoi il ne stocke jamais d’épices, c’est parce que s’il venait tout à coup à défaillir dans les bras de l’ange de la mort et des épouvantements il resterait en sa cuisine du sel ou du poivre et ce serait du gaspillage […]! » (BDS, 746)
Et voici sur la table toutes les senteurs, toutes les saveurs, toutes les splendeurs de la cuisine judéo-balkanique qui vous pénètrent, répandant le plaisir, la joie de vivre, même dans les jours les plus noirs, car sa leçon est toujours la même : « lehaim » à la vie, dit-il, levant symboliquement son verre de vin.
Lire toute l’œuvre d’Albert Cohen à partir des plats qu’il évoque, ce n’est pas seulement se déplacer dans son univers imaginaire, c’est aussi approcher son mode de création et caractériser de la même façon les individus auxquels il insuffle un relief, une vie spirituelle sans équivalent, tant la nourriture est consubstantielle à l’individu. Tel le Dieu unique qu’ils prient quotidiennement, pour eux, l’esprit et la matière ne font qu’un.
Ne nous y trompons pas : la langue d’Albert Cohen, savamment travaillée, est un français recherché, qui refuse la couleur locale. Ce n’est pas un guide touristique ni culinaire. Pas de tarama, pas de dolma, pas de fila ni de beureks, pas d’albondigas, pas de boyos ni de yaprak, aucun de ces termes qui abondent dans les livres de cuisine ou même dans les mémoires des Séfarades. C’est pourquoi il faut se référer aux craquelins, aux feuilles de vigne (Val.249), aux boulettes et autres feuilletés, etc. De telle sorte qu’on se croirait à la table de La Reynière, tout surpris de découvrir une cuisine à l’huile où l’aubergine et la tomate sont reines. Exceptions notables : le raki offert par Aude à Saltiel (Solal, 233) ; le loucoum, la moussaka et le cascaval, peut-être parce qu’il s’agit là de noms et de produits d’origine turque ? Et enfin le halva, terme authentiquement turc, prononcé du bout des lèvres par Ariane, prémices de la discorde entre les amants (qui auraient mieux fait d’en consommer davantage !).
Outre ce souci, légitime, d’employer un français épuré, d’extension universelle, chez un auteur dont la langue maternelle, le judéo-vénitien nous dit-il, n’était pratiquée que par un millier de personnes à Corfou, à l’époque où il y naquit, il y a peut-être celui de renforcer le mythe des Valeureux de France, émancipés par la Révolution française, « faits citoyens français parfaits par l’effet du charmant décret de l’Assemblée nationale du vingt-sept septembre 1791 » selon Saltiel, fiers de le rester et d’entretenir « le doux parler » de notre pays.
En tout état de cause, l’absence remarquable du vocabulaire étranger, le refus de l’emprunt témoignent du souci d’assimilation, voire d’intégration, de la part d’Albert Cohen. Intégration réussie, non seulement par sa carrière de haut fonctionnaire international, mais encore comme écrivain français.
N’oublions pas qu’il est un immigré, juif de surcroît, ce qu’il ne risque pas d’oublier, comme en témoigne la scène du camelot antisémite, l’injuriant et le désignant à la vindicte publique le jour anniversaire de ses dix ans (Ô vous, frères humains, p. 38), scène indélébile, qui revient à plusieurs reprises et ne sera jamais oubliée puisqu’il en traitera encore passé ses 80 ans (Carnets 1978, p. 19). Scène fondatrice, symbolique, lui révélant l’impossibilité de toute assimilation. Ce n’est pas exactement la leçon qu’il en tire, de même que Swann évincé du clan des Verdurin ne croit pas un instant que son éviction puisse provenir de sa judéité, lui qui, parallèlement, est reçu et même réclamé par le Faubourg Saint-Germain. Tout lecteur de bonne foi, parvenu à la fin d’À la Recherche du temps perdu, c’est-à-dire au Temps retrouvé, ne manquera pas de s’en rendre compte1. Reste que la question de l’assimilation ne manque pas d’être toujours actuelle, et que, par la contradiction qu’elle comporte en elle-même, elle confère une grande richesse à l’œuvre qui en est issue.
===> La troisième partie de cette communication a été reprise, avec une entrée en matière différente, dans mon volume: Essai d’analyse culturelle des textes, Classiques Garnier, 2022, p. 123-131.
1. Voir ma préface à Du côté de chez Swann, éd. Pocket.
Par la suite, je devais reprendre les mêmes arguments en guise de présentation du volume à table avec Albert Cohen, au Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, le 17 janvier 2016. Divers incidents techniques, dont l’annonce de cette séance le matin même par courriel, firent que je m’en tins à des considérations générales, en me prêtant aux questions des auditeurs, sous la présidence du professeur Haïm Vidal-Séphia.
Durant toute mon activité d’enseignant-chercheur, j’ai tenté de systématiser deux manières d’aborder le fait littéraire : la méthode Hubert de Phalèse, d’une part, qui repose sur un certain usage des outils numériques ; l’analyse culturelle des textes, d’autre part, qui, comme son nom l’indique, postule que tout texte convoque différentes cultures. Aujourd’hui, je voudrais les articuler toutes deux à propos de l’œuvre d’Albert Cohen, en montrant comment, partant de l’estomac, celui-ci en arrive à traiter de l’interdépendance de toutes les parties du corps, et donc, à l’instar de Rabelais, à la pensée.
***
La méthode Hubert de Phalèse fut mise au point, avec mes étudiants, à partir des années quatre vingt du siècle passé. Elle comporte plusieurs phases successives, indispensables, à mes yeux, pour qui veut étudier un texte à la lettre.
En bref, il s’agit, aidé de l’outil informatique, et pourvu que l’oeuvre soit entièrement numérisée, de rechercher systématiquement les termes impliqués par ce vocabulaire, de prélever les occurrences dans leur contexte, de constituer une sorte de dictionnaire, sans omettre les nuances de chaque emploi.
Même si la démarche est automatisée, il n’y a rien de mécanique ici, puisque l’objectif final est bien d’interpréter un texte, d’en venir à une herméneutique intégrale de l’œuvre-vie d’Albert Cohen. J’ajoute que les citations prélevées exigent un va et vient : de la table à la bouche, de la nourriture au texte, et réciproquement.
***
De même que pour la méthode Hubert de Phalèse, j’ai, à plusieurs reprises, tenté de codifier la méthode d’analyse culturelle des textes. Le simple énoncé des termes dit comment il faut comprendre la chose.
Mais, direz-vous, dès lors qu’un texte est écrit en bon fiançais, comme l’est à première vue celui d’Albert Cohen, pourquoi parler d’analyse culturelle ? Cohen n’est-il pas, quelle que soit la nationalité inscrite sur son passeport, un digne représentant de notre littérature ?
Certes ! Toutefois, comme pour tout écrivain français ou francophone, son œuvre ne saurait se passer de nos analyses.
***
Ici, je dois vous faire part de la rage qui m’a pris à la lecture de certaines informations erronées trouvées sur Internet. Ainsi, une lectrice sensible à la beauté du Livre de ma mère prétend « interpréter » un passage, qu’elle cite tout du long, en lui adjoignant la recette de l’agneau à la grecque. Bon ça ! mais le malheur est que la recette mélange la viande et le fromage, ce que Madame Louise Cohen, qui n’ignorait aucun des préceptes de sa religion (qu’elle transmit oralement à son fils) n’eut jamais fait cela ! Est-ce trop demander que de souhaiter qu’une personne qui ajoute son grain de sel à l’admirable prose de l’écrivain, se renseigne un peu avant d’écrire, et surtout que, catholique, comme elle me l’a confessé, elle lise l’Ancien Testament, chose recommandée par le Pape lui-même, indispensable pour la compréhension de la littérature française !
Tel autre nous procure, de la même façon, la recette de la moussaka, en prétendant suivre celle de Mangeclous, mais en y ajoutant une sauce béchamel qui n’est pas dans le texte, qui n’a rien à y voir, toujours en raison des interdits alimentaires transmis de génération en génération par les femmes !
C’est dire qu’il ne suffit ni de bonne volonté, ni de diplômes universitaires, pour comprendre, aujourd’hui, ce que Cohen a voulu signifier, consciemment ou non. Voilà pourquoi je me suis senti obligé de recommander, à nouveau, une analyse culturelle des textes d’Albert Cohen, assistée par ordinateur, dont je donnerai ici une brève illustration.
***
Pour rester dans le délai qui m’est imparti, je me bornerai ici à l’étude de trois éléments : la culture biblique ; la fête ; la langue.
Mangeclous est le Panurge des temps modernes. Pour comprendre son comportement, pour goûter (c’est le cas de le dire) la nourriture qu’évoque Albert Cohen dans ses livres, il faut s’imprégner d’un minimum de la culture « israélite » (pour employer son vocabulaire, du temps de la IIIe République).
Héritier de la caste sacerdotale, comme son nom l’atteste, baigné de culture rabbinique par un père romaniote ; fortement attaché à sa mère, la gardienne de la Loi, il mentionne, comme en passant, ce qui conditionne l’appréhension du monde par ses personnages. Ainsi Saltiel le sage écrit-il à son neveu Solal qu’à Londres les autobus « ont la couleur de la viande saignante, abomination aimée des païens, et si tu te maries comme mon cœur le désire, recommande à ta délicieuse épouse de bien saler la viande et même de la laver avant de la cuire afin d’en ôter le sang qui pourrait y rester » (Val. 275). Cette sainte horreur du sang – la vie – est conforme aux règles du Lévitique (17.10-16), et à leurs conséquences pratiques consignées dans La Table dressée (Choulhan Aroukh), le code éthique élaboré à Safed au xvie siècle par Joseph Caro. C’est la raison pour laquelle Mangeclous, en étalant la nourriture pour le pique-nique, sort des « saucisses de bœuf garanties de stricte observance » (BDS, 559). De bœuf, donc, car ses amis ne sauraient manger du porc, interdit par la religion. Lui-même s’accorde bien « Quelques tranches de jambon, qui est la partie pure et israélite du porc » (BDS, 216), ou encore « Comment, tu manges du porc ? souffla Salomon épouvanté. – Le jambon est la partie juive du porc, dit Mangeclous » (Val.253), plutôt par provocation, geste d’un esprit fort !
À Londres même, Mangeclous et ses cousins ne consomment que des nourritures cacher, admises par la Loi. Il sort de deux couffins ce petit en-cas qu’il s’est procuré chez un juif levantin :
« Quatre paires de boutargues dont par droit léonin je me réserve la moitié ! Pas d’opposition ? Adopté ! Douze gros calmars frits et croustillants mais un peu résistants à la dent, ce qui en augmente le charme ! Huit pour moi car ils sont ma passion suprême ! œufs durs à volonté, cuits durant toute une journée dans de l’eau garnie d’huile et d’oignons frits afin que le goût traverse ! Ainsi m’assura le noble épicier traiteur et coreligionnaire, que Dieu le bénisse, amen ! …Allons, messieurs, à table ! Branle-bas de mangement ! » (BDS, 559)
Tous ces produits, venus du bassin méditerranéen, sont l’arrière-plan sur la table religieusement dressée par Albert Cohen. qui, cela mérite d’être noté, n’emploie aucun nom local pour les dénommer, à l’exception du loucoum, lui-même dans une graphie francisée (avec un C pour K). Portant barbe et calotte, voyez-les manger, ces cousins de Céphalonie, l’île mythique qui n’a évidemment rien à voir avec l’actuelle Corfou !
En dépit de leur constante fantaisie, les Valeureux sont bien de leur époque. Ils louent le Dieu unique et sont naturellement religieux. Ainsi lorsque Solal évoque son enfance (tout comme le narrateur), c’est au premier soir de la fête commémorant la sortie d’Égypte qu’il songe, décrivant au style indirect libre chaque étape du repas rituel (lui-même conçu pour marquer chaque épisode du récit historique) y mêlant mot pour mot le texte sacré :
« …ô mon enfance à Céphalonie ô la Pâque le premier soir de la Pâque mon seigneur père remplissait la première coupe puis il disait la bénédiction, dans Ton amour pour nous Tu nous as donné cette Fête des Azymes anniversaire de notre délivrance souvenir de la Sortie d’Égypte sois béni Éternel qui sanctifies Israël,…j’admirais sa voix après c’était l’ablution des mains après c’était le cerfeuil trempé dans le vinaigre après c’était le partage du pain sans levain après c’était la narration mon seigneur père soulevait le plateau il disait voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d’Égypte quiconque a faim vienne manger avec nous que tout nécessiteux vienne célébrer la Pâque avec nous cette année nous sommes ici l’année prochaine dans le pays d’Israël cette année nous sommes esclaves l’année prochaine peuple libre, ensuite parce que j’étais le plus jeune je posais la question prescrite en quoi ce soir est-il différent des autres soirs pourquoi tous les autres soirs mangeons-nous du pain levé et ce soir du pain non levé j’étais ému de poser la question à mon seigneur père alors il découvrait les pains sans levain il commençait l’explication en me regardant et je rougissais de fierté il disait nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte et l’Éternel notre Dieu nous en a fait sortir par Sa main puissante et Son bras étendu, » (BDS, XCIV, 753)
Je n’ai pas l’intention d’expliquer mot à mot ce morceau d’anthologie, non ponctué, ni de fournir une analyse sémiotique de la cérémonie. Cependant, le lecteur, faute d’avoir assisté à ce repas de fête, doit en connaître le substrat, un certain nombre d’indications relevant de ce que l’on peut, à bon droit, nommer la culture juive, à commencer par l’autre nom que les juifs donnent à cette cérémonie, la fête des Azymes (hag amatsot).
Tout d’abord, il faut savoir que la fête de Pâque commémore plusieurs événements en même temps : traditionnels d’une part, historiques de l’autre. Elle revêt une double signification, fête agreste à l’origine, elle est devenue fête commémorative de la sortie d’Égypte.
Ensuite, la table est mise. La mère a allumé les bougies, elle a disposé au centre un plateau contenant une côte d’agneau grillée, symbole de l’offrande pascale, l’holocauste, l’animal autrefois sacrifié, avant la destruction du Temple ; un œuf dur, symbole du deuil, en souvenir de la destruction du Temple ; les herbes amères (maror) rappelant les dures conditions de l’esclavage ; le harosset (mortier) représentant les travaux de construction auxquels les hébreux étaient soumis en Égypte ; trois matsot commémorant la sortie d’Égypte ; et quatre coupes de vin qui seront bues à différentes étapes de la soirée, les hommes étant accoudés sur le côté gauche, en signe de liberté.
N’ayons garde d’oublier la place vacante, réservée au prophète Élie, supposé devoir annoncer la venue du Messie. En cette attente, elle peut être occupée par un pauvre.
Les rabbins comptent 15 étapes dans le déroulement de la soirée. Solal n’en retient que la moitié. Permettez-moi de vous y renvoyer.
Tout en évoquant ses souvenirs d’enfance, avec tout ce qu’ils comportent d’affectif, Solal relève le caractère pédagogique de cette mise en scène commémorative. En même temps, il y célèbre la mémoire de son père, sa belle voix de cantor. La locution « le seigneur père » détone en français. C’est un calque du judéo-italien parlé par la mère, aussi bien que du judéo-espagnol majoritairement pratiqué par les colonies juives en Grèce.
Ce père majestueux n’est donc pas exactement celui de l’écrivain, mais on ne peut se dispenser d’y voir un hommage à celui qu’il a fort mal traité dans l’ensemble de son œuvre, au profit de la Mère.
Malgré la précision du souvenir, et le déroulement rigoureux de la cérémonie, le Narrateur en a omis un certain nombre de phases, notamment celle, tragique, qui nomme les dix plaies d’Égypte, dont les Hébreux furent épargnés. Les assistants détournent le visage de la table, le père, tout en lisant à haute voix, verse de l’eau d’une aiguière pour symboliser le miracle divin.
Or, les deux livres précédemment invoqués ont paru après ce qu’on nomme la Shoah (anéantissement, en hébreu) ou encore le génocide. Après l’esclavage millénaire, le Narrateur écrit dans la mémoire de la destruction massive : « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz, et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêtés à Nice, gazés à Auschwitz » (Val.225).
C’est le même qui, dans un cauchemar, voit sa mère dans la France occupée, ramassant dans la rue de vieilles hardes pour les mettre dans une valise contenant une étoile jaune (LM, 114). Le même encore, qui se remémore la disparition de sa mère à Marseille, tandis qu’il était à Londres.
Impossible de rien comprendre aux sentiments et aux comportements des uns et des autres si l’on ne voit qu’ils se détachent sur un tel arrière-plan. Mais il y a plus, et sans doute plus intimement inscrit dans leur chair. C’est que, s’ils n’ont pas connu la persécution directe ni la Shoah (le mot est absent de Belle du Seigneur et des Valeureux), ils savent ce que furent les pogroms que subirent toutes les communautés juives de Russie, de Pologne ou de l’Empire ottoman. Par-delà ses risibles manies, c’est bien ce qui pousse Mangeclous et ses coreligionnaires à l’accumulation de nourritures :
« Les Juifs se hâtèrent de faire sceller des barreaux à leurs fenêtres et amassèrent, tout comme en temps de pogrome, force provisions : farine, pommes de terre, pains azymes, macaronis, pains de sucre, œufs, saucisses de bœuf, chaînes de piments, d’oignons et d’aulx, boulettes de tomates séchées au soleil et marinées dans l’huile, graisse d’oie et jarres d’eau, viandes fumées, purgatifs et médicaments. » (Mangeclous, 88)
En somme, l’œuvre carnavalesque ne s’explique que par son contraire, l’évocation de la mort programmée. Non point la mort naturelle de l’homme, mais celle qui a été décidée au nom d’on ne sait quelles aberrations de l’esprit, lors de la Conférence de Wannsee, le 22 janvier 1942.
La veillée de Pâque s’achève par des chants traditionnels, à valeur pédagogique et morale. L’un d’entre eux se nomme Had gadia. On voit quelle morale les enfants peuvent en tirer, et même les adultes, comprenant que nul n’occupe une place qui ne puisse lui être contestée par plus fort que lui, par le Tout-Puissant pour finir. L’ange de la mort est évoqué à plusieurs reprises par les Valeureux.
***
Et voici sur la table toutes les senteurs, toutes les saveurs, toutes les splendeurs de la cuisine judéo-balkanique qui vous pénètrent, répandant le plaisir, la joie de vivre, même dans les jours les plus noirs, car la leçon est toujours la même : « lehaim » à la vie, dit le père, levant symboliquement son verre de vin.
Lire toute l’œuvre d’Albert Cohen à partir des plats qu’il évoque, ce n’est pas seulement se déplacer dans son univers imaginaire, c’est aussi approcher son mode de création et caractériser de la même façon les individus auxquels il insuffle un relief, une vie spirituelle sans équivalent, tant la nourriture est consubstantielle à l’individu. Tel le Dieu unique qu’ils prient quotidiennement, pour eux, l’esprit et la matière ne font qu’un.
Ne nous y trompons pas : la langue d’Albert Cohen, savamment travaillée, est un français recherché, qui refuse la couleur locale. Ce n’est pas un guide touristique ni culinaire. Pas de tarama, pas de dolma, pas de fila ni de beureks, pas d’albondigas, pas de boyos ni de yaprakes, aucun de ces termes qui abondent dans les livres de cuisine ou même dans les mémoires des Séfarades. C’est pourquoi il faut se référer aux craquelins, aux feuilles de vigne (Val.249), aux boulettes et autres feuilletés, etc. De telle sorte qu’on se croirait à la table de La Reynière, tout surpris de découvrir une cuisine à l’huile où l’aubergine et la tomate sont reines. Exceptions notables : le raki offert par Aude à Saltiel (Solal, 233) ; le loucoum, la moussaka et le cascaval, peut-être parce qu’il s’agit là de noms et de produits d’origine turque ? Et enfin le halva, terme authentiquement turc, prononcé du bout des lèvres par Ariane, prémices de la discorde entre les amants (qui auraient mieux fait d’en consommer davantage !).
Outre ce souci, légitime, d’employer un français épuré, d’extension universelle, chez un auteur dont la langue maternelle, le judéo-vénitien nous dit-il, n’était pratiquée que par un millier de personnes à Corfou, à l’époque où il y naquit, il y a peut-être celui de renforcer le mythe des Valeureux de France, émancipés par la Révolution française, « faits citoyens français parfaits par l’effet du charmant décret de l’Assemblée nationale du vingt-sept septembre 1791 » selon Saltiel, fiers de le rester et d’entretenir « le doux parler » de notre pays.
En tout état de cause, l’absence remarquable du vocabulaire étranger, le refus de l’emprunt témoignent du souci d’assimilation, voire d’intégration, de la part d’Albert Cohen. Intégration réussie, non seulement par sa carrière de haut fonctionnaire international, mais encore comme écrivain français.
N’oublions pas qu’il est un immigré, juif de surcroît, ce qu’il ne risque pas d’oublier, comme en témoigne la scène du camelot antisémite, l’injuriant et le désignant à la vindicte publique le jour anniversaire de ses dix ans (Ô vous, frères humains, p. 38), scène indélébile, qui revient à plusieurs reprises et ne sera jamais oubliée puisqu’il en traitera encore passé ses 80 ans (Carnets 1978, p. 19). Scène fondatrice, symbolique, lui révélant l’impossibilité de toute assimilation. Ce n’est pas exactement la leçon qu’il en tire, de même que Swann évincé du clan des Verdurin ne croit pas un instant que son éviction puisse provenir de sa judéité, lui qui, parallèlement, est reçu et même réclamé par le Faubourg Saint-Germain. Tout lecteur de bonne foi, parvenu à la fin d’À la Recherche du temps perdu, c’est-à-dire au Temps retrouvé, ne manquera pas de s’en rendre compte. Reste que la question de l’assimilation ne manque pas d’être toujours actuelle, et que, par la contradiction qu’elle comporte en elle-même, elle confère une grande richesse à l’œuvre qui en est issue.
Henri BÉHAR
Psst ! un auditeur est intervenu pour me dire qu’il se souvenait de sa lecture des Valeureux, il y a 40 ans, et qu’il y avait rencontré le terme almodrote dans la lettre que Mangeclous adresse à la reine d’Angleterre.
Vérification faite, et bien faite, ce terme, désignant une sauce d’origine séfarade, encore employé en Espagne pour désigner diverses compositions, ne se trouve nulle part dans le texte d’Albert Cohen. Outre que cela me rassure sur l’attention que je porte à mon travail, et confirme ma théorie du texte, selon laquelle l’auteur, assimilé, se garde bien de mettre de la couleur locale dans son vocabulaire, il y a là un « témoignage de lecture », pour parler comme les théoriciens, fort révélateur.
Il y a quarante ans, donc, ce lecteur s’éclate en lisant la prose de Mangeclous. Il lit ce paragraphe :
« Avec de la viande hachée, achetée de bon matin, j’ai confectionné des boulettes par l’adjonction de pain azyme finement pilé, d’œufs battus, de persil, de sel et d’une grande quantité de poivre ! D’autre part, j’ai composé une délicieuse sauce en faisant mijoter des piments forts, des oignons et des tomates ! Mais le triple secret est d’employer de l’huile d’olive, de faire mijoter au moins cinq heures à petit feu, et d’ajouter un peu de sucre ! Excellente recette que Vous pourriez essayer ! Sa Majesté le Roi s’en lécherait les doigts ! Naturellement, n’oubliez pas de saler et mettez aussi un peu d’origan ! »
et cela lui rappelle la cuisine maternelle, les keftedes et la sauce d’accompagnement qu’elle nommait almodrote. Cette remémoration, associée à sa lecture, vient donc se superposer au texte de manière indélébile, à tel point qu’il pense ma lecture superficielle, pour ne pas dire erronée ! Je ne lui en suis pas moins reconnaissant d’avoir pris la parole pour confirmer, involontairement peut-être, l’importance que revêt la lecture de certains livres et les mouvements de l’esprit qui l’accompagnent.
Voir à table avec Albert Cohen
http://editionsnonlieu.fr/A-Table-avec-Albert-Cohen?var_recherche=Henri%20BEHAR
Argumentaire : À TABLE AVEC ALBERT COHEN
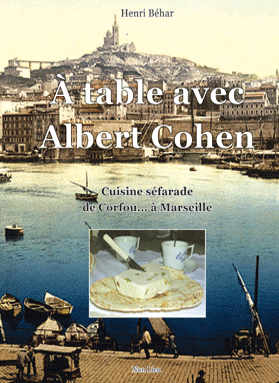
L’ouvrage vise à faire apprécier la littérature d’Albert Cohen à partir des nombreuses références à la nourriture et particulièrement aux plats d’origine judéo-balkanique qu’elle contient. Ce projet fait partie d’un ensemble, plus vaste, d’analyse culturelle des œuvres littéraires. Je pars du principe qu’on ne peut goûter un texte (c’est le cas de le dire) que si l’on en possède les clés, les sources culturelles dans lesquelles l’auteur baigne, inconsciemment parfois. Dans le cas présent, il s’agit de faire entrer la littérature par l’estomac ! On a donc recensé tous les fragments mentionnant cette nourriture, en ne retenant que ceux qui se réfèrent à la culture séfarade (à laquelle il appartenait corps et âme) et, pour en marquer la spécificité, on y joint des recettes. L’ouvrage contient 40 entrées et 20 recettes. Ces recettes sont celles de l’époque évoquée par Albert Cohen dans ses romans, conformes aux règles alimentaires de sa communauté. Il est préférable que l’éditeur fasse appel à un chef cuisinier, capable de préciser la confection de chaque plat et d’en fournir une photo. À défaut, je donne ma propre recette ancestrale, qui coïncide très exactement avec les coutumes alimentaires de Cohen (voir les exemples fournis dans le “manuscrit”). Ainsi, j’indique la manière de cuire les aubergines au feu de bois, comme faisait la mère d’Albert Cohen, ce qui leur donne un fumet qu’on ne retrouve pas dans les recettes actuelles du caviar d’aubergine. Illustration : au minimum photos de 20 plats réalisés. Ajouter des illustrations de magasins d’épices orientales au début du XXe siècle, à Corfou et à Marseille. Plan de l’ouvrage : Introduction, justifie le projet, la méthode et met en garde contre les erreurs répandues par Internet. 1 e partie : Savoir : ce qu’il faut connaître pour comprendre au minimum les usages des personnages et la toile de fond historique à laquelle se réfère l’auteur. 2 e partie : Voir « les marchandises aux fortes odeurs » : bref panorama des nourritures mentionnées, citations à l’appui, sous forme d’entrées de dictionnaire. Cette disposition, essentiellement pratique, peut être réduite et transformée en un texte continu. 3e partie : Cuisiner les « splendeurs orientales » : les plats évoqués dans le texte, parfois avec la recette de Mangeclous, illustrés par une recette pratique. Conclusion : dans mon esprit, ce livre pourrait adopter la maquette d’un ouvrage de cuisine, ne serait-ce que pour amener le lecteur à s’intéresser à cet aspect nutritif de l’œuvre d’Albert Cohen. Henri Béhar


Plaque apposée sur la maison de naissance d’Albert Cohen
Pour information, la maison de naissance d’Albert Cohen à Corfou (2013)
Recension de l’ouvrage par Alain Chevrier dans la revue Europe, mars 2016, n°1043, p. 345-346 :
Voir l’article déjà en ligne sur le site :
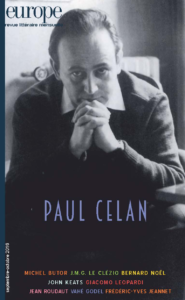
Coïncidence telle qu’on a pu se demander, sérieusement, si Dada était né de la guerre, ou la guerre de Dada. Il est certain que les premiers protagonistes, et non des moindres, voulaient surmonter le conflit international au profit de leur propre liberté de création. Ainsi Hugo Ball, écrivant dans Cabaret Voltaire, premier numéro d’une revue qui annonçait l’avènement de Dada et d’une revue du même nom qui devait : « préciser l’activité de ce Cabaret dont le but est de rappeler qu’il y a, au-delà de la guerre et des patries, des hommes indépendants qui vivent d’autres idéals. »
Pourquoi « Dada » ? Que signifiait ce terme d’allure enfantine ? Qui l’a « inventé » ? Abandonnons toute recherche de paternité, qui n’a plus aucun sens aujourd’hui, mais observons que, par-delà les mots, dans ce contexte historique, c’est l’acte, le geste qui compte, exprimant le ras-le-bol de la jeunesse de tous les pays.
Cent ans après, la commémoration de la bataille de Verdun vient à point nous rappeler ce que fut l’enfer sur terre. Qu’en France, la droite, fidèle à elle-même, en ait profité pour gesticuler, n’a rien de surprenant. En revanche, on reste sidéré de l’accueil fait aux diverses manifestations consacrées à Dada aujourd’hui, ne serait-ce que par la ville de Zurich, la centrale banquière de l’Europe, qui ne nous avait pas habitués à tant de prévenance.
***
On connaît, en gros, les différentes phases de ce mouvement qui vécut dans plusieurs pays, plus précisément dans plusieurs villes (Zurich, Berlin, Cologne, Paris, etc.) entre 1916 et 1923. Étrangement, il répond exactement au principe d’incertitude d’Heisenberg, selon qui, plus la position d’une particule est déterminée, moins sa vitesse sera mesurée avec précision, et réciproquement. Autrement dit, plus on a de détails sur l’un des groupes se réclamant de Dada, moins on perçoit ses relations avec le noyau central, et plus on perd de vue ses objectifs. On l’a souvent dit, Dada prouvait le mouvement en marchant.
Énumérons, brièvement, quelques-unes de ses caractéristiques majeures. Le Mouvement, par définition, est un collectif d’artistes et de poètes. Il regroupe, à l’origine, des apatrides, des réfugiés, des déserteurs fuyant la guerre vers un pays neutre et paisible. Tous ont un point commun : ils avancent dans la vie la rage au cœur. Quelles que soient leurs opinions politiques et leur position par rapport à la Révolution bolchevique d’octobre 1917, ils se définissent comme des révoltés, des anarchistes, tendance autiste. Leur éducation politique est rarement approfondie, à l’exception peut-être des berlinois, dont on dit que certains firent le coup de feu au côté des spartakistes.
Opposés à la guerre, ils ne sont pourtant pas des pacifistes, ne mesurant pas leurs sarcasmes contre Romain Rolland (« Au-dessus de la mêlée ») et ses thuriféraires tels qu’Ivan Goll, qui s’en plaint publiquement.
Une chose est certaine : ils étaient tous internationalistes, ce qui explique, par la suite, leur peu de goût pour la thèse stalinienne du socialisme dans un seul pays. En anticipant un peu, on pourrait dire que Dada met en pratique la thèse opposée, puisqu’il se répand sur plusieurs continents, jusqu’au Japon !
À la différence de tous les autres groupements littéraires ou artistiques, il n’y a pas de centrale de commandement. Pas de leader, pas de « Président », ou plutôt, « tout le monde est président », comme l’indique Tzara à Man Ray lorsque ce dernier lui demande l’autorisation d’intituler New York Dada la revue qu’il souhaite fonder aux États-Unis en compagnie de Marcel Duchamp.
Pas de Bureau central, disais-je, pas d’organisation structurée, mais des hommes-source, et des passeurs. Tzara, qui se fait fort d’organiser des expositions à Zurich pour des artistes appartenant à des pays belligérants (et il y parvient !), qui peut entrer en contact avec des Allemands, des Français, des Italiens et même des Américains… Huelsenbeck, rentré fin 1916 à Berlin, communique la bonne nouvelle à la jeunesse d’avant-garde et finit par organiser le Club Dada… Picabia, qui saute par dessus les méridiens et met les uns en contact avec les autres.
En dépit de son enthousiasme pour les cultures allogènes et pour les implantations les plus curieuses, Dada se définit, malgré tout, comme Européen. Je dirais même plus européen que ne l’étaient, à l’époque, les organisations militant pour une Europe transcendant les nations qui la composent. Ce lui était facile, dans la mesure où il voulait ignorer toute frontière, virtuelle ou réelle.
En tout état de cause, où qu’il sévisse, Dada fait partie de l’avant-garde. Il est lui-même l’avant-garde, puisqu’il souscrit au principe politique constitutif de toute avant-garde depuis Baudelaire. Non pas en se ralliant à un parti politique existant ou à venir, mais en reprenant à son compte (et en la gauchissant à son profit) la formule baudelairienne selon laquelle « pour être juste, c’est-à-dire pour avoir sa raison d’être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c’est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d’horizons. » (Salon de 1846)
Cela commence par la contestation radicale des institutions et de tous les académismes. Pensons à la célèbre Fountain de Marcel Duchamp (1917), ce ready-made exposé à la Société des artistes indépendants de New York au nom des principes même de cet organisme, comme il avait fait à Paris en 1912 pour le Nu descendant un escalier, refusé par la Société des artistes indépendants.
Pas de programmes, mais des textes-clés, des proclamations-manifestes, qui drainent tout un public, tel le célèbre « Manifeste Dada 1918 » de Tzara. Il y affirme qu’il ne veut rien, mais le dit si bien qu’il entraîne l’adhésion de Breton et avec lui tout le groupe Littérature. De même pour le Manifeste Dada en allemand, proclamé par Raoul Hausmann, parodie des treize points du Président Wilson, où Louis Janover perçoit néanmoins quelques options positives : « Sous le credo aux accents ubuesques, les mesures et ‘abolitions’ proposées, émaillées d’exigences franchement cocasses, peuvent s’entendre comme une exagération limite de revendications nullement délirantes en soi : ‘association internationale et révolutionnaire des créateurs et intellectuels du monde entier sur la base du communisme radical’, introduction ‘progressive du chômage par la mécanisation généralisée de toutes les activités’, ‘abolition immédiate de toute propriété’, lutte contre ‘l’esprit bourgeois caché’ mais encore actif dans les milieux culturels, de l’expressionnisme notamment, ‘abolition du concept de propriété dans le nouvel art’, etc.1 ».
Dada redonne sa primauté à l’individu, ce qui n’exclut pas l’action collective. En refusant l’institution au profit de l’action directe (tout de même médiatisée par la presse), il court le double risque :
1- d’épuisement dans le renouvellement constant pour reconstituer un réseau aux contours indéfinis ;
2- de figement dans la répétition, ce qui l’aurait conduit à devenir une institution par lui-même.
Dada a connu les deux dangers. Il a vite compris qu’il courait à sa perte, d’où sa brièveté et sa mort volontaire.
Auparavant, il avait atteint son objectif premier, qui était d’instaurer, à sa façon, la Tabula rasa comme principe méthodologique : faire le vide pour donner libre cours à la nouveauté ; supprimer le passé afin de penser librement. En ce sens, on comprend l’apparition de Descartes sur la première page de Dada 3. Descartes par-dessus Kant, au moyen d’un confusionnisme intégral et assumé. En somme, Dada n’est jamais plus heureux que lorsqu’il a trompé tout son monde, comme le lui prouve la réaction du public exacerbé, furieux d’avoir été berné.
Le plus souvent, le public est trompé par le fait que l’artiste qu’il connaît pour faire partie d’un groupement esthétique donné, se retrouve sous la bannière Dada. Ainsi, à Berlin, on peut affirmer qu’il y eut des dada-marxistes aussi bien que des dada-expressionnistes ; et le même Van Doesburg, tenant du constructivisme, signera I.K. Bonset ses contributions à dada !
À la différence de ce que nous faisons d’habitude lorsque nous parlons littérature ou art, il faut, en l’occurrence, prendre en compte les dissemblances individuelles plutôt que les ressemblances : c’est ce qui fait l’originalité du Mouvement, sa richesse. Dans son journal, La Fuite hors du temps, Hugo Ball observe avec intérêt, pour marquer la productivité d’un tel processus, que, selon les jours, des rapprochements s’opèrent tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, l’essentiel étant que tous maintiennent un minimum d’entente entre eux, une volonté commune de s’identifier à dada, lequel, en retour, s’identifie à eux : « Nous sommes cinq et le fait remarquable est que nous ne sommes jamais réellement en parfait accord, même si nous nous entendons sur les objectifs principaux. Les constellations changent. Tantôt Arp et Huelsenbeck s’accordent et semblent inséparables, tantôt Arp et Janco réunissent leurs forces contre H., puis H. et Tzara contre Arp, etc. Il existe un mouvement perpétuel d’attraction et de répulsion. Une idée, un geste, une certaine nervosité suffisent pour modifier la constellation sans pour autant bouleverser le petit groupe.2 » Le même va-et-vient se reproduit au niveau international, constituant un ensemble de nœuds de relations par-dessus les frontières, en d’autres termes un réseau, aux mailles lâches et mobiles.
Certains groupes vont se reconnaître en dada, a posteriori : les « nitchevoki » russes, Iliazd et son 41°, Clément Pansaers avec la revue Ça ira, les Espagnols Guillermo de Torre, RafaelLasso de la Vega, Jacques Edwards… Mieux, on signale la présence de centrales tardives à Anvers, Amsterdam, en Hongrie avec la revue Ma, en Pologne, etc.
Les historiens se demandent s’il est légitime d’apposer, aujourd’hui, une étiquette qui n’était pas revendiquée à l’époque. Mais, il faut tenir compte, je pense, de la grande confusion entretenue et voulue par dada, qui fait que nous avons bien du mal à cataloguer, à désigner les invariants de tel ou tel mouvement. Au point que cette confusion, chaque fois que nous la rencontrons, associée à d’autres constantes, légitime l’appellation Dada.
Proclamant la dictature de l’esprit, ce mouvement incarne le soulèvement de la vie, de la jeunesse, désireuse de vivre après s’être débarrassée des forces mortifères. J’ai déjà signalé l’individualisme de ces artistes que l’amitié seule peut unir, le temps d’une action d’éclat. On n’est donc pas surpris de les voir se quereller pour des raisons mesquines, se réconcilier aussitôt pour ce qui, la plupart du temps, les dépasse.
C’est l’humour (avec ou sans H, si l’on est ami de Jacques Vaché) qui transcende leurs propos et leurs actions. Tzara déclarera d’ailleurs que, sans humour, la poésie, qui est la vie, ne vaut pas la peine d’être vécue.
La fin de Dada est relativement indéterminée, selon les chronotopes envisagés. Les uns ont éclaté littéralement, chacun de leurs membres adoptant la solution de son choix : la foi, l’épicerie ou le suicide. D’autres se sont réfugiés dans le silence, quand ils ne s’y sont pas perdus à jamais. D’autres ont reparu sous l’hypostase surréaliste. Outre qu’il offrait une porte de sortie honorable à ces révoltés lassés de se répéter, il faut bien reconnaître que le surréalisme s’est véritablement livré à une OPA sur ce qu’il restait de son prédécesseur !
Ailleurs, n’oublions pas le contexte politique, les Italiens se tournèrent vers le fascisme ou l’anti-fascisme, les Allemands durent entrer dans des organismes sérieusement organisés pour éviter l’autodafé généralisé, etc.
Que restait-il alors de cette explosion de la jeunesse ? S’il n’y avait que le rire et l’humour, ce serait déjà un bilan positif, surtout quand on le compare à celui des politiques, ou encore au « retour à l’ordre » prôné par les bien pensants ! Mais il y a bien davantage : la pratique systématique et raisonnée de l’incohérence leur a ouvert les portes de l’inconscient. Je veux dire qu’ils ont su déjouer la censure toute puissante du surmoi pour mieux plonger dans le fleuve noir. Ce sont bien les scientifiques qui ont exploré, avec des techniques appropriées, les méandres de ce cours d’eau, qu’ils ont considéré individuellement ou collectivement. Mais, comme l’a prouvé Gaston Bachelard une décennie après, il a fallu que les poètes et les plasticiens se livrent à l’aventure pour que les savants puissent en tirer leurs leçons.
Enfin, il ne faudrait pas minimiser la toute puissance du hasard, qui est à l’origine de tant d’œuvres et de pratiques nouvelles, systématisées, telles que les rayographies de an Ray, ou les schadographies de Christian Schad, et tant de collages ou de montages innombrables, plus désorientants les uns que les autres.
***
C’est sur un tel fonds qu’il faut apprécier la raison d’être et la qualité des manifestations du centenaire de Dada.
Alors que la manie commémorative tend à s’estomper collectivement, on n’est pas peu surpris de voir se constituer des associations vouées à célébrer la machine infernale qu’était Dada. Qui plus est, sur les lieux mêmes où il a surgi, alors que les édiles de Zurich ne s’étaient pas distingués, auparavant, par leur zèle en faveur de Dada !
Sans énumérer toutes les présentations du Mouvement depuis son décès plus ou moins constaté, il convient de mentionner l’exposition du cinquantenaire, à Zurich et à Paris, en 1966-67, qui, la première, démontra, contre les anciens dadaïstes, qu’il valait la peine de recueillir les morceaux épars de leur explosion initiale. Plus près de nous, l’exposition du Centre Pompidou, en 2005, ne prétextait aucune justification historique, ce qui lui permit de montrer, par un parcours labyrinthique, le plus vaste ensemble d’œuvres textuelles, plastiques ou sonores, jamais rassemblé.
L’année 2016 n’a pas démarré en fanfare pour Dada. Mais les attachés de presse s’étaient chargés d’informer leurs interlocuteurs de tout un programme d’activités qui devaient débuter en février, et se produire à Zurich, son foyer de naissance, à Berlin ou à Paris. Parallèlement, militaires et politiques se focalisaient sur le centenaire de Verdun, champ de bataille où périrent 700.000 soldats des deux camps. Le contraste reste saisissant entre cette atmosphère morbide de la commémoration de Verdun, malgré la mise en scène juvénile du vieux cinéaste Volker Schlöndorff, et celle de Zurich, vigoureuse, pleine de vitalité, véritable hymne à la joie.
Dans l’impossibilité de commenter chacun de ces événements, j’en distinguerai trois, parmi les plus représentatifs et les plus significatifs.
En premier lieu, je détacherai cette lecture, à l’aube, et durant 165 jours, d’œuvres dada par le directeur du Cabaret Voltaire. Il se trouve qu’un auditeur anonyme, pris aux tripes par la cérémonie matinale dans la forêt, en fut si bouleversé qu’il décida de transformer sa vie, désormais intégralement vouée à Dada. Il m’a confié, à moi parlant, ce bouleversement dans sa manière de vivre et d’agir avec ses semblables. Mis à part cet investissement personnel, il faut préciser que le local du Cabaret Voltaire, récemment réhabilité par la ville, est devenu à la fois un lieu de mémoire et le bistro culturel le plus vivant du quartier, avec ses conférences et ses spectacles qui tournent autour de Dada, parce qu’il est fréquenté par la jeunesse des écoles.
Autre événement remarquable : la tentative de reconstitution de l’anthologie dada que devait être Dadaglobe. Elle avait été confiée à Tzara par les éditions de la Sirène, sur le modèle de l’Anthologie nègre réalisée par Blaise Cendrars en 1921. En raison des trop nombreuses illustrations confiées par les dadaïstes, le projet échoua, faute de moyens. Mais les documents n’avaient pas disparu : un bon nombre de textes ou poèmes s’est retrouvé à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, que nous avions publié auparavant dans la revue Dada-Surréalisme, n° 1. Américaine, l’historienne d’art Adrian Sudhalter se mit en tête de rassembler le maximum de documents complémentaires en vue d’une exposition à Zurich puis à New York. Une fois de plus, la thèse exprimée par Max Ernst, selon laquelle il était inutile de recueillir les débris dada, a été mise en échec.
En troisième lieu, je retiendrai l’exposition « DADA Afrika » abordant, pour la première fois dans un tel contexte officiel, un sujet peu étudié jusqu’à présent : la découverte des cultures et des « arts primitifs » par les dadaïstes. Des matériaux, formes, textes et musiques provenant d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique ont servi de source d’inspiration et de référence pour les deux tendances coexistantes du mouvement, l’abstraction d’une part, le « primitivisme » d’autre part. Fruit de la coopération du Musée Rietberg de Zurich et du musée berlinois Berlinische Galerie, on y perçoit surtout la touche des conservateurs de Berlin, fort avertis des contacts de civilisations Nord-Sud.
Je ne saurais quitter ces actes de mémoire sans mentionner les efforts considérables des Roumains pour ramener l’enfant prodigue, tant Tzara que Dada, au giron de Bucarest. On sait à quoi s’en tenir pour ce qui concerne Tristan Tzara, lequel n’a pas composé plus d’une quintaine de poèmes en roumain, confiés avant son départ à l’ami Ion Vinea, chargé de les valoriser au mieux parmi les revues d’avant-garde. L’exposition, sous le titre Tzara, Dada, etc., de ses œuvres plastiques et poétiques détenues par le collectionneur Emilian Radu n’en demeure pas moins émouvante. Pour la Roumanie redevenue une démocratie, il s’agit bien de se réapproprier ce qui, à son sens, n’aurait jamais lui échapper. De là la multiplication des colloques, expositions, éditions, ayant pour objectif de montrer les racines roumaines des œuvres qui se sont épanouies à l’extérieur.
J’ai gardé pour la fin l’événement le plus important, l’exposition consacrée au seul Tristan Tzara. Elle se produisit au Musée d’art moderne de Strasbourg, du 24 septembre de l’an passé au 17 janvier 2016. Son titre exact était : Tristan Tzara, l’homme approximatif, poète, écrivain d’art, collectionneur. À partir du clin d’œil à son épopée majeure, on mettait l’accent sur les trois lignes de force de son activité. Le fait est d’autant plus notable qu’il s’agissait de la première exposition d’envergure nationale consacrée au poète.
L’usage d’expositions monographiques pour les peintres est parfaitement établi depuis plus d’un siècle : il suffit d’accrocher leur production picturale sur un mur, de la façon la plus appropriée à l’œuvre en question. Mais qu’en est-il pour les poètes ? On peut, au maximum, présenter les différents états d’une œuvre, du manuscrit à la réalisation finale, au livre pour tout dire. Un peu limité en matière visuelle, n’est-ce pas ? Sauf à détourner le problème en pointant sur la biographie, à l’aide de photographies et de documents d’époque, ou bien en s’appuyant sur des ensembles parfaitement visibles, des tableaux élaborés par les amis peintres. Par chance, Tzara, qui fut peintre à ses heures (on ne le savait pas puisque rien de cette activité plastique n’avait paru à ce jour), publia une cinquantaine de plaquettes ornées d’une œuvre gravée par un ami, choisi parmi les plus connus de l’époque. Outre la présentation de ces livres, ouverts à la page ad hoc, il était justifié de montrer les tableaux s’y rapportant, d’une manière ou d’une autre.
Les commissaires ont opté pour un parcours suivant l’ordre chronologique, sans doute le plus acceptable aux yeux d’un public, il faut en convenir, généralement ignorant de l’œuvre de Tzara, quand il ne le réduit pas à sa période Dada (1916-1923) ! D’autres choix étaient possibles, d’ordre thématique par exemple, mais n’allons pas gâcher notre plaisir ! Enfin Tzara parlait seul, à l’avant de tous et pour tous. À en croire la presse, le public accueillit très favorablement cette exposition, accompagnée d’animations diverses. Tardivement, mais sûrement, le poète revient sur le devant de la scène, comme autrefois au temps de Dada.
Henri BÉHAR
1. Louis Janover, La Révolution surréaliste, op. cit. p. 43.
2. Hugo Ball : La Fuite hors du temps, 24-V-1917.
| DOSSIER ANDRÉ BRETON | LES CAHIERS DU MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE 9782844267610 |

RÉSUMÉ
Le Surréalisme lie de manière indissociable – sans pourtant jamais vouloir les confondre – la révolution poétique et la révolution politique. En 1927, les surréalistes adhèrent en bloc au parti communiste français. En 1933, ils en sont tous exclus, à l’exception d’Aragon. Entre ces deux dates, une succession de malentendus, de déceptions et de volte-face. Le surréalisme était-il donc incompatible avec l’engagement politique ? Théoricien du surréalisme, André Breton n’a eu de cesse de chercher à définir la spécificité de l’art en le confrontant notamment à l’engagement et à l’action politique.
DESCRIPTIF
Ce nouvel hors-série des Cahiers du MNAM, présenté sous la forme d’un almanach, accompagne la séquence des expositions-dossiers consacrée aux politiques de l’art et interroge, à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort, le rapport d’André Breton à la politique.
De nombreux documents, textes, images, articles ou tracts viennent illustrer les sept essais de spécialistes du sujet.
SOMMAIRE :
Bernard Blistène et Nicolas Liucci-Goutnikov : Préface
Jean-Michel Bouhours, Jean-Michel Goutier et Camille Morando : Avant-propos
Jacqueline Chénieux-Gendron : Du droit et du politique : l’alerte du poète
Henri Béhar : Du passé faisons table rase
Camille Morando : Au feu ! Contre l’Exposition coloniale internationale
Jean-Michel Bouhours : Pose devant Guernica
Gérard Roche : Breton et Trotski – de la « beauté convulsive » à l’art révolutionnaire indépendant
Jean-Michel Goutier : Salves libertaires. Surréalisme et Anarchie
Jérôme Duwa : Le Manifeste des 121 ou la loi de l’insoumission
CARACTÉRISTIQUES :
Reliure : Broché
Langue : Français
EAN 9782844267610
Nombre de pages 112
Date de parution 5/10/2016
Dimensions 19 x 26 cm
Sous la direction de Jean-Michel Bouhours, Jean-Michel Goutier et Camille Morando

Quinzaines – Toujours indésirable, André Breton (la-nouvelle-quinzaine.fr)
Allez à cette page pour lire cet article et le télécharger en PDF :
Toujours indésirable, André Breton | Henri Béhar (melusine-surrealisme.fr)
Ce numéro de revue a suscité un article d’Eddie Breuil, employant le terme « tortionnaire » au sujet d’André Breton, auquel Dominique Rabourdin répondit dans le Bulletin Infosurr :
André Breton tortionnaire ! | Infosurr
Dominique Rabourdin : André Breton Tortionnaire ! 2016 (benjamin-peret.org)
NQL : Vous avez publié, il y a vingt-cinq ans, une imposante biographie d’André Breton, que vous avez révisée et reprise en 2005 chez Fayard. Or, l’interdit étant tombé, la correspondance d’André Breton commence à paraître. Pensez-vous devoir remettre votre ouvrage sur le chantier, en fonction de ce que cette correspondance nous révélera ?
Henri Béhar : Non, pas dans l’immédiat, pour l’excellente raison que, si Breton avait, par testament, imposé un délai de cinquante ans pour la publication de sa correspondance, il n’en avait pas refusé la lecture. De telle sorte que, pour ma part, je n’en attends pas de révélation bouleversante. Je m’en explique ci-après.
Parce que vous estimez que le surréalisme est, de loin, le mouvement littéraire, artistique et bien davantage qui marquera l’histoire intellectuelle du XXe siècle en Europe.
Parce que vous admirez la personnalité d’André Breton, son meneur au pouvoir charismatique incontesté.
Parce que vous ne rejetez pas pour autant ceux qui se sont séparés de lui pour des motifs divers, voire opposés, tels Aragon, Char, Éluard, Tzara ou Vitrac.
Parce que vous n’êtes pas satisfait des formules convenues à son sujet, telles que « pape du surréalisme », « tyran sectaire », « dictateur intolérant », « faux révolutionnaire », etc.
Parce que la sympathie ne vous empêche pas de garder la tête froide,
Vous décidez de reprendre la question à nouveaux frais. Vous relisez, la plume à la main, la totalité de ses écrits, puis tout ce qui s’est écrit sur son œuvre et sa vie. Vous formez alors le projet de lui consacrer une biographie. Non que les précédentes soient condamnées, mais parce qu’elles vous semblent fragmentaires, incomplètes ou partisanes. Vous reprenez l’enquête à zéro. Vous découvrez, par exemple, qu’on lui attribue deux dates de naissance : le 18 et le 19 février 1896. Pour en avoir le cœur net, comme la législation vous en donne le droit, vous réclamez à sa mairie de naissance un extrait d’état-civil. Vous constatez alors que, loin de se dissiper, les incertitudes ne font que croître puisque sur ces documents officiels il apparaît comme bigame ! Pris par le démon de l’absolue vérité, et parce que vous voulez comprendre la raison et l’intérêt de telles manipulations, aussi minimes soient-elles, vous vous faites ouvrir toutes les archives, publiques ou privées ; votre soif d’information et de vérification ne connaît plus de limites. C’est ainsi que vous découvrez le registre d’inscription de l’École de médecine de Nantes sur lequel André Breton a porté de sa main une date de naissance anticipée d’un jour, qui correspond à celle de sa cousine, dont il parle dans Les Vases communicants. Comme vous estimez que les textes imposent d’être lus et déployés dans toutes leurs dimensions référentielles, vous suivez la piste de ce nouveau personnage et vous arrivez à cette conclusion que le poète a procédé à un échange symbolique, non par étourderie, mais pour des raisons d’ordre… poétique et sentimental, nuançant le texte initial, lui donnant une tout autre épaisseur.
Bien entendu, vous n’en restez pas là. Disposant des archives diplomatiques ouvertes au public passé un délai de trente ans, vous cherchez à déterminer le rôle exact d’André Breton que certain annaliste enthousiaste présente comme celui dont les mots de feu déclenchèrent une révolution en Haïti, alors que lui-même, dans ses très précieux et très pondérés Entretiens, minimise le poids de ses propos. Vous vous plongez dans la presse locale de l’époque, vous contactez les témoins et les acteurs de ce moment historique, vous opérez la synthèse de toutes ces informations et vous avez la satisfaction de préciser, là encore, les dates, la durée du séjour, la nature exacte des allocutions prononcées, leur impact sur un public jeune qui ne demandait qu’à se laisser gagner par le verbe altier de l’écrivain, à son tour ému par la beauté et la misère des peuples caraïbes.
Vous relatez tout cela, en suivant, aussi fidèlement que possible, l’ordre chronologique, sans fioritures ni parti pris, en refusant de vous servir de l’œuvre pour éclairer les points obscurs de l’existence, en disant ce que vous avez appris et compris, en marquant les limites de votre investigation, en ne taisant pas vos incertitudes. Vous publiez et vous attendez les réactions du public, au premier chef de cette « mousse intellectuelle » que forme la critique, selon le mot de Vitrac.
Vous vous étonnez du silence de certains journaux, ou de certains médias, comme on dit pour désigner ces faiseurs d’opinion que sont la radio et la télévision. De nature inquiète, vous pensez en être la cause. Puis vous analysez certains échos, et vous vous demandez si Breton ne demeure pas l’objet d’un étrange ostracisme, au moment exact où ses idées triomphent et sont admises par tous. Vous vous réjouissez de constater que le titre qu’il se choisissait en 1930 de « grand indésirable » demeure justifié. Relisant calmement les coupures de presse accumulées à ce sujet, vous écartez la trop vive tentation de les annoter et de les noter, comme vous y incline votre métier. Prenant quelque hauteur, vous songez à procéder à une analyse de contenu du discours de presse, mais le jeu vous semble trop cruel. Vous essayez d’en dégager les traits pertinents d’une réception critique, tout en sachant combien l’exercice dans lequel vous êtes impliqué est aléatoire puisqu’il ne concerne que certains organes de presse. Vous éliminez les coupures qui se contentent de reproduire votre propre argumentation, décomptez celles qui s’en tiennent à une dépêche d’agence et classez les autres qui, somme toute, cernent trois problèmes fondamentaux relatifs à la nature du genre biographique : les rapports entre la vie et l’œuvre, la part de l’individuel dans le collectif, la distance entre le mythe et ce que vous croyez être le réel.
Fort heureusement, la biographie n’est pas un genre stabilisé, aux canons strictement définis. S’agissant d’un personnage dont la célébrité tient autant à ses écrits qu’à ses actes, il convient d’opérer un va-et-vient constant des uns aux autres, la difficulté étant de ne pas privilégier l’un de ces deux éléments, sous prétexte qu’au regard de la postérité seuls les écrits demeurent. Certains critiques se lamentent qu’on entende davantage le bruit des pas quotidiens que les chefs-d’œuvre, dont je me suis pourtant efforcé de dégager les grandes lignes et l’impact. Il est vrai que le biographe suppose ici que le lecteur ira consulter l’œuvre, pour autant qu’elle soit facilement accessible, ce qui est le cas pour Breton, désormais consacré par la publication de ses œuvres complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, et dont la plupart des ouvrages se trouvent publiés dans des collections au format de poche. Faudrait-il, pour autant, sacrifier à la facilité qui consisterait à résumer les œuvres dont on parle ? Je ne le crois pas, dès lors que j’ai indiqué toutes les voies par lesquelles la vie communique avec le texte, formant, pour reprendre une image chère à Breton, un véritable tissu capillaire. Un exemple suffira : évoquant cet étrange récit, de nature difficile à qualifier, qu’est Nadja, il serait loisible d’en analyser la structure, de montrer comment la première partie, relatant dans un ordre apparemment aléatoire ce que Breton nomme des « faits-glissade » et des « faits-précipice », est là pour mettre en condition le lecteur afin de lui permettre d’appréhender comme il convient la venue de ce génie libre, de cet être surréaliste par excellence qu’est Nadja, laquelle n’intervient et s’efface, semble-t-il, que pour annoncer l’irruption d’une femme dénommée X, que désormais nous savons être Suzanne, la compagne d’Emmanuel Berl. Or, le fil chronologique que j’ai suivi prouve que Breton n’a pu se livrer à une construction savante du texte, à moins qu’elle ne fût inconsciente, dans la mesure où il ne pouvait prévoir cette rencontre. Cela étant, on peut toujours supposer que le narrateur tendait ainsi les fils de son récit pour y prendre au piège l’enivrante et trop distante Lise, qui se refusait à lui dans le temps même où il écrivait ce texte, à Varengeville. Inversement, il est permis de penser que Breton, attentif aux signes et aux intersignes, s’est lui-même persuadé, en écrivant pour exorciser le souvenir de Nadja, qu’elle devait laisser place à la Merveille et que la première rencontre survenue l’a conforté dans sa croyance. Le lecteur est libre de choisir et d’interpréter ; il ne m’appartient pas de lui dicter un choix. Parodiant Breton, je dirais que « je me borne à convenir » que tel fait s’est produit dans son existence, dont j’établis l’authenticité par le recoupement des informations en ma possession.
J’ajoute qu’une telle procédure d’investigation se légitime du fait que Breton a toujours prétendu vouloir vivre dans une maison de verre, « où qui je suis m’apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant » (Nadja, p. 9). En d’autres termes, ce constant passage de la vie à l’œuvre, et réciproquement, n’a d’intérêt que lorsqu’il permet de donner forme à ce projet d’existence formulé par l’auteur. L’écrivain a le droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée, même lorsqu’il est devenu un homme public. Je ne me crois pas autorisé à enfreindre cette loi pour satisfaire la curiosité du public, avide de révélations sur ce « misérable petit tas de secrets » dont ne parlait pas Malraux, si ce n’est lorsque l’auteur nous y invite lui-même. Or, Breton a toujours prôné l’unité de la vie et de l’œuvre, refusant la littérature au profit de la vie, « la vraie vie », dans le sens où l’entendait Rimbaud. À propos du Traité du style d’Aragon, qu’il jugeait manquer d’humanité, il écrivait à sa femme : « Ce n’est pas seulement l’humain qu’il faut atteindre et que si peu atteignent, c’est le vital. » S’il y est parvenu, comme je le crois, opposer la vie et l’œuvre me paraît, en l’occurrence et quoi qu’en ait dit Claude Roy, le type même du faux procès.
Le deuxième problème que pose la biographie d’André Breton concerne la part de sa démarche personnelle dans ce qu’on est convenu d’appeler, un peu légèrement je dois le reconnaître, « l’aventure surréaliste ». Tant, en France, l’une et l’autre se trouvent identifiées à sa personne. Même lorsqu’ils admettent, avec Jean Schuster, que le groupe surréaliste s’est dissous en octobre 1969, soit trois ans après la mort de Breton, les historiens n’en pensent pas moins qu’il avait cessé d’exister en même temps que son fondateur. Faut-il, dès lors, brosser à grands traits l’histoire d’une collectivité, au risque de ne plus percevoir les traits individuels de son meneur, ou bien doit-on coller uniquement au personnage sur lequel se concentre l’attention, en ignorant, momentanément, le groupe électif ? Faux débat, dirai-je encore, car l’un ne se conçoit pas sans l’autre. S’il est vrai, comme on l’a constaté, que le jeu pluriel oblige à, parfois, forcer la note, il est non moins vrai que Breton a constamment œuvré en fonction du groupe. Dès avant l’explosion de Dada à Paris, il opère la jonction entre Aragon et Soupault, de façon à former le trio des mousquetaires, comme les nommait Valéry, auxquels Vaché, Fraenkel, Éluard viendront s’adjoindre tour à tour dans l’esprit des commentateurs. C’est encore lui qui prendra l’initiative de fonder la revue Littérature, dont le siège sera d’abord, et très officiellement, sa chambre à l’Hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon. Il fera en sorte que les contributions sollicitées parviennent à temps, corrigera les épreuves, contrôlera lui-même la mise en page, négociera les traités avec les éditeurs et dépositaires, la Boutique d’Adrienne Monnier et le Sans Pareil d’abord, Gallimard ensuite. Il assumera les mêmes tâches, non sans lassitude parfois, pour La Révolution surréaliste, Le Surréalisme au Service de la Révolution et bien d’autres revues encore qui formaient le creuset permanent du Mouvement, auxquelles il apportait une contribution financière personnelle. On sait que, malgré certaines réserves sur les finalités des manifestations Dada, il fit le plus pour que le spectacle correspondît au programme annoncé. On pourrait en dire autant pour les tracts, les pétitions, les déclarations collectives auxquelles il porta la main, s’efforçant de rallier le maximum de gens sur les textes qu’il rédigeait ou qu’il approuvait. Deux exemples seulement, pris à deux moments très distants de sa trajectoire : l’« Appel à la lutte » conçu au soir du 6 février 1934 pour unir toutes les forces hostiles au fascisme ; le célèbre Manifeste dit « des 121 », sur le droit à l’insoumission durant la guerre d’Algérie. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de textes à valeur performative, qui ont eu un sérieux impact sur la collectivité. Davantage, j’irai jusqu’à dire, que les Manifestes du surréalisme, rédigés par Breton lui-même, et qui ne doivent leur ton inimitable qu’à sa plume, ils sont le fruit de longs débats collectifs dont ils portent souvent la marque exacerbée.
Mais, me dira-t-on, les exclusions, les injures du second Manifeste, sont fort personnelles, et dirigées contre des individus qui s’étaient opposés à lui, à sa conception du Mouvement, engagé sur la voie politique tout en maintenant son autonomie. Certes. Il faut cependant faire la part de la pression exercée par les amis, au premier rang desquels Éluard et Aragon ne furent pas les moins exigeants, et par les circonstances sentimentales qui faisaient de Breton une corde tendue à l’extrême, vibrant au moindre coup d’archet. Car il faut souligner le paradoxe, qui est peut-être le propre de tout grand créateur : Breton est un solitaire qui a besoin du groupe pour s’épanouir, pour tester la force de ses idées, pour éprouver la qualité de ses écrits. Mais cette foule bourdonnant autour de lui l’importune par ses sollicitations permanentes, son manque d’autonomie, ses propos sans grandeur. On peut supposer que Breton eût été un écrivain plus prolixe et peut être d’une dimension supérieure s’il n’avait pas tenu à mettre en avant ses compagnons ou, plus tard, ses jeunes amis. Combien de fois, dans sa correspondance, il se lasse de devoir expliquer le surréalisme, écrire des préfaces, répondre à des entretiens où il devra, une fois de plus, marquer le cap ! Inversement, si le surréalisme lui doit tout, il doit beaucoup à cet ensemble, qui a fait d’un individu d’origine très modeste, sans aucun capital réel ni symbolique, l’un des grands de notre époque, à tel point qu’ils deviennent indissociables.
Henri Béhar est professeur émérite de l’université Paris 3. Grand artisan des études sur le mouvement dada et sur le surréalisme, il est à l’origine de nombreuses publications collectives dans ce domaine. Il est l’auteur d’André Breton : le grand indésirable (Fayard)
SUR LE MÊME SUJET
PAR ALBERT BENSOUSSAN
PAR DOMINIQUE RABOURDIN
PAR ELZA ADAMOWICZ
PAR STAMOS METZIDAKIS
A LIRE AUSSI
PAR ELZA ADAMOWICZ
PAR LA NOUVELLE QUINZAINE LITTÉRAIRE
PAR EDDIE BREUIL
PAR STAMOS METZIDAKIS
Bien entendu, se reporter au volume en question:
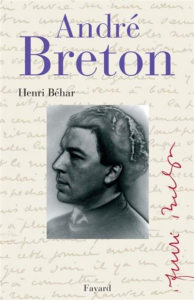
Passé l’éclair du magnésium, les traits d’André Breton (1896-1966) se figent à jamais. Visage décidé, menton en avant, cheveux assez longs, il conduit la horde changeante des surréalistes. Dans la tourmente du siècle, marqué par deux guerres mondiales et la plus vaste révolution que la terre ait connue, c’est lui qui désigne le chemin. Son autorité s’exerce sur beaucoup, des plus grands aux plus obscurs. Aragon, Eluard, Soupault, Péret, Char, Tzara même, lui obéissent. A son corps défendant, le voilà hissé sur un piédestal, quelque part entre les statues de Rousseau et de Chateaubriand.
Ecartant les images simplistes, cette biographie montre comment s’est formée la personnalité du poète à travers son admiration puis son rejet de Valéry, Gide, Apollinaire. Elle le suit pas à pas dans sa quête de l’esprit moderne et son enthousiasme pour Dada, son invention de l’écriture automatique, son adhésion critique au parti communiste. Elle reconstitue l’avènement du surréalisme, son aventure quotidienne, ses débats et ses combats, à travers cet homme qui a toujours pris le parti de la vie.
Plus complexe, sensible, hésitant et angoissé qu’on le croit généralement, l’auteur de Nadja s’est efforcé de mettre en pratique une morale exigeante de l’existence, dominée par le très haute idée qu’il se faisait de l’amour, la poésie, la révolution. Il y est parvenu au prix de bien des difficultés, avec une constance et une inflexibilité qui l’ont fait classer, définitivement, au nombre des « grands indésirables ».
Format : Broché
Nb de pages : 700 pages
Poids : 863 g
Dimensions : 16cm X 24cm
Date de parution : 21/09/2005
EAN : 9782213626024
Une troisième édition, mise à jour, sera publiée prochainement (en 2024) aux éditions Classiques Garnier dans la collection Biographies.
dans Les Rencontres méditerranéennes Albert Camus, Albert Camus et la pensée de midi, éd. A. Barthélemy, Avignon, 2016, p. 45-58.

Albert Camus et la pensée de midi
Publication des actes du colloque 2013 : L’expression « pensée de midi » est peut-être, plus encore que les termes révolte et mesure, l’expression qui résume de la manière la plus condensée la réflexion de Camus. On trouve en elle les divers axes autour desquels sa réflexion se meut. Elle se veut d’abord pensée, avec tout ce que ce mot suggère d’appropriation de la tradition, de recherche de clarté et de rigueur. Mais elle est pensée de midi: en ce dernier mot les significations et les connotations se bousculent. Midi est mesure du temps et renvoie au mystère du temps qui s’écoule. La Pensée du midi est donc une pensée, mais une pensée centrée sur un jeu d’oppositions et de métaphores, où le soleil, la lumière et l’ombre occupent une place centrale.
Association des Amis d’Albert Camus: ww.rencontres-camus.com
Présentation des rencontres Albert Camus :
Présentation des Rencontres – Rencontres Méditerranéennes Albert Camus (rencontres-camus.com)
« La pensée de minuit ? C’est midi ! »
[Télécharger cet article en PDF]
La pensée de minuit ? c’est midi !
Il y aura bientôt un an que Jean-Louis Meunier me demandait de participer à ces rencontres méditerranéennes Albert Camus, en souhaitant me voir traiter de « la pensée de minuit selon Breton, par rapport à la pensée de midi selon Camus ».
Il faut vous dire que le syntagme « pensée de minuit » n’a jamais été employé, à ma connaissance (et à celle du golem à ma personne attaché) par André Breton ni par ses amis. En d’autres termes, elle ne fait pas sens chez les surréalistes. Je m’assure qu’elle n’est même pas employée par Albert Camus en consultant la base de données textuelles Frantext, qui contient quasiment toutes les œuvres de notre prix Nobel, y compris ses adaptations.
J’aurais eu tendance à répondre par la négative à l’aimable sollicitation de notre ami, si quelques jours auparavant (le 13 septembre 2012 exactement) n’avait été mis en ligne un bref article de Raphaël Denys : « Le surréalisme et la pensée de minuit », par les soins de la revue La Règle du jeu.
Cette apparition m’apprenait que pour au moins un lecteur du surréalisme, ce mouvement aurait pratiqué une telle pensée, évidemment opposée à celle que résumait Albert Camus dans le syntagme « pensée de midi », que lui-même n’employa qu’à deux reprises, en tout et pour tout, uniquement dans L’Homme révolté.
Ce bref article situait le surréalisme de 1939 jusqu’à la publication de L’Homme révolté en 1951. L’aperçu historique n’était pas flatteur pour le mouvement révolutionnaire. L’affirmation suivante me fit dresser l’oreille : « Or, exceptés quelques traits polémiques, rien d’outrancier dans ce que vient d’écrire Camus. » Quelques lignes plus loin, l’énoncé : « Dans la nuit surréaliste, le réel, le social, le politique ne sont que secondaires » me fit m’interroger sur la compétence de l’auteur. Excluant les guillemets et mené au style indirect libre, son discours ne permet pas de savoir qui parle. La conclusion ne faisait aucun doute : « Voilà en somme ce que fut l’expérience surréaliste, une expérience ontologique du négatif, une pensée de minuit dans la nuit du 20e siècle. À BAS TOUT ! hurlait Dada. Rien à sauver. » Ainsi, le critique se substituait au penseur original, pour lui faire dire ce qu’il voulait entendre ! D’ailleurs, il ne cachait pas son parti pris en avouant : « Je repense à mon adolescence et ne puis que donner raison à Camus. » Pourquoi faut-il que la critique idéologique soit toujours menée d’un seul côté ? je me le demande encore !
Il me fallait aller y voir de près. J’acceptai donc l’invitation, ne fut-ce que pour vérifier avec vous la teneur réelle des propos d’Albert Camus.
*
**
Pour situer la prétendue « pensée de minuit » par rapport à la « pensée de midi » formulée par Camus, il me faut, en bonne méthode, commencer par la définir, alors même que nos conclusions sur le sujet ne sont pas encore tirées.
Je le ferai le plus brièvement possible, en rappelant d’abord les deux occurrences où le romancier-philosophe use de cette expression :
c’est à la fois le titre d’une section et de l’avant-dernier chapitre de L’Homme révolté (p. 367), celui-ci référant immédiatement au syndicalisme révolutionnaire, pris comme exemple de réalisme conquérant ;
c’est ensuite une exclamation lyrique : « Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. O pensée de midi, la guerre de Troie se livre loin des champs de bataille » (L’Été, 1954, p. 140, L’exil d’Hélène)
Si l’on interroge le contexte, on voit bien que le syntagme « pensée de midi » postule une notion d’équilibre, de mesure, en pleine lumière, ce que Jacqueline Lévi-Valensi résume ainsi : « L’art, cependant, atteste que ‘‘l’homme ne se réduit pas à l’histoire’’, et la ‘‘pensée de midi’’, tension entre le ‘‘oui’’ et le ‘‘non’’, donne à la mesure humaine sa valeur créatrice. » (notice Camus dans l’Universalis).
Cette tension n’élimine pas la révolte, mais elle l’intègre à l’évolution de l’humanité, dans le sens de la vie : « Loin d’être un romantisme, la révolte, au contraire, prend le parti du vrai réalisme. Si elle veut une révolution, elle la veut en faveur de la vie, non contre elle. » (HR, 369)
S’il ne s’était agi que de cette conclusion, j’ose avancer qu’il n’y aurait pas eu de querelle avec André Breton, qui lui-même a toujours plaidé en faveur de la vie, n’en déplaise à M. Denys. Dès son premier recueil de poésies, Clair de terre, il affirmait « Plutôt la vie que ces prismes sans épaisseur même si les couleurs sont plus pures… » en un inlassable repetend. Mais Camus a voulu s’attaquer à Lautréamont en tant que maître à penser des surréalistes, et c’est là que le bât blesse. Son chapitre « Lautréamont et la banalité », publié en avant-première dans Les Cahiers du Sud, provoqua la stupeur et l’indignation de Breton qui répliqua aussitôt dans Arts, le 12 octobre 1951, à l’enseigne du « Sucre jaune » (OC III, 911).
Ne gâtons pas notre plaisir : ce titre emprunté aux Poésies d’Isidore Ducasse programmait toute une hygiène des lettres : « Oui, bonnes gens, c’est moi qui vous ordonne de brûler, sur une pelle, rougie au feu, avec un peu de sucre jaune, le canard du doute, aux lèvres de vermouth, qui, répandant, dans une lutte mélancolique entre le bien et le mal, des larmes qui ne viennent pas du cœur, sans machine pneumatique, fait, partout, le vide universel. » (Poésies I)
Breton s’estime défié. La réflexion de Camus sur la poésie « témoigne de sa part, pour la première fois, d’une position morale et intellectuelle indéfendable ». Moralement, Camus suspecte a priori tous les insurgés. Intellectuellement, il témoigne d’une méconnaissance totale de l’œuvre analysée, particulièrement de Poésies. Plus grave, sa thèse fondamentale, selon laquelle la révolte absolue ne peut engendrer que le goût de l’asservissement intellectuel, outre qu’elle n’est pas fondée, fait preuve d’un pessimisme intolérable.
Fâché de ce qu’il pense n’être qu’un malentendu, Camus lui demande d’attendre la publication intégrale de son essai pour en juger globalement. Aimé Patri et Breton discutent de l’ouvrage le mois suivant, texte en main (OC III, 1048). Breton dénonce le sophisme par lequel Camus oppose « une révolte sans mesure » à une prétendue révolte mesurée. « La révolte une fois vidée de son contenu passionnel, que voulez-vous qu’il en reste ? La révolte peut-elle être à la fois elle-même et la maîtrise, la domination parfaite d’elle-même ? Allons donc ! Une révolte ainsi châtrée ne saurait être que la “sagesse du pauvre” dont se défend Camus. » Ce dernier relève les critiques de Breton point par point et lui reproche, en somme, de sanctifier la poésie et la révolte au lieu de s’attacher à étudier le drame de l’époque1.
Dans une ultime réponse, Breton, qui se garde de mettre en cause la personne de Camus, considère qu’il tend la perche à la réaction et prône « le sabordage de tous les bâtiments battant pavillon de révolte » (OC III, 1 057). Il en appelle à l’arbitrage du responsable de la rubrique, Louis Pauwels, que celui-ci s’interdit de prononcer.
Le débat restait ouvert, et la publication de l’ouvrage ne devait pas apporter de réponse, ce qui entraina diverses prises de position sur lesquelles je passerai, puisqu’il en a déjà été question lors de vos précédentes rencontres. En résumé, je dirai qu’au-delà des attaques explicites contre les surréalistes, ces « nihilistes de salon », comment ne pas voir dans cette assimilation de Lautréamont à la banalité le chemin tout tracé pour la thèse de l’illustre Faurisson, qui devait l’identifier à M. Prudhomme !
Implicitement, Breton voyait se reproduire la démarche adoptée par Charles Chassé contre Ubu roi : si le public admet qu’il s’agit d’une supercherie, alors tout le symbolisme s’en trouve atteint. Si Les Chants de Maldoror ne sont que banalité, alors tout le surréalisme est réduit à néant.
Nous voici fort loin de la pensée solaire revendiquée par Camus, de cette tension entre la mesure et la démesure. Reprenons l’examen depuis le début.
*
**
Admettons un moment qu’Albert Camus ait pris le surréalisme comme exemple parfait de l’idéologie opposée à ce qu’il nommait « la pensée de midi ». La « pensée de minuit » se caractériserait par le recours à l’automatisme et au rêve, l’appel au merveilleux, et, enfin, par une poésie de la révolte ou de la révolution, celle-là même à laquelle il adressa les flèches les plus acérées.
Au commencement, il y eut la découverte de l’écriture en collaboration et à jet presque continu par André Breton et Philippe Soupault, Les Champs magnétiques. À tel point que Breton s’en fut déclarant : « Si c’est ça le génie, c’est facile ». L’automatisme était alors le synonyme exact du « surréalisme », de sorte que la critique usa indifféremment d’un mot pour l’autre.
D’où la définition du Manifeste du surréalisme (1924) : « automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée ».
Une note du même manifeste désigne le but de cette démarche : « Si les profondeurs de notre esprit recèlent d’étranges forces capables d’augmenter celles de la surface, ou de lutter victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les capter, à les capter d’abord, pour les soumettre ensuite, s’il y a lieu, au contrôle de notre raison ». On ne saurait être plus positif, voire positiviste, mais cet objectif, inscrit dans une note de bas de page, échappait à Camus.
Tout autant que les poètes, les peintres du groupe se sont livrés à l’automatisme, avec un bonheur plus visible.
Reste qu’au moment où Camus dresse son réquisitoire, le surréalisme, y voyant l’histoire d’une infortune continue, a renoncé à l’automatisme depuis une dizaine d’années. Il n’y aurait donc plus que le rêve comme discriminant du mouvement.
Or, chacun sait que le rêve n’existe pas. Il n’y a que des récits du rêve. Quelles que soient les vues des spécialistes sur la question, ceux-ci n’ont jamais pu que se fonder sur la parole des rêveurs, et non sur une matière concrète, la matière du rêve. Aujourd’hui, les neurophysiologues considèrent que, plus élaboré pendant la phase dite du sommeil paradoxal, le rêve peut être continu et ils admettent tous qu’il sert à reprogrammer les neurones. Si l’on admet avec Lacan que « l’inconscient est structuré comme un langage », il faut en déduire que le récit du rêve dépend de la langue et de la culture du rêveur aussi bien que des structures narratives dont celui-ci dispose.
Pour Breton, les philosophes n’ont jamais écrit rien qui vaille sur le sujet : « On en est quitte pour… la peur de se contenter de penser, avec Kant, que le rêve a ”sans doute” pour fonction de nous découvrir nos dispositions secrètes et de nous révéler, non point ce que nous sommes, mais ce que nous serions devenus, si nous avions reçu une autre éducation (?) – avec Hegel, que le rêve ne présente aucune cohérence intelligible, etc. » (Vases, OC II, 106). Féru de marxisme, il ajoute que les « écrivains sociaux » sont encore moins explicites, certainement parce que les « littérateurs » ont tout intérêt à exploiter le filon du récit de rêve, par nature conservateur, et sans conséquence sur la société (Vases, OC II, 107). Quand aux théoriciens qu’il examine, il observe que chacun nous en révèle plus sur lui-même que sur le rêve (ibid.).
Il leur oppose sa propre pratique, qu’il expliquait dès 1922 dans l’article « Entrée des médiums », disant comment il voulait des récits purs de toute scorie, recourant à la sténographie pour les noter, mettant en cause les défaillances de la mémoire, seule « sujette à caution » (OC I, 275)..
Le Second Manifeste, en 1929, lui fournit l’occasion de dresser un bilan négatif : « Malgré l’insistance que nous avons mise à introduire des textes de ce caractère dans les publications surréalistes, et la place remarquable qu’ils occupent dans certains ouvrages, il faut avouer que leur intérêt a quelquefois peine à s’y soutenir ou qu’ils y font un peu trop l’effet de ”morceaux de bravoure”. » (OC I, 806)
Au demeurant, le corpus intégral des récits de rêves dans l’œuvre de Breton n’atteint pas la dizaine. Encore éprouve-t-il le besoin de se servir des rêves de ses compagnes !
Le vœu de Breton est inscrit en une formule gnomique qui résume toute sa pensée : « Le poète à venir surmontera l’idée déprimante du divorce irréparable de l’action et du rêve » (Vases, OC II, 208).
« Tranchons-en : le merveilleux est toujours beau, n’importe quel merveilleux est beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau. » (OC I, 319) Dans le Manifeste du surréalisme, cette déclaration vient immédiatement après une réflexion sur la surréalité, ce qui revient à en faire une composante du surréalisme.
Breton aborde alors un nouvel aspect du concept, son caractère transitoire, autant que la modernité chez Baudelaire, en analysant les formes sous lesquelles il apparaît dans les arts : « Le merveilleux n’est pas le même à toutes les époques ; il participe obscurément d’une sorte de révélation générale dont le détail seul nous parvient : ce sont les ruines romantiques, le mannequin moderne ou tout autre symbole propre à remuer la sensibilité humaine durant un temps. » (ibid. p. 321).
Suivra le projet d’élaborer un dictionnaire du merveilleux. Le merveilleux se trouve partout où il y a du surréalisme : au cinéma, dans l’art des fous-la clé des champs, dans les contes et légendes populaires comme dans les textes provenant de l’automatisme. Breton explique l’intérêt que lui procure l’art océanien par le merveilleux qu’il comporte et qui donne sur un paysage mental inconnu : « Il y a aussi que le merveilleux, avec tout ce qu’il suppose de surprise, de faste et de vue fulgurante sur autre chose que ce que nous pouvons connaître, n’a jamais dans l’art plastique, connu les triomphes qu’il marque avec tels objets océaniens de très haute classe. » (OC III, 838).
Mais c’est dans l’article « Le merveilleux contre le mystère » qu’il précise comment, à partir de Rimbaud et de Lautréamont, s’affirme une volonté d’émancipation totale de l’homme, fondée sur le langage et réversible sur la vie. Déclarant son refus du mystère au profit du merveilleux, il ne cache pas le rôle de la passion : « Le symbolisme ne se survit que dans la mesure où, brisant avec la médiocrité de tels calculs, il lui est arrivé de se faire une loi de l’abandon pur et simple au merveilleux, en cet abandon résidant la seule source de communication éternelle entre les hommes. » (OC III, 658)
Avant de se placer « au service de la révolution », le surréalisme a postulé la révolution surréaliste, titre de deux revues successives, faisant pièce, en quelque sorte, à Dada qui n’avait pas d’objectif et passait pour un pur nihilisme (j’ai montré ailleurs qu’il n’en était rien).
Au départ, il y a la révolte, une révolte aveugle et sans but, que Breton reformule dans le Second Manifeste, « on conçoit que le surréalisme n’ait pas craint de se faire un dogme de la révolte absolue, de l’insoumission totale, et du sabotage en règle, et qu’il n’attende encore rien que de la violence. L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule. » Phrase que l’humaniste Camus prend à parti, la jugeant comme une tache irrémédiable.
Il est vrai qu’ainsi formulée, et quels qu’en soient les motifs (Breton avait en tête le geste de l’anarchiste Émile Henry, guillotiné à 21 ans), elle demeure irrecevable pour tout être social. Mais Breton se regardait au miroir noir de l’anarchisme. Rétrospectivement, il explique : « À ce moment le refus surréaliste est total, absolument inapte à se laisser canaliser sur le plan politique. Toutes les institutions sur lesquelles repose le monde moderne […] sont tenues par nous pour aberrantes et scandaleuses. Pour commencer, c’est à tout l’appareil de défense de la société qu’on s’en prend […] » (La Clé des champs, OC III, 935).
De fait, au moment où Breton écrivait ces lignes de tonalité anarchiste, les surréalistes s’étaient ralliés au tout jeune Parti communiste, issu de la scission de 1920, militant pour l’avènement d’une société sans classe. Ils prétendaient mettre leurs talents d’intellectuels et d’hommes de plume au service de la classe ouvrière. On sait ce qu’il en advint !
Dès 1935, cela Camus ne pouvait l’ignorer, Breton mettait en cause Staline et le stalinisme (« Du temps que les surréalistes avaient raison », 1935). S’il ne renonçait en rien à l’idée de révolution, il s’écartait de tout parti. Au sortir de la guerre, il réaffirmait dans le tract Rupture inaugurale le « destin spécifique » du surréalisme, qui était de « revendiquer d’innombrables réformes dans le domaine de l’esprit ».
Ce ralliement au réformisme était-il une marque de sagesse, le renoncement à toute violence, le recours au silence face aux deux blocs qui se partageaient le monde ?
Si la voix du poète et celle de ses compagnons n’a pas été aussi perceptible qu’autrefois, il n’a cessé de s’exprimer contre les guerres coloniales, et de s’élever contre l’inacceptable condition humaine.
Ainsi, la « pensée de minuit » n’est pas l’ennemie de la « pensée de midi ». À propos de l’opposition Camus/Breton, telle que la représentent les commentateurs, je reprendrais volontiers la formule d’Engels : « Ce qui manque a ces messieurs, c’est la dialectique. » Mouvement de l’esprit parfaitement réalisé par la résolution des contraires que postulait le Second Manifeste du surréalisme.
*
**
On admet d’autant moins l’opposition des deux penseurs qu’ils s’estimaient réciproquement. Je n’en veux pour preuve que les termes employés par Breton à l’égard de son cadet, tandis que ce dernier a oublié de noter dans son journal de voyage aux Amériques le déjeuner pris en commun.
La voix du journaliste apparaissait à Breton comme « la mieux timbrée et la plus claire qui fût montée dominant cette période de ruine » (OC III, 983). Tous deux se concertèrent sur la meilleure façon de préserver le témoignage de certains hommes libres des distorsions idéologiques. Ils rêvèrent à une sorte de pacte par lequel des gens de leur trempe s’engageraient à ne s’affilier à aucun parti politique, à lutter contre la peine de mort, à ne jamais prétendre aux honneurs, quels qu’ils soient.
Sur le plan philosophique, Breton ne saurait souscrire à la morale de l’existentialisme qui, sous prétexte d’un « engagement » de l’artiste, se met à la remorque du Parti communiste. Il en appelle aux intellectuels pour adresser des remontrances aux « grands irresponsables de l’heure », et procéder à une refonte totale des idées, en finir avec tous les poncifs de la morale universelle. Il rappelle les termes du manifeste de Mexico sur l’indépendance absolue de l’art et rejette le précepte jésuite, repris par les staliniens, selon lequel « la fin justifie les moyens ». Critiquant le pessimisme de Camus, il affirme : « le rocher de Sisyphe se fendra un jour ». Si l’homme a perdu les clés originelles de la nature, il peut les retrouver en interrogeant les mythes, à l’aide du désir, ce « grand porteur des clés » (OC III, 588-599).
Breton et Camus ont milité de conserve en faveur de Garry Davis, le « petit homme » qui prônait un désarmement mondial. Ensemble, ils ont participé à la fondation du Rassemblement démocratique révolutionnaire (RDR), organisation échappant au monolithisme des partis traditionnels. Au meeting de la salle Pleyel sur le thème « L’internationalisme de l’esprit », le 13 décembre 1948, Breton a pris la parole pour décrire les partis comme des zombies se survivant à eux-mêmes (OC III, 982-988). Il appelle à la constitution d’une formation capable de traduire les aspirations collectives, s’opposant à la fois aux staliniens qui versaient dans la dictature policière et aux gaullistes qui, par réaction, ne visaient qu’à renforcer la Défense nationale. D’après lui, le surréalisme, fidèle à ses aspirations initiales, n’a cessé de fournir des armes pour le combat international de l’esprit, que ce soit avec l’automatisme, ses prises de position contre les procès de Moscou ou la déclaration de Mexico. Il fut vivement applaudi lorsqu’il dénonça la discrimination raciale ainsi que la politique française en Indochine et à Madagascar et même lorsque, refusant la notion de responsabilité collective, il souhaita la réintégration du peuple allemand dans la communauté humaine.
Quittant le plan des idées, je prendrai à témoin ces fragments de discours intimes que sont les dédicaces adressées par Camus à son ainé, depuis 1947 jusqu’après la crise :
« A André Breton, irremplaçable, avec l’admiration et l’amitié d’Albert Camus. » (La Peste) ;
« A André Breton, avec l’admiration et la fidélité d’Albert Camus » (L’État de siège) ;
« A André Breton, ces petites étapes sur un chemin commun. Amicalement Albert Camus. » (Actuelles, Chroniques 1944-1948) ;
et, pour finir, cet hommage faisant suite à la polémique : « A André Breton, à titre documentaire et malgré tout, Albert Camus » (L’homme révolté)
Méditons ce « malgré tout » !
Les divergences entre ces deux intellectuels sont d’autant moins compréhensibles qu’ils avaient la même opinion au sujet du principe jésuite, remis à la mode par les staliniens, selon lequel « la fin justifie les moyens ». « Ce précepte, dit Breton, j’en suis immédiatement tombé d’accord avec Camus à New York, est en effet celui auquel les derniers intellectuels libres doivent opposer aujourd’hui le refus le plus catégorique et le plus actif. » (Entretiens radiophoniques, OC III, 596)
L’accord commun ne signifie pas que Breton souscrive désormais au pessimisme de Camus. Il conclut : « Ils [les surréalistes] ne tiennent pas pour incurable la ‘‘fracture’’ observée par Camus entre le monde et l’esprit humain. » (ibid., p. 597)
On le voit, rien d’inconciliable entre eux, d’autant plus que Breton a toujours prôné une conception morale de l’existence. Non point la morale commune, mais celle qu’il a pu dégager de la présence de certains êtres au-dessus du lot, tel Jacques Vaché, qui lui enseigna le détachement de toute chose, Sade, qui fit une « brèche dans la nuit morale » (OC II, 399), Baudelaire en transcendant la réalité, Rimbaud et Lautréamont bien sûr. Contre les religions de la passivité, tous ces poètes assurent un « envol plus ou moins sûr de l’esprit vers un monde enfin habitable » (OC I, 782).
J’affirme qu’un bon usage de la dialectique leur aurait permis de s’entendre mieux qu’ils ne firent. Ils eussent alors partagé la même conception de l’analogie universelle.
Quand, lors d’une conversation entre surréalistes, Breton cherche à faire comprendre ce qu’est l’analogie, il emploie cette image : « j’en vins à dire que le lion pouvait être aisément décrit à partir de l’allumette que je m’apprêtais à frotter. » (P.C., IV, 885)
Il compare alors l’analogie poétique à l’analogie mystique, en ceci que toutes deux transgressent les lois de la déduction, et montrent la relation d’un objet à l’autre alors que la logique n’y voit aucun rapport. À ceci près que l’analogie poétique ne présuppose aucun monde invisible, et fait voir la vraie vie « absente ».
« Seul le déclic analogique nous passionne, c’est seulement par lui que nous pouvons agir sur le moteur du monde. Le mot le plus exaltant dont nous disposions est le mot comme, que ce mot soit prononcé ou tu. » (OC III, 166)
Au-delà de la théorie esthétique et philosophique, le « démon de l’analogie » (Nadja I, 714, la formule est empruntée à Mallarmé), est aussi un mode de vie et une manière de penser.
J’entends bien qu’en évoquant cet aspect de la pensée bretonienne, Camus ne semble pas l’approuver. Mais il ne la condamne pas pour autant : « Finalement, comme l’expérience de Nietzsche se couronnait dans l’acceptation de midi, celle du surréalisme culmine dans l’exaltation de minuit, le culte obstiné et angoissé de l’orage. Breton, selon ses propres paroles, a compris que, malgré tout, la vie était donnée. » (HR, 127)
Qu’est-ce à dire, sinon que midi implique minuit, et réciproquement ? Ce « démon de l’analogie » est tout naturel : « ce processus répond à une exigence organique et […] il demande à ne pas être tenu en suspicion ni freiné mais, tout au contraire, stimulé » (OC IV, 838).
Aujourd’hui, nul n’ignore cette postulation du Second Manifeste : « Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement. » Mais on oublie la suite, qui envisage explicitement le dépassement, la fusion des antinomies.
De la même façon, je me demande bien en quoi la conception que Breton s’est faite de l’amour, la morale qu’il en a tirée, s’opposeraient à celle de Camus.
En 1929, les surréalistes lancent une « Enquête sur l’amour ». Ils considèrent que « l’idée d’amour, [est] seule capable de réconcilier tout homme, momentanément ou non, avec l’idée de vie ». Ils reconnaissent que l’amour auquel ils aspirent ne saurait se développer sans un profond bouleversement de la société. La Liberté ou l’amour ! déclare Desnos, tandis que leur principal théoricien prétend substituer l’amour électif et la reconnaissance à l’aliénation sociale. Ce mouvement de libération s’accompagne d’un retour à la Nature, qui n’exclue en rien la lucidité : « Amour, seul amour qui sois, amour charnel, j’adore, je n’ai jamais cessé d’adorer ton ombre vénéneuse, ton ombre mortelle. » (A. Breton, L’Amour fou).
L’amour unique devient un trait spécifique d’André Breton, qui en appelle au double témoignage d’Engels et de Freud pour défendre cette conception, source d’un « progrès moral aussi bien que culturel » (OC II, 745). Et d’en déduire : « Chaque fois qu’un homme aime, rien ne peut faire qu’il n’engage avec lui la sensibilité de tous les hommes. Pour ne pas démériter d’eux, il se doit de l’engager à fond. » (OC II, 747)
Au vrai, c’est bien Camus qui a rendu le plus bel hommage à cette idée de l’amour : « Après tout, faute de pouvoir se donner la morale et les valeurs dont il a clairement senti la nécessité, on sait assez que Breton a choisi l’amour. Dans la chiennerie de son temps, et ceci ne peut s’oublier, il est le seul à avoir parlé profondément de l’amour. »
Au terme de cette analyse, vous serez d’accord avec moi pour considérer que la confrontation Breton/Camus fut l’objet d’un malentendu, au sens camusien du vocable, si je puis dire.
La raison fondamentale du débat me parait tenir à l’hostilité de Camus non pas envers Breton, nous l’avons vu, mais plutôt envers l’idéologie allemande que le poète semblait reprendre à son compte. Admirateurs de Novalis, d’Achim d’Arnim comme de Fichte et de Hegel, les surréalistes étaient, aux yeux de Camus, les héritiers de cette « pensée de minuit » en France. D’ailleurs, Breton n’allait pas tarder à le revendiquer : « A toute occasion ils [les surréalistes] ont fait valoir ce qu’ils devaient à la pensée allemande aussi bien qu’à la poésie de langue allemande. » (OC IV, 852) Au demeurant, le Second Manifeste prétendait, tout autant que le matérialisme historique, partir de « l’avortement colossal » du système hégélien. Or, tout le propos de L’Homme révolté se construit sur l’opposition de la pensée de midi à l’idéologie allemande, avec, notamment, l’exemple du triomphe de Marx contre les libertaires méditerranéens.
Est-ce l’effet du temps écoulé depuis cette polémique ? J’ai un peu le sentiment d’avoir traité d’un sujet sans existence réelle. À la question de savoir ce qui est le plus important, de la lune ou du soleil, de « la pensée de midi » ou de « la pensée de minuit », je ne puis m’empêcher de songer à l’imparable réponse des Sages de Chelm : « La lune, car elle éclaire la nuit. Le jour, on n’en a pas besoin. » C’était avant leur extermination par les nazis.
Henri BÉHAR
Pour fixer les idées, voici la liste des 19 œuvres de Camus traitées par Frantext :
1936n Révolte dans les Asturies : essai de création collective 8 945 mots, théâtre
1942, L’Étranger 39 692 mots, roman
1942, Le Mythe de Sisyphe 44 222 mots, essai
1944, Caligula, 24 647 mots, théâtre
1944, Le Malentendu, 18 220 mots, théâtre, tragédie,
1947, La Peste, 102 379 mots, roman
1948, L’État de siège, 29 888 mots, théâtre
1950, Les Justes, 20 302 mots, théâtre
1951, L’Homme révolté, 126 985 mots, essai
1953, LARIVEY (Pierre de), CAMUS (Albert), Les Esprits [adaptation], 14 604 mots, théâtre, comédie
1953, CALDERÓN DE LA BARCA (Pedro), CAMUS (Albert), La Dévotion à la croix [traduction et adaptation]n 19 845 mots, théâtre
1954, L’Été, 25 321 mots, essais (recueil de)
1955, BUZZATI (Dino), CAMUS (Albert), Un cas intéressant [adaptation], 28 070 mots, théâtre
1956, La Chute, 37 166 mots, roman, récit
1956, FAULKNER (William), CAMUS (Albert), Requiem pour une nonne, [traduction et adaptation], 29 640 mots, théâtre
1957, L’Exil et le royaume, 55 050 mots, nouvelles (recueil)
1957, VEGA (Lope de), CAMUS (Albert), Le Chevalier d’Olmedo [traduction et adaptation], 22 997 mots, théâtre, tragi-comédie
1959, DOSTOÏEVSKI (OU DOSTOEVSKIJ) (Fiodor Mikhaïlovitch), CAMUS (Albert), Les Possédés [adaptation], 47 881 mots, théâtre
1959, Noces, 15 599 mots, essais (recueil), poèmes en prose.
En ce qui concerne les textes de Breton, je me réfère à ma propre numérisation comportant l’intégralité de ses publications, à l’exception de Qu’est-ce que le surréalisme ? et de Position politique du surréalisme, qu’il me faut consulter sur papier.
1 ; Albert Camus, Arts, 23 novembre 1951.
« I paradossi del Secondo Manifesto del Surrealismo », catalogue exposition Pise, 1929, il grande surrealismo dal Centro Pompidou. Da Magritte a Duchamp », Genève, Skira, 2018, p. 154-174.
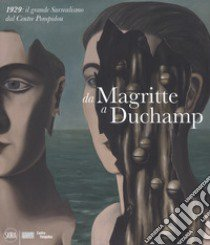
Le catalogue de l’exposition Pompidou à Pise De Magritte à Duchamp paraît en italien aux éditions Skira : Guarda Da Magritte a Duchamp 1929. Il grande Surrealismo dal Centre Pompidou sur Unilibro.it
Ma contribution, « Les paradoxes du Second Manifeste du surréalisme » y est publiée en italien. Voici la version originale, en français, de ce texte :
L’année 1929 n’est guère favorable pour André Breton, tant sur le plan social et collectif que sur le plan sentimental, avec un divorce qui n’en finit pas, et une maîtresse pour le moins versatile. La Révolution surréaliste, la revue qu’il dirige, seul, depuis sa quatrième livraison, ne s’est plus manifestée depuis deux ans (n° 10, 1er octobre 1927). Ce n’est pas brillant pour un organe qui prétend montrer la créativité du seul mouvement révolutionnaire de l’époque, et pas seulement sur le plan artistique ! Il convient de faire cesser cet état de fait au plus vite. À la suite de nombreuses conversations, non sans de longues hésitations, Breton s’est décidé à produire un texte d’orientation comme il est le seul, dans le groupe, à savoir le faire. Tout le monde lui reconnaît au moins ce mérite. Cet article devra expliquer aux lecteurs les raisons d’un tel silence et, du même mouvement, indiquer le Nord pour ses amis déboussolés. Rappel aux principes, appel aux jeunes « dans les lycées dans les ateliers même, dans la rue, dans les séminaires et dans les casernes », à tous les purs qui refusent le pli, ce texte qu’il veut en même temps informatif et performatif devra relancer le mouvement par un effort collectif de dépassement. [Lire la suite sur le PDF>>>>]
Voir également la publication numérique en français: http://melusine-surrealisme.fr/henribehar/wp/?p=1058
Lire le texte (numérisé) des Manifestes du surréalisme :

Éditorial
Patrick Besnier : Une chronique inconnue de Raymond Roussel
Daniel Grojnowski : Les années Chat Noir
Henri Béhar : Introduction au Potlatch André Breton
Michael Roelli : La « science du rêveur ». Jean Paulhan, onirologue
Entretien avec Claire Paulhan
Jean-Yves Mollier : Edouard Dentu, un éditeur collectionnaire du xixe siècle
Jacques-Remi Dahan : Une première lettre inédite de Charles Nodier à Herbert Croft
Günter Schmigalle : Trois lettres inédites de Laurent Tailhade à Rubén Darío
Philippe Chauvelot : Jean Lorrain, Lettres à Rachilde 1885-1903
Jean-Paul Goujon : Fernand Fleuret, Le Dr Jean Vinchon et Apollinaire
José Moure, Claude Schopp : Rémi sans famille d’Antoine Brossier
Chronique des ventes et des catalogues
En société
Livres reçus
[Télécharger l’article publié en PDF]
Voir l’ouvrage de référence :
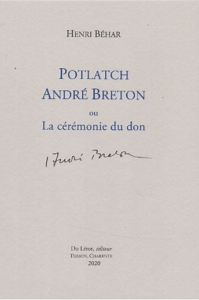
4ème de couv. :
Chaque année, au printemps, fleurissent les salons du livre où les curieux et les amateurs s’en viennent échanger des livres anciens, déjà lus. Mieux, il en est qui ne s’intéressent qu’aux ouvrages portant la signature de l’auteur. Ils sont encore plus satisfaits s’ils sont agrémentés de quelques mots autographes destinés au premier lecteur. Ils nomment cela « dédicaces » ou « envois ».
Il faut désormais prendre ces envois en considération, comme partie intégrante de l’œuvre d’un auteur, tout comme la génétique textuelle fait son miel des brouillons, des manuscrits, des journaux intimes, de la correspondance. Cela est si vrai que, pour ce qui concerne André Breton, ses héritières ont tenu à faire numériser, outre ses propres manuscrits, les premières pages des livres qu’il avait reçus, munis d’un envoi autographié.
Il s’agissait là de témoignages d’une conversation en cours, qu’il m’a fallu reconstituer en recherchant les « envois » écrits par André Breton lui-même. J’étais sûr qu’ils avaient existé, car Breton l’a montré à diverses reprises, il ne pouvait accepter un don sans rendre le contre-don, sous la forme de l’un de ses propres livres. Usage fort ancien, que les Indiens d’Amérique nomment le Potlatch. Le présent recueil prouve que le poète n’a jamais manqué au rituel.
Fait remarquable, ces messages occasionnels échappent au commerce des livres et deviennent des poèmes pour eux-mêmes, qui s’ajoutent, en trois dimensions, à ses œuvres complètes. En effet, il faut ici prendre en compte la parole, le message que le poète adresse oralement à son lecteur, connu pour être lui-même un auteur, ou du moins un lecteur averti.
D’où les notices consacrées à chacun des cinq cent destinataires : elles précisent, autant que possible, les relations qu’André Breton entretenait avec chacun d’eux, sur le plan du livre, de préférence. Outre les amis surréalistes, à toutes les époques, on y trouvera des personnalités pour le moins surprenantes, à tous les niveaux de la société.
H.B.
560 pages illustrées (dédicaces de et à André Breton – Michel Butor, Paul Claudel, Colette, Marguerite Duras, etc…)
Format : Broché
Nb de pages : 558 pages
Poids : 1200 g
Dimensions : 18cm X 25cm
Date de parution : 06/01/2020
ISBN : 978-2-35548-143-7
Une étude sur les envois offerts par André Breton (1896-1966) et ceux qu’il a reçus, dont certains sont reproduits. Reprenant une tradition amérindienne, le potlatch, qui consiste à s’échanger des cadeaux, le poète surréaliste faisait parvenir un exemplaire dédicacé d’un de ses livres à un correspondant, personnalité du monde des arts, des lettres ou de la politique, qui lui en avait offert un. ©Electre 2020
Compte rendu par Georges Sebbag :
Des envois à la pelle au vent – Philosophie et surréalisme (philosophieetsurrealisme.fr)
Compte rendu par Pierre Taminiaux :
Compte rendu par Alain Trouvé :
Et le complément du volume initial :
Potlatch André Breton complément | Henri Béhar (melusine-surrealisme.fr)
Dans le recueil Potlatch André Breton ou La Cérémonie du don, publié en 2020 par les Editions Du Lérot à Tusson, je pense avoir démontré que, s’il recevait un ouvrage muni d’un « envoi » autographe signé par l’auteur, André Breton ne tardait pas à lui faire le contre-don d’un de ses propres livres, récemment paru, ou encore adapté à l’image qu’il se faisait du signataire. Mais il est évident qu’il prenait souvent l’initiative de faire don d’un de ses ouvrages, orné d’un envoi spécifique, à ses meilleurs amis et à ses relations.
Je poursuis cette démonstration ci-après, dans un recueil complémentaire numérique au format PDF. Selon son goût, le lecteur pourra le lire directement sur écran ou bien l’imprimer pour insérer les pages dans le volume sur vélin de l’édition première.
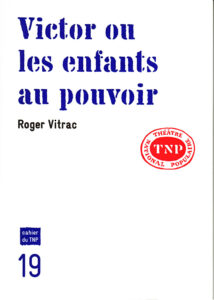
Couverture du Cahier du TNP n° 19. Lire cette publication sur: Calaméo – Cahier n°19 Victor ou les enfants au pouvoir (calameo.com)
[Télécharger l’article publié en PDF]
Par Henri BÉHAR
La Comédie de Bourges, alors Centre dramatique national, a monté Victor ou Les Enfants au pouvoir en octobre 1968. Son directeur, Guy Lauzun, s’étant servi de mon essai, récemment paru, concernant la vie et l’œuvre de Roger Vitrac, m’avait invité à la première. À l’époque, les gens de théâtre ne dédaignaient pas l’avis des critiques et des chercheurs, d’autant plus qu’ils avaient besoin, pour maintenir l’institution, d’une presse attentive. Curieux d’entendre, dans la salle, les échos possibles entre ce qu’on appelait alors pudiquement « les événements de mai 1968 », et ceux que la pièce évoquait, soixante ans auparavant, j’y courus.
À la fin du spectacle, la comédienne qui interprétait la belle Thérèse, Catherine Dejardin, vint me serrer la main et me fit part du trouble qui l’avait saisie au cours de sa prestation. Ma présence ayant été annoncée à l’avance, elle avait lu ou relu le passage que je consacrais à son personnage dans ma thèse. J’y disais que Thérèse, la femme adultère, était offusquée, choquée par le sentiment de l’inceste que les enfants, Esther et Victor, suggéraient lorsqu’ils imitaient les adultes adultères.
« J’ai bien compris que, dans la pièce, ma fille avait été conçue avec le père de Victor. Par conséquent, même par jeu, le mariage des enfants constituait un inceste. Mais comment le faire comprendre sur la scène ? » me dit ma ravissante interlocutrice.
C’était là un problème théâtral auquel je ne pouvais apporter aucune solution. En effet, contrairement à ce que je viens d’écrire, l’inceste n’est pas un sentiment mais un tabou ! « Inceste, que justice soit faite » proclament les journaux du jour (5 février 2019), se faisant l’écho d’un documentaire projeté à la télévision. Certes, c’est un crime, s’il est subi par un enfant. Aujourd’hui, notre société se focalise sur le viol d’un jeune par un de ses parents, mais, en vérité, l’inceste est surtout un interdit religieux, moral, civilisationnel. En dépit de la généralisation que fera Claude Lévi-Strauss (s’opposant aux observations de Bronislaw Malinowski), l’inceste est parfois recommandé, voire imposé, dans certaines sociétés ou certaines classes. Ainsi Toutankhamon, dont la découverte de la momie en 1922 intéressait tant Vitrac qu’il le mentionna dans ses œuvres, ce jeune pharaon, mort à dix-neuf ou vingt ans, était issu d’un inceste, et il avait épousé sa propre sœur, par obligation. Mais la pièce se passe en France, où l’inceste est prohibé juridiquement. Thérèse devait donc faire comprendre, par son jeu, que, sur les enfants imitant leurs parents, pesait un interdit d’une tout autre dimension : Freud et son Oedipe s’agitaient en coulisses.
J’avoue qu’il ne me serait pas venu à l’idée que l’interprète puisse hésiter sur le sens immédiat et les sous-entendus qu’elle pouvait laisser paraître au cours de sa prestation. Je le lui dis, en lui expliquant ce qui me paraissait évident à la lecture de la pièce. Son mari était dérangé depuis si longtemps qu’on pouvait en déduire qu’il souffrait dès qu’il avait appris que sa femme le trompait, avant la naissance d’Esther. D’où le fait que de mauvais esprits, tels que ceux des familles réunies pour l’anniversaire de Victor, pouvaient en déduire que les deux enfants étaient issus du même père. L’idée de les marier, suggérée par le Général, laissait entendre qu’il provoquait un inceste. Ce que les spectateurs avaient fort bien compris, d’autant plus que Vitrac le suggérait dans le programme, sans parler des propos expansifs d’Artaud, et de la vigoureuse approbation d’Antoine, le mari trompé, « histoire de rire » ! Ainsi, le Théâtre Alfred Jarry, qui se voulait révolutionnaire et surréaliste, défendait, implicitement, l’ordre moral et la bourgeoisie !
On comprend le désarroi de notre belle comédienne ! D’autant plus que, s’il s’oppose globalement à la société de son temps, le surréalisme, pris comme mouvement collectif, n’a guère discuté de ce tabou, et ne l’a ni loué, ni condamné (à l’exception de Paul Éluard, peut-être, positivement). En tout état de cause, les Manifestes du surréalisme n’objectent rien contre. C’est seulement en 1933 que le groupe publiera une brochure pour défendre la parricide Violette Nozière, arguant du fait qu’elle avait été violée par son père. Condamnaient-ils l’inceste, ou s’en servaient-ils pour accuser la victime et défendre la meurtrière, mettre en accusation « l’affreux nœud de serpents des liens du sang » (Eluard)? Le fait est qu’après avoir été condamnée à mort, la jeune Violette, au prénom annonciateur, a vu sa peine atténuée par trois chefs de l’État successifs, jusqu’à la grâce. Leurs arguments avaient porté.
Pour revenir à notre Victor, précisons que la malicieuse chanson d’Esther, naïvement interprétée par une jeune comédienne, aurait dû éclairer la salle entière sur le même sujet :
« You you you la baratte
La baratte du laitier
Attirant you you la chatte
La chatte du charcutier
You you you qu’elle batte
Pendant qu’il va nous scier
Le foie you you et la rate
Et la tête du rentier
You you you mets la patte
Dans le beurre familier
Le cœur you you se dilate
A les voir se fusiller
You you madame se tâte
Mais les fruits sont verrouillés
Que l’enfant you you s’ébatte
Dans son berceau le beurrier
Avant you you la cravate
Du bon petit écolier »
Si je parle du jeu innocent de l’actrice, c’est que le metteur en scène, à l’instar de Roger Vitrac, le voulait ainsi, et qu’il n’aurait pas admis une dénotation immédiate de la chanson qu’il voyait comme une parabole de l’acte sexuel tel que l’aurait perçu une enfant de six ans, à l’orée du siècle. D’ailleurs, les images du poème correspondent à l’univers rural de l’époque, avec, notamment la baratte, instrument érotique par excellence.
Depuis la création de la pièce, la critique évoque Georges Feydeau, en raison du vaudeville qu’elle suggère. Cette « mousse intellectuelle », pour parler comme Vitrac, n’a jamais tort. À ceci près que le dramaturge s’empare des structures vaudevillesques traditionnelles pour les retourner comme un gant, à l’invitation du programme théorique et poétique de Lautréamont.
Ainsi, Vitrac ne se contente pas du trio vaudevillesque initial, le mari, la femme et l’amant, donnée trop facile du théâtre 1900. Il entend ici fournir un spectacle réaliste, et, plus précisément surréaliste, tel que le représenteraient deux couples amis, ou, plutôt, un quatuor, chargé d’incarner l’adultère le plus commun. À ceci près que l’un des protagonistes, le mari trompé, est désaxé, que les enfants des deux couples sont, suppose-t-on, frère et sœur, et que le garçon dont on fête l’anniversaire a décidé de détruire toutes les conventions. Marionnettiste supérieur, il entend bien mener tout ce personnel de guignol à la mort, et il y parviendra.
Victor profite de l’occasion qui lui est offerte pour refermer la souricière sur la scène fictive du salon familial. Comme Hamlet prenant le roi et la reine de Danemark au mirage du théâtre, il mime avec Esther les relations coupables de Charles et Thérèse qui se troublent et se dénoncent en public, pendant qu’Antoine, émoustillé et moins inconscient qu’il n’y paraît, lutine Émilie. Dignement, et comme pour assurer la révélation, celle-ci déclare : « Qu’il soit bien entendu que je n’ai rien compris à cette scène. » Défaite générale des adultes ; Antoine prend du champ et se retire, seul. Jouant de la stupidité du Général, Victor n’a plus qu’à le faire mettre à quatre pattes. Le premier acte s’achève sur une séance de dressage.
Dès lors, le programme du dramaturge nous semble parfaitement établi. Certes, il se doit de mettre en œuvre les procédés du vaudeville, mais, dans le même temps, comme nous l’enseigne le Président Macron, il lui faut les pervertir par les moyens que le surréalisme met en évidence, et qu’il a lui-même expérimentés dans ses œuvres précédant Victor : le récit de rêve et le rêve ; les jeux de mots (à effet destructeur) ; la dissociation des idées ; l’apparition de l’inconscient, c’est-à-dire de l’inconvenant pour le spectateur.
Je n’ai pas le loisir, dans cette courte intervention, de recenser tout cet arsenal que Roger Vitrac a mis en œuvre pour construire, le premier et quasiment le seul, le drame surréaliste qu’il postulait. Il suffit de se reporter à certaines piécettes que j’ai publiées dans le tome III de ses œuvres théâtrales. Ainsi, Le Peintre, où l’enfant innocent, préfigurant Victor, apprend à son propre détriment la distance entre le mot et son objet : je m’appelle Lebrun et je suis blanc ! Ailleurs, le spectacle est constitué de récits de rêve cousus entre eux par une seule scène rationnelle. Les Mystères de l’amour (1923) fournissent un superbe exemple de l’écart, de la contradiction entre le geste et la parole, entre le manifeste et le latent. Ainsi, Dovic, proteste de son amour pour Léa :
… « je t’ai toujours aimée (il la pincé). Je t’aime encore (il la mord). Il faut me rendre cette justice (il lui tiraille les oreilles). Avais-je des sueurs froides (II lui crache au visage). Je te caressais les seins et les joues ? (Il lui donne des coups de pied). Il n’y en avait que pour toi (II fait mine de l’étrangler). Tu es partie (II la secoue violemment). T’en ai-je voulu? (Il lui donne des coups de poing). Je suis bon (II la jette à terre). Je t’ai déjà pardonné. »
On trouve dans ses Poésies complètes un fragment générateur de notre drame, que nul critique n’a commenté, à ma connaissance :
« On est criminel à tout âge. Et toute leur vie ils la passeront autour d’un gâteau fait avec des épaules et des seins et décoré de précipices et de couronnes en feu.
a lampe, le ciel du lit et l’enfant même. Ah ! ce dernier, s’ils le soupçonnent de porter l’enfer autour d’un chapeau vermillon signé Jean-Bart ils le marqueront d’une dentelle d’écorchures jusqu’à ce que ses yeux trahissent l’inceste.
Et je les vois tous les trois endormis dans le sirop de groseille. » (Dés-Lyre, p. 139)
Toute la tragédie est déjà en place (avec sa parodie), à partir du noyau familial, avec la tenue d’un garçonnet de l’époque, notamment ce chapeau de paille dénommé Jean-Bart, le gâteau d’anniversaire, et, bien entendu, l’inceste qui revient comme une obsession. Le sang aussi, figuré par du sirop de groseille. A priori, le poème apparaît comme un regard attendri porté sur l’enfance. En fait, c’est exactement le drame que Vitrac portera au théâtre une dizaine d’années plus tard.
« Ce drame tantôt lyrique, tantôt ironique, tantôt direct, était dirigé contre la famille bourgeoise, avec comme discriminants : l’adultère, l’inceste, la scatologie, la colère, la poésie surréaliste, le patriotisme, la folie, la honte et la mort. » expliquait Vitrac aux spectateurs du Théâtre Alfred Jarry.
La cible était clairement désignée. Les discriminants aussi, encore qu’ils ne soient pas tous sur le même plan, on le voit pour l’inceste qui n’est qu’évoqué et non montré dans la pièce. On pourrait en dire autant de la mort, incarnée par Ida Mortemart, autrement dit la vie dans la mort. Outre l’agressivité du personnage envers le public, la caricature tragique du Pétomane de l’Eldorado, il y avait cette difficulté, non pas à dire la mort (tout le monde en parle tout le temps) mais à la montrer, venant érotiquement prendre l’enfant sur ses genoux pour le conduire au néant. L’idée diabolique de Vitrac, rarement exposée depuis, est d’imaginer la mort comme un individu mortel, ici une femme, par-dessus le marché, elle-même déjà investie par la destruction, qui se manifeste de façon sonore et scatologique : « et je ne puis rien contre ce besoin immonde. Il est plus fort que tout. Au contraire, il suffit que je veuille, que je fasse un effort pour qu’il me surprenne et se manifeste de plus belle. Elle pète longuement. Je me tuerai, si cela continue, je me tuerai. »
Serait-ce, paradoxalement, une vision d’espoir ? Il m’a toujours paru étonnant que, à la fin de sa vie brève, dans ses carnets intimes, Vitrac se soit intéressé à la notion de destrudo, explorée, avec tant de difficultés, par Freud, et qu’il ait voulu la concrétiser dans un drame, un autre Victor.
Bibliographie : on trouvera Dés-lyre sur mon site, ainsi que mes études : http://melusine-surrealisme.fr/henribehar/wp/
Voir les informations sur ce spectacle, distribution, revue de presse, etc. : https://www.tnp-villeurbanne.com/manifestation/victor-ou-les-enfants-au-pouvoir/
Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac / mise en scène Christian Schiaretti. Du jeudi 7 mars au samedi 30 mars 2019.
Inspirée par l’esthétique provocatrice de Alfred Jarry, cette pièce aux allures de vaudeville joue en réalité avec les tabous et les interdits de la société.
Portée avec fougue et inventivité par les comédiens fidèles du TNP, elle propose un moment de théâtre salutairement sulfureux.
Le jour de ses neuf ans, Victor, qui soupçonne son père d’avoir une relation avec la femme de son meilleur ami, dénonce l’hypocrite comédie qui se joue quotidiennement dans le cercle familial. En brisant le précieux vase de Baccarat, il accomplit un geste prémonitoire. Son père cassera, peu après, un second vase, matérialisant ainsi l’éclatement de son couple. Malgré la mort, qui d’emblée plane sur les personnages, la pièce multiplie les gags burlesques et donne à voir une série de mauvais tours fomentés par Victor. Doté d’une exceptionnelle lucidité, cet enfant de « deux mètres et terriblement intelligent » mène rondement le jeu, pressé de faire jaillir la vérité. Chaque protagoniste devient sa cible. Alors qu’il jubile, sûr de parvenir à ses fins, il est à mille lieues de soupçonner ce qu’il va apprendre. Après avoir réglé ses comptes avec les autres, c’est à présent avec lui-même qu’il doit le faire. La farce vire au drame. Totalement déstabilisé par sa découverte, ce n’est ni dans l’exaspérante passivité d’une mère, ni dans l’irresponsabilité d’un père absent qu’il peut espérer trouver un appui. Le dénouement sanglant, annonce, avant l’heure, ce « théâtre de la cruauté » cher à Artaud qui en fut le premier metteur en scène. Pour lui, cette pièce fait preuve « d’un esprit d’anarchie profonde, base de toute poésie ».
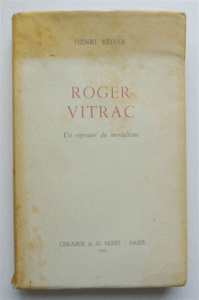
Télécharger le ce livre numérisé : Télécharger [attention, fichier pesant]
Compte rendu: Critique : [Untitled] sur JSTOR
H. Béhar : Vitrac, théâtre ouvert sur le rêve. L’Age d’Homme. Télécharger le texte numérisé :
