Cahiers Albert Cohen N°25
Albet Cohen : la littérature à l’épreuve
Mathieu Bélisle & Philippe Zard
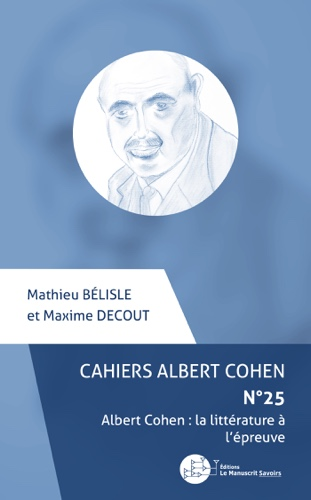
Au nom d’Albert Cohen est attachée l’image d’une œuvre inclassable, qui échappe à toutes nos normes, qui bouscule nos habitudes de lecteur. Radicalité comique, lyrique, polémique : on trouve là une façon souveraine et absolument inattendue de renouveler le genre romanesque. Si l’écrivain a affirmé avoir cessé de lire dans la trentaine, son œuvre est pourtant marquée par ce qui pourrait tenir lieu d’une lutte avec et contre la littérature. Car ses textes regorgent d’allusions, de citations, de parodies, de pastiches, de réécritures parfois dissimulées, parfois affichées, où l’écriture se questionne elle-même dans le miroir de celle des autres. Les études réunies ici auscultent les nombreuses facettes de ce rapport avec la littérature, questionnent le rôle des modèles et contre-modèles, des influences et des inspirations, qui déterminent la manière inédite dont Cohen construit tant son esthétique qu’une éthique de la littérature.
===> Ce volume consigne les communications prononcées au colloque Albert Cohen : la littérature à l’épreuve, les 28 et 29 mai 2015, à Université Lille, sous la direction de Mathieu Bélisle et Maxime Decout. Voici mon intervention :
La littérature par l’estomac
Je ne sais pas s’il vous est déjà arrivé de lire au début d’un article que l’auteur se référait à, je cite, « la méthode d’Henri Béhar ». C’est assez surprenant, car, si je reconnais avoir tenté de divulguer la méthode Hubert de Phalèse, élaborée collectivement, et dont je ne suis que le vulgarisateur, je n’ai jamais revendiqué une approche de la littérature portant mon nom. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, dit-on !
Au cours de ma carrière active, j’ai tenté de systématiser deux manières d’aborder le fait littéraire : la méthode Hubert de Phalèse, d’une part, qui repose sur un certain usage des outils numériques, et l’analyse culturelle des textes, d’autre part. Aujourd’hui, je voudrais les articuler toutes deux à propos de l’œuvre d’Albert Cohen, en montrant comment, partant de l’estomac, celui-ci en arrive à traiter de l’interdépendance de toutes les parties du corps, et donc, à l’instar de Rabelais, à la pensée.
I. La méthode Hubert de Phalèse
La méthode Hubert de Phalèse fut mise au point avec mes étudiants à partir des années quatre vingt du siècle passé1. Elle comporte plusieurs phases successives, indispensables, à mes yeux, pour qui veut étudier un texte à la lettre. Ensuite, vient le moment de construire un dictionnaire caractéristique du vocabulaire de l’auteur, et, plus précisément, des mots difficiles (je veux dire par là qu’ils sont inconnus de l’élève idéal du secondaire, auquel le professeur est censé s’adresser) ou dont le contexte modifie le sens usuel.
En un mot, il s’agit, à l’aide de l’outil informatique, de rechercher systématiquement les termes impliqués par ce vocabulaire, de prélever les occurrences dans leur contexte, de constituer une sorte de dictionnaire, sans omettre les nuances de chaque emploi. La mise en série permet de signaler les variations les plus subtiles d’un terme, de voir comment il contraste avec son entourage.
Même si la démarche est automatisée, il n’y a rien de mécanique ici, puisque l’objectif final est bien d’interpréter un texte, d’en venir à une herméneutique intégrale de l’œuvre-vie d’Albert Cohen. J’ajoute que les citations prélevées exigent un va et vient : de la table à la bouche, de la nourriture au texte, et réciproquement.
II. L’analyse culturelle des textes
De même que pour la méthode Hubert de Phalèse, j’ai, à plusieurs reprises, tenté de codifier la méthode d’analyse culturelle des textes2. Le simple énoncé des termes dit comment il faut comprendre la chose.
Mais, direz-vous, dès lors qu’un texte est écrit en bon français, comme l’est à première vue celui d’Albert Cohen, pourquoi parler d’analyse culturelle ? Cohen n’est-il pas, quelle que soit la nationalité inscrite sur son passeport, un digne représentant de notre littérature ?
Certes ! Toutefois, comme pour tout écrivain français ou francophone, son œuvre ne saurait se passer de nos analyses.
Ici, je dois vous faire part de la rage qui m’a pris à la lecture de certaines informations erronées trouvées sur Internet et même dans certains livres prétendus savants. Ainsi, une lectrice sensible à la beauté du Livre de ma mère prétend-elle « interpréter » un passage, qu’elle cite tout du long, en lui adjoignant la recette de l’agneau à la grecque. Bon ça ! mais le malheur est que la recette mélange la viande et le fromage, ce que la maman du petit Albert, Madame Louise Cohen, qui n’ignorait aucun des préceptes de sa religion (qu’elle transmit oralement à son fils) n’eut jamais fait cela ! Etre circonspect, il le faut toujours. Nul besoin d’être circoncis pour le savoir ! Est-ce trop demander que d’exiger qu’une personne qui ajoute son grain de sel à l’admirable prose de l’écrivain, de se renseigne un peu avant d’écrire, et surtout que, catholique, elle lise l’Ancien Testament, chose recommandée par le Pape lui-même, depuis Vatican II, indispensable pour la compréhension de la littérature française ! Les athées ne s’y trompent pas, quant à eux.
Tel autre nous procure la recette de la moussaka de la même façon, en prétendant suivre celle de Mangeclous, mais en y ajoutant une sauce béchamel qui n’est pas dans le texte, qui n’a rien à y voir, toujours en raison des interdits alimentaires consignés dans le Lévitique, transmis de génération en génération par les femmes !
Tel autre encore, autoproclamé spécialiste d’Albert Cohen, trouve dans le parler de Mariette, la vieille bonne suisse, des traces de judéo-espagnol et de yiddish, là où ne sont que des mots du vocabulaire rhéto-roman, plus précisément du romanche, une des quatre langues officielles de la Suisse !
C’est dire qu’il ne suffit ni de bonne volonté, ni de diplômes universitaires, pour comprendre, aujourd’hui, ce que Cohen a voulu signifier, consciemment ou non. Voilà pourquoi je me suis senti obligé de recommander, à nouveau, une analyse culturelle des textes d’Albert Cohen, assistée par ordinateur, dont je donnerai ici une brève illustration.
III. application à l’œuvre d’Albert COHEN : la littérature par l’estomac
Originaire de Corfou, Albert Cohen invite le lecteur à la table de son enfance. Comme tous les orientaux, ce juif séfarade ne se contente pas d’y faire servir les plats de sa tradition familiale : il les nomme, les décrit, il va même jusqu’à en donner la recette ! Et ceci pour être certain d’être bien compris. Sa littérature n’est pas seulement nourrissante intellectuellement : comme l’œuvre rabelaisienne, elle enseigne tout un univers moral et politique en flattant Messere Gaster.
Pour rester dans le délai imparti, je me bornerai ici à l’étude de trois éléments : la culture biblique ; la fête ; la langue.
Une culture orientale et biblique
Mangeclous est le Panurge des temps modernes. Pour comprendre son comportement, pour goûter (c’est le cas de le dire) la nourriture qu’évoque Albert Cohen dans ses livres, il faut s’imprégner d’un minimum de la culture « israélite » (pour employer son vocabulaire, du temps de la III’ République).
Héritier de la caste sacerdotale, comme son nom l’atteste, baigné de culture rabbinique par un père romaniote, nous dit-on ; fortement attaché à sa mère, la gardienne de la Loi, il mentionne, comme en passant, ce qui conditionne l’appréhension du monde par ses personnages. Ainsi Saltiel le sage écrit-il à son neveu Solal qu’à Londres les autobus « ont la couleur de la viande saignante, abomination aimée des païens, et si tu te maries comme mon cœur le désire, recommande à ta délicieuse épouse de bien saler la viande et même de la laver avant de la cuire afin d’en ôter le sang qui pourrait y rester » (Val.275). Cette sainte horreur du sang – la vie – est conforme aux règles du Lévitique (17.10-16), et à leurs conséquences pratiques consignées dans La Table dressée (Choulhan Aroukh), le code alimentaire élaboré à Safed au xvie siècle par Joseph Caro. C’est la raison pour laquelle Mangeclous étalant la nourriture pour le pique-nique sort des « saucisses de bœuf garanties de stricte observance » (BDS, 559). De bœuf, donc, car ses amis ne sauraient manger du porc, interdit par la religion. Lui-même s’accorde bien « Quelques tranches de jambon, qui est la partie pure et israélite du porc » (BDS, 216), ou encore « Comment, tu manges du porc ? souffla Salomon épouvanté. – Le jambon est la partie juive du porc, dit Mangeclous » (Val.253) plutôt par provocation, geste d’un esprit fort !
À Londres même, Mangeclous et ses cousins ne consomment que des nourritures dites cacher, admises par la Loi. Il sort de deux couffins ce petit en-cas qu’il s’est procuré chez un juif levantin :
« Quatre paires de boutargues dont par droit léonin je me réserve la moitié ! Pas d’opposition ? Adopté ! Douze gros calmars frits et croustillants mais un peu résistants à la dent, ce qui en augmente le charme ! Huit pour moi car ils sont ma passion suprême ! œufs durs à volonté, cuits durant toute une journée dans de l’eau garnie d’huile et d’oignons frits afin que le goût traverse ! Ainsi m’assura le noble épicier traiteur et coreligionnaire, que Dieu le bénisse, amen ! …Allons, messieurs, à table ! Branle-bas de mangement ! » (BDS, 559)
Tous ces produits, venus du bassin méditerranéen, sont l’arrière-plan sur la table religieusement dressée par Albert Cohen qui, cela mérite d’être noté, n’emploie aucun nom local pour les dénommer, à l’exception du loucoum, lui-même dans une graphie très francisée. Portant barbe et calotte, voyez-les manger, ces cousins de Céphalonie, l’île mythique qui n’a évidemment rien à voir avec l’actuelle Corfou !
La Pâque. Le seder
Il ne faut pas s’y méprendre : en dépit de leur constante fantaisie, les Valeureux sont bien de leur époque, ils louent le Dieu unique et sont naturellement religieux. Ainsi lorsque Solal évoque son enfance (tout comme le narrateur), c’est au premier soir de la fête commémorant la sortie d’Égypte qu’il songe, décrivant au style indirect libre chaque étape du repas rituel (lui-même conçu pour marquer chaque épisode du récit historique) y mêlant mot pour mot le texte sacré :
« …ô mon enfance à Céphalonie ô la Pâque le premier soir de la Pâque mon seigneur père remplissait la première coupe puis il disait la bénédiction, dans Ton amour pour nous Tu nous as donné cette Fête des Azymes anniversaire de notre délivrance souvenir de la Sortie d’Égypte sois béni Éternel qui sanctifies Israël, j’admirais sa voix après c’était l’ablution des mains après c’était le cerfeuil trempé dans le vinaigre après c’était le partage du pain sans levain après c’était la narration mon seigneur père soulevait le plateau il disait voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d’Égypte quiconque a faim vienne manger avec nous que tout nécessiteux vienne célébrer la Pâque avec nous cette année nous sommes ici l’année prochaine dans le pays d’Israël cette année nous sommes esclaves l’année prochaine peuple libre, ensuite parce que j’étais le plus jeune je posais la question prescrite en quoi ce soir est-il différent des autres soirs pourquoi tous les autres soirs mangeons-nous du pain levé et ce soir du pain non levé j’étais ému de poser la question à mon seigneur père alors il découvrait les pains sans levain il commençait l’explication en me regardant et je rougissais de fierté il disait nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte et l’Éternel notre Dieu nous en a fait sortir par Sa main puissante et Son bras étendu, » (BDS, XCIV, 753)
Je n’ai pas l’intention d’expliquer mot à mot ce morceau d’anthologie sans ponctuation, ni de fournir une analyse sémiotique de la cérémonie1. Cependant, le lecteur, faute d’avoir assisté à ce repas de fête, doit en connaître le substrat, un certain nombre d’indications relevant de ce que l’on peut, à bon droit, nommer la culture juive, à commencer par l’autre nom que les juifs donnent à cette cérémonie, la fête des Azymes (hag amatsot).
Tout d’abord, il faut savoir que la fête de Pâque commémore plusieurs événements en même temps, traditionnels d’une part, historiques de l’autre. Elle revêt une double signification, fête agreste à l’origine, elle est devenue fête commémorative de la sortie d’Égypte.
Solal se remémore le rituel du dîner familial, le premier soir de la Pâque. En français, on écrit Pâque au féminin singulier, ce vocable étant supposé transcrire le mot hébreu Pessach, qui désigne le passage de l’ange de la mort, qui épargna les maisons des hébreux quand Dieu fit mourir les premiers nés d’Égypte. L’accent circonflexe porte la trace du S étymologique (en latin et en grec). Il est devenu facultatif depuis une réforme (manquée comme elles le sont toutes) de l’orthographe. L’expression la Pâque juive, opposée à la fête chrétienne de Pâques, sonne comme un pléonasme, en tout cas par écrit, puisque l’article défini et l’absence de s final devraient suffire à démarquer les deux religions. Hélas, la question se complique avec la fête célébrée par les Églises orthodoxes (grecques et russes) qui usent de la même graphie que les juifs ! De ce fait, la précision s’impose parfois, au risque de la redondance. Ici, Albert Cohen aurait pu translittérer le mot hébreu Pessah, en raison du contexte évoqué. Mais nous avons vu qu’il tend à réduire au strict minimum les emprunts lexicaux, surtout les emprunts à l’hébreu.
Ensuite, la table est mise. La mère a allumé les bougies, elle a disposé au centre un plateau contenant une côte d’agneau grillée, symbole de l’offrande pascale, l’holocauste, l’animal autrefois sacrifié, avant la destruction du Temple ; un œuf dur, symbole du deuil, en souvenir de la destruction du Temple ; les herbes amères (maror) rappelant les dures conditions de l’esclavage ; le harosset (mortier) représentant les travaux de construction auxquels les hébreux étaient soumis en Égypte ; trois matsot commémorant la sortie d’Égypte ; et quatre coupes de vin qui seront bues à différentes étapes de la soirée, les hommes étant accoudés sur le côté gauche, en signe de liberté.
N’ayons garde d’oublier la place vacante, réservée au prophète Élie, supposé devoir annoncer la venue du Messie. En cette attente, elle peut être occupée par un pauvre.
Les rabbins comptent 15 étapes dans le déroulement de la soirée. Solal n’en retient que la moitié. Permettez-moi de vous y renvoyer.
Tout en évoquant ses souvenirs d’enfance, avec tout ce qu’ils comportent d’affectif, Solal relève le caractère pédagogique de cette mise en scène commémorative. En même temps, il y célèbre la mémoire de son père, sa belle voix de cantor. La locution « le seigneur père » détone en français. C’est un calque du judéo-italien parlé par la mère, aussi bien que du judéo-espagnol généralement pratiqué par les colonies juives en Grèce.
Ce père majestueux n’est donc pas exactement celui de l’écrivain, mais on ne peut se dispenser d’y voir un hommage à celui qu’il a fort mal traité dans l’ensemble de son œuvre, au profit de la Mère.
Malgré la précision du souvenir, et le déroulement rigoureux de la cérémonie, le Narrateur (et par voie de conséquence Solal) en a omis un certain nombre de phases, notamment celle, tragique, qui nomme les dix plaies d’Égypte, dont les Hébreux furent épargnés. Les assistants détournent le visage de la table, le père, tout en lisant à haute voix, verse de l’eau d’une aiguière pour symboliser le miracle divin.
1. Celle-ci nous a été fournie, magistralement, par Jean-Pierre Goldenstein dans Lingistique et discours littéraire, théorie et pratique des textes, Paris, Larousse, 1983, 351 p.
Les jours terribles
Or, les deux livres mentionnés ont paru après ce qu’on nomme improprement l’Holocauste ou, tout aussi mal, la Shoah (anéantissement en hébreu) ou encore le génocide. Après l’esclavage millénaire, le Narrateur écrit dans la mémoire de la destruction massive : « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz, et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêtés à Nice, gazés à Auschwitz » (Val.225).
C’est le même qui, dans un cauchemar, voit sa mère dans la France occupée, ramassant dans la rue de vieilles hardes pour les mettre dans une valise contenant une étoile jaune (LM, 114). Le même encore, qui se remémore la disparition de sa mère à Marseille, tandis qu’il était à Londres.
Impossible de rien comprendre aux sentiments et aux comportements des uns et des autres si l’on ne voit qu’ils se détachent sur un tel arrière-plan. Mais il y a plus, et sans doute plus intimement inscrit dans leur chair. C’est que, s’ils n’ont pas connu la persécution directe ni la Shoah (ce vocable est absent de Belle du Seigneur et des Valeureux), ils savent ce que furent les pogroms que subirent toutes les communautés juives de Russie, de Pologne ou de l’Empire ottoman. Par-delà ses risibles manies, c’est bien ce qui pousse Mangeclous et ses coreligionnaires à l’accumulation de nourritures, en dépit du côté tartarinesque de l’action :
« Les Juifs se hâtèrent de faire sceller des barreaux à leurs fenêtres et amassèrent, tout comme en temps de pogrome, force provisions : farine, pommes de terre, pains azymes, macaronis, pains de sucre, œufs, saucisses de bœuf, chaînes de piments, d’oignons et d’aulx, boulettes de tomates séchées au soleil et marinées dans l’huile, graisse d’oie et jarres d’eau, viandes fumées, purgatifs et médicaments. » (Mangeclous, 88)
En somme, l’œuvre carnavalesque ne s’explique que par son contraire, l’évocation de la mort programmée. Non point la mort naturelle de l’homme, mais celle qui a été décidée au nom d’on ne sait quelles aberrations de l’esprit, lors de ladite Conférence de Wannsee, le 22 janvier 1942.
La veillée de Pâque s’achève par des chants traditionnels, à valeur pédagogique et morale. Il se nomme Had gadia (en hébreu, ou plus exactement, en araméen), et raconte l’histoire d’un petit chevreau que mon père m’a acheté pour deux blanchets. Et le chat est venu, qui a mangé le petit chevreau que mon père m’a acheté pour deux blanchets. Et vint le chien qui mordit le chat qui mangea le petit chevreau que mon père m’acheta pour deux blanchets. Puis vint le bâton qui frappa le chien qui mordit le chat… La kyrielle se poursuit jusqu’à l’arrivée de l’ange de la mort, qui égorge le sacrificateur qui a tranché la vie du bœuf, etc. Mais ce n’est pas le dernier mot : enfin vint Dieu, béni soit-il, qui égorgea l’ange de la mort qui… pour deux blanchets.
On voit quelle morale les petits enfants peuvent en tirer, et même les adultes, comprenant que nul n’occupe une place qui ne puisse lui être contestée par plus fort que lui.
Cette comptine, à proprement parler, de tradition séfarade, est chantée en judéo-espagnol, mais aussi en hébreu et en yiddish. Dans son récit, Solal ne semble pas s’en souvenir. Néanmoins, l’ange de la mort est évoqué à plusieurs reprises par les Valeureux. Ainsi Mangeclous explique l’avarice de Mattathias par la peur que lui procure l’idée de l’ange de la mort :
« De plus je comprends pourquoi il ne stocke jamais d’épices, c’est parce que s’il venait tout à coup à défaillir dans les bras de l’ange de la mort et des épouvantements il resterait en sa cuisine du sel ou du poivre et ce serait du gaspillage […]! » (BDS, 746)
Conclusion
Et voici sur la table toutes les senteurs, toutes les saveurs, toutes les splendeurs de la cuisine judéo-balkanique qui vous pénètrent, répandant le plaisir, la joie de vivre, même dans les jours les plus noirs, car sa leçon est toujours la même : « lehaim » à la vie, dit-il, levant symboliquement son verre de vin.
Lire toute l’œuvre d’Albert Cohen à partir des plats qu’il évoque, ce n’est pas seulement se déplacer dans son univers imaginaire, c’est aussi approcher son mode de création et caractériser de la même façon les individus auxquels il insuffle un relief, une vie spirituelle sans équivalent, tant la nourriture est consubstantielle à l’individu. Tel le Dieu unique qu’ils prient quotidiennement, pour eux, l’esprit et la matière ne font qu’un.
Ne nous y trompons pas : la langue d’Albert Cohen, savamment travaillée, est un français recherché, qui refuse la couleur locale. Ce n’est pas un guide touristique ni culinaire. Pas de tarama, pas de dolma, pas de fila ni de beureks, pas d’albondigas, pas de boyos ni de yaprak, aucun de ces termes qui abondent dans les livres de cuisine ou même dans les mémoires des Séfarades. C’est pourquoi il faut se référer aux craquelins, aux feuilles de vigne (Val.249), aux boulettes et autres feuilletés, etc. De telle sorte qu’on se croirait à la table de La Reynière, tout surpris de découvrir une cuisine à l’huile où l’aubergine et la tomate sont reines. Exceptions notables : le raki offert par Aude à Saltiel (Solal, 233) ; le loucoum, la moussaka et le cascaval, peut-être parce qu’il s’agit là de noms et de produits d’origine turque ? Et enfin le halva, terme authentiquement turc, prononcé du bout des lèvres par Ariane, prémices de la discorde entre les amants (qui auraient mieux fait d’en consommer davantage !).
Outre ce souci, légitime, d’employer un français épuré, d’extension universelle, chez un auteur dont la langue maternelle, le judéo-vénitien nous dit-il, n’était pratiquée que par un millier de personnes à Corfou, à l’époque où il y naquit, il y a peut-être celui de renforcer le mythe des Valeureux de France, émancipés par la Révolution française, « faits citoyens français parfaits par l’effet du charmant décret de l’Assemblée nationale du vingt-sept septembre 1791 » selon Saltiel, fiers de le rester et d’entretenir « le doux parler » de notre pays.
En tout état de cause, l’absence remarquable du vocabulaire étranger, le refus de l’emprunt témoignent du souci d’assimilation, voire d’intégration, de la part d’Albert Cohen. Intégration réussie, non seulement par sa carrière de haut fonctionnaire international, mais encore comme écrivain français.
N’oublions pas qu’il est un immigré, juif de surcroît, ce qu’il ne risque pas d’oublier, comme en témoigne la scène du camelot antisémite, l’injuriant et le désignant à la vindicte publique le jour anniversaire de ses dix ans (Ô vous, frères humains, p. 38), scène indélébile, qui revient à plusieurs reprises et ne sera jamais oubliée puisqu’il en traitera encore passé ses 80 ans (Carnets 1978, p. 19). Scène fondatrice, symbolique, lui révélant l’impossibilité de toute assimilation. Ce n’est pas exactement la leçon qu’il en tire, de même que Swann évincé du clan des Verdurin ne croit pas un instant que son éviction puisse provenir de sa judéité, lui qui, parallèlement, est reçu et même réclamé par le Faubourg Saint-Germain. Tout lecteur de bonne foi, parvenu à la fin d’À la Recherche du temps perdu, c’est-à-dire au Temps retrouvé, ne manquera pas de s’en rendre compte1. Reste que la question de l’assimilation ne manque pas d’être toujours actuelle, et que, par la contradiction qu’elle comporte en elle-même, elle confère une grande richesse à l’œuvre qui en est issue.
===> La troisième partie de cette communication a été reprise, avec une entrée en matière différente, dans mon volume: Essai d’analyse culturelle des textes, Classiques Garnier, 2022, p. 123-131.
1. Voir ma préface à Du côté de chez Swann, éd. Pocket.
Par la suite, je devais reprendre les mêmes arguments en guise de présentation du volume à table avec Albert Cohen, au Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme, le 17 janvier 2016. Divers incidents techniques, dont l’annonce de cette séance le matin même par courriel, firent que je m’en tins à des considérations générales, en me prêtant aux questions des auditeurs, sous la présidence du professeur Haïm Vidal-Séphia.
Causerie faite au MAHJ le 17 janvier 2016
Durant toute mon activité d’enseignant-chercheur, j’ai tenté de systématiser deux manières d’aborder le fait littéraire : la méthode Hubert de Phalèse, d’une part, qui repose sur un certain usage des outils numériques ; l’analyse culturelle des textes, d’autre part, qui, comme son nom l’indique, postule que tout texte convoque différentes cultures. Aujourd’hui, je voudrais les articuler toutes deux à propos de l’œuvre d’Albert Cohen, en montrant comment, partant de l’estomac, celui-ci en arrive à traiter de l’interdépendance de toutes les parties du corps, et donc, à l’instar de Rabelais, à la pensée.
***
La méthode Hubert de Phalèse fut mise au point, avec mes étudiants, à partir des années quatre vingt du siècle passé. Elle comporte plusieurs phases successives, indispensables, à mes yeux, pour qui veut étudier un texte à la lettre.
En bref, il s’agit, aidé de l’outil informatique, et pourvu que l’oeuvre soit entièrement numérisée, de rechercher systématiquement les termes impliqués par ce vocabulaire, de prélever les occurrences dans leur contexte, de constituer une sorte de dictionnaire, sans omettre les nuances de chaque emploi.
Même si la démarche est automatisée, il n’y a rien de mécanique ici, puisque l’objectif final est bien d’interpréter un texte, d’en venir à une herméneutique intégrale de l’œuvre-vie d’Albert Cohen. J’ajoute que les citations prélevées exigent un va et vient : de la table à la bouche, de la nourriture au texte, et réciproquement.
***
De même que pour la méthode Hubert de Phalèse, j’ai, à plusieurs reprises, tenté de codifier la méthode d’analyse culturelle des textes. Le simple énoncé des termes dit comment il faut comprendre la chose.
Mais, direz-vous, dès lors qu’un texte est écrit en bon fiançais, comme l’est à première vue celui d’Albert Cohen, pourquoi parler d’analyse culturelle ? Cohen n’est-il pas, quelle que soit la nationalité inscrite sur son passeport, un digne représentant de notre littérature ?
Certes ! Toutefois, comme pour tout écrivain français ou francophone, son œuvre ne saurait se passer de nos analyses.
***
Ici, je dois vous faire part de la rage qui m’a pris à la lecture de certaines informations erronées trouvées sur Internet. Ainsi, une lectrice sensible à la beauté du Livre de ma mère prétend « interpréter » un passage, qu’elle cite tout du long, en lui adjoignant la recette de l’agneau à la grecque. Bon ça ! mais le malheur est que la recette mélange la viande et le fromage, ce que Madame Louise Cohen, qui n’ignorait aucun des préceptes de sa religion (qu’elle transmit oralement à son fils) n’eut jamais fait cela ! Est-ce trop demander que de souhaiter qu’une personne qui ajoute son grain de sel à l’admirable prose de l’écrivain, se renseigne un peu avant d’écrire, et surtout que, catholique, comme elle me l’a confessé, elle lise l’Ancien Testament, chose recommandée par le Pape lui-même, indispensable pour la compréhension de la littérature française !
Tel autre nous procure, de la même façon, la recette de la moussaka, en prétendant suivre celle de Mangeclous, mais en y ajoutant une sauce béchamel qui n’est pas dans le texte, qui n’a rien à y voir, toujours en raison des interdits alimentaires transmis de génération en génération par les femmes !
C’est dire qu’il ne suffit ni de bonne volonté, ni de diplômes universitaires, pour comprendre, aujourd’hui, ce que Cohen a voulu signifier, consciemment ou non. Voilà pourquoi je me suis senti obligé de recommander, à nouveau, une analyse culturelle des textes d’Albert Cohen, assistée par ordinateur, dont je donnerai ici une brève illustration.
***
Pour rester dans le délai qui m’est imparti, je me bornerai ici à l’étude de trois éléments : la culture biblique ; la fête ; la langue.
Une culture orientale et biblique
Mangeclous est le Panurge des temps modernes. Pour comprendre son comportement, pour goûter (c’est le cas de le dire) la nourriture qu’évoque Albert Cohen dans ses livres, il faut s’imprégner d’un minimum de la culture « israélite » (pour employer son vocabulaire, du temps de la IIIe République).
Héritier de la caste sacerdotale, comme son nom l’atteste, baigné de culture rabbinique par un père romaniote ; fortement attaché à sa mère, la gardienne de la Loi, il mentionne, comme en passant, ce qui conditionne l’appréhension du monde par ses personnages. Ainsi Saltiel le sage écrit-il à son neveu Solal qu’à Londres les autobus « ont la couleur de la viande saignante, abomination aimée des païens, et si tu te maries comme mon cœur le désire, recommande à ta délicieuse épouse de bien saler la viande et même de la laver avant de la cuire afin d’en ôter le sang qui pourrait y rester » (Val. 275). Cette sainte horreur du sang – la vie – est conforme aux règles du Lévitique (17.10-16), et à leurs conséquences pratiques consignées dans La Table dressée (Choulhan Aroukh), le code éthique élaboré à Safed au xvie siècle par Joseph Caro. C’est la raison pour laquelle Mangeclous, en étalant la nourriture pour le pique-nique, sort des « saucisses de bœuf garanties de stricte observance » (BDS, 559). De bœuf, donc, car ses amis ne sauraient manger du porc, interdit par la religion. Lui-même s’accorde bien « Quelques tranches de jambon, qui est la partie pure et israélite du porc » (BDS, 216), ou encore « Comment, tu manges du porc ? souffla Salomon épouvanté. – Le jambon est la partie juive du porc, dit Mangeclous » (Val.253), plutôt par provocation, geste d’un esprit fort !
À Londres même, Mangeclous et ses cousins ne consomment que des nourritures cacher, admises par la Loi. Il sort de deux couffins ce petit en-cas qu’il s’est procuré chez un juif levantin :
« Quatre paires de boutargues dont par droit léonin je me réserve la moitié ! Pas d’opposition ? Adopté ! Douze gros calmars frits et croustillants mais un peu résistants à la dent, ce qui en augmente le charme ! Huit pour moi car ils sont ma passion suprême ! œufs durs à volonté, cuits durant toute une journée dans de l’eau garnie d’huile et d’oignons frits afin que le goût traverse ! Ainsi m’assura le noble épicier traiteur et coreligionnaire, que Dieu le bénisse, amen ! …Allons, messieurs, à table ! Branle-bas de mangement ! » (BDS, 559)
Tous ces produits, venus du bassin méditerranéen, sont l’arrière-plan sur la table religieusement dressée par Albert Cohen. qui, cela mérite d’être noté, n’emploie aucun nom local pour les dénommer, à l’exception du loucoum, lui-même dans une graphie francisée (avec un C pour K). Portant barbe et calotte, voyez-les manger, ces cousins de Céphalonie, l’île mythique qui n’a évidemment rien à voir avec l’actuelle Corfou !
La Pâque, Le seder
En dépit de leur constante fantaisie, les Valeureux sont bien de leur époque. Ils louent le Dieu unique et sont naturellement religieux. Ainsi lorsque Solal évoque son enfance (tout comme le narrateur), c’est au premier soir de la fête commémorant la sortie d’Égypte qu’il songe, décrivant au style indirect libre chaque étape du repas rituel (lui-même conçu pour marquer chaque épisode du récit historique) y mêlant mot pour mot le texte sacré :
« …ô mon enfance à Céphalonie ô la Pâque le premier soir de la Pâque mon seigneur père remplissait la première coupe puis il disait la bénédiction, dans Ton amour pour nous Tu nous as donné cette Fête des Azymes anniversaire de notre délivrance souvenir de la Sortie d’Égypte sois béni Éternel qui sanctifies Israël,…j’admirais sa voix après c’était l’ablution des mains après c’était le cerfeuil trempé dans le vinaigre après c’était le partage du pain sans levain après c’était la narration mon seigneur père soulevait le plateau il disait voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans le pays d’Égypte quiconque a faim vienne manger avec nous que tout nécessiteux vienne célébrer la Pâque avec nous cette année nous sommes ici l’année prochaine dans le pays d’Israël cette année nous sommes esclaves l’année prochaine peuple libre, ensuite parce que j’étais le plus jeune je posais la question prescrite en quoi ce soir est-il différent des autres soirs pourquoi tous les autres soirs mangeons-nous du pain levé et ce soir du pain non levé j’étais ému de poser la question à mon seigneur père alors il découvrait les pains sans levain il commençait l’explication en me regardant et je rougissais de fierté il disait nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte et l’Éternel notre Dieu nous en a fait sortir par Sa main puissante et Son bras étendu, » (BDS, XCIV, 753)
Je n’ai pas l’intention d’expliquer mot à mot ce morceau d’anthologie, non ponctué, ni de fournir une analyse sémiotique de la cérémonie. Cependant, le lecteur, faute d’avoir assisté à ce repas de fête, doit en connaître le substrat, un certain nombre d’indications relevant de ce que l’on peut, à bon droit, nommer la culture juive, à commencer par l’autre nom que les juifs donnent à cette cérémonie, la fête des Azymes (hag amatsot).
Tout d’abord, il faut savoir que la fête de Pâque commémore plusieurs événements en même temps : traditionnels d’une part, historiques de l’autre. Elle revêt une double signification, fête agreste à l’origine, elle est devenue fête commémorative de la sortie d’Égypte.
Ensuite, la table est mise. La mère a allumé les bougies, elle a disposé au centre un plateau contenant une côte d’agneau grillée, symbole de l’offrande pascale, l’holocauste, l’animal autrefois sacrifié, avant la destruction du Temple ; un œuf dur, symbole du deuil, en souvenir de la destruction du Temple ; les herbes amères (maror) rappelant les dures conditions de l’esclavage ; le harosset (mortier) représentant les travaux de construction auxquels les hébreux étaient soumis en Égypte ; trois matsot commémorant la sortie d’Égypte ; et quatre coupes de vin qui seront bues à différentes étapes de la soirée, les hommes étant accoudés sur le côté gauche, en signe de liberté.
N’ayons garde d’oublier la place vacante, réservée au prophète Élie, supposé devoir annoncer la venue du Messie. En cette attente, elle peut être occupée par un pauvre.
Les rabbins comptent 15 étapes dans le déroulement de la soirée. Solal n’en retient que la moitié. Permettez-moi de vous y renvoyer.
Tout en évoquant ses souvenirs d’enfance, avec tout ce qu’ils comportent d’affectif, Solal relève le caractère pédagogique de cette mise en scène commémorative. En même temps, il y célèbre la mémoire de son père, sa belle voix de cantor. La locution « le seigneur père » détone en français. C’est un calque du judéo-italien parlé par la mère, aussi bien que du judéo-espagnol majoritairement pratiqué par les colonies juives en Grèce.
Ce père majestueux n’est donc pas exactement celui de l’écrivain, mais on ne peut se dispenser d’y voir un hommage à celui qu’il a fort mal traité dans l’ensemble de son œuvre, au profit de la Mère.
Malgré la précision du souvenir, et le déroulement rigoureux de la cérémonie, le Narrateur en a omis un certain nombre de phases, notamment celle, tragique, qui nomme les dix plaies d’Égypte, dont les Hébreux furent épargnés. Les assistants détournent le visage de la table, le père, tout en lisant à haute voix, verse de l’eau d’une aiguière pour symboliser le miracle divin.
Les jours terribles (Yamim Noraim)
Or, les deux livres précédemment invoqués ont paru après ce qu’on nomme la Shoah (anéantissement, en hébreu) ou encore le génocide. Après l’esclavage millénaire, le Narrateur écrit dans la mémoire de la destruction massive : « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz, et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêtés à Nice, gazés à Auschwitz » (Val.225).
C’est le même qui, dans un cauchemar, voit sa mère dans la France occupée, ramassant dans la rue de vieilles hardes pour les mettre dans une valise contenant une étoile jaune (LM, 114). Le même encore, qui se remémore la disparition de sa mère à Marseille, tandis qu’il était à Londres.
Impossible de rien comprendre aux sentiments et aux comportements des uns et des autres si l’on ne voit qu’ils se détachent sur un tel arrière-plan. Mais il y a plus, et sans doute plus intimement inscrit dans leur chair. C’est que, s’ils n’ont pas connu la persécution directe ni la Shoah (le mot est absent de Belle du Seigneur et des Valeureux), ils savent ce que furent les pogroms que subirent toutes les communautés juives de Russie, de Pologne ou de l’Empire ottoman. Par-delà ses risibles manies, c’est bien ce qui pousse Mangeclous et ses coreligionnaires à l’accumulation de nourritures :
« Les Juifs se hâtèrent de faire sceller des barreaux à leurs fenêtres et amassèrent, tout comme en temps de pogrome, force provisions : farine, pommes de terre, pains azymes, macaronis, pains de sucre, œufs, saucisses de bœuf, chaînes de piments, d’oignons et d’aulx, boulettes de tomates séchées au soleil et marinées dans l’huile, graisse d’oie et jarres d’eau, viandes fumées, purgatifs et médicaments. » (Mangeclous, 88)
En somme, l’œuvre carnavalesque ne s’explique que par son contraire, l’évocation de la mort programmée. Non point la mort naturelle de l’homme, mais celle qui a été décidée au nom d’on ne sait quelles aberrations de l’esprit, lors de la Conférence de Wannsee, le 22 janvier 1942.
La veillée de Pâque s’achève par des chants traditionnels, à valeur pédagogique et morale. L’un d’entre eux se nomme Had gadia. On voit quelle morale les enfants peuvent en tirer, et même les adultes, comprenant que nul n’occupe une place qui ne puisse lui être contestée par plus fort que lui, par le Tout-Puissant pour finir. L’ange de la mort est évoqué à plusieurs reprises par les Valeureux.
***
Et voici sur la table toutes les senteurs, toutes les saveurs, toutes les splendeurs de la cuisine judéo-balkanique qui vous pénètrent, répandant le plaisir, la joie de vivre, même dans les jours les plus noirs, car la leçon est toujours la même : « lehaim » à la vie, dit le père, levant symboliquement son verre de vin.
Lire toute l’œuvre d’Albert Cohen à partir des plats qu’il évoque, ce n’est pas seulement se déplacer dans son univers imaginaire, c’est aussi approcher son mode de création et caractériser de la même façon les individus auxquels il insuffle un relief, une vie spirituelle sans équivalent, tant la nourriture est consubstantielle à l’individu. Tel le Dieu unique qu’ils prient quotidiennement, pour eux, l’esprit et la matière ne font qu’un.
Ne nous y trompons pas : la langue d’Albert Cohen, savamment travaillée, est un français recherché, qui refuse la couleur locale. Ce n’est pas un guide touristique ni culinaire. Pas de tarama, pas de dolma, pas de fila ni de beureks, pas d’albondigas, pas de boyos ni de yaprakes, aucun de ces termes qui abondent dans les livres de cuisine ou même dans les mémoires des Séfarades. C’est pourquoi il faut se référer aux craquelins, aux feuilles de vigne (Val.249), aux boulettes et autres feuilletés, etc. De telle sorte qu’on se croirait à la table de La Reynière, tout surpris de découvrir une cuisine à l’huile où l’aubergine et la tomate sont reines. Exceptions notables : le raki offert par Aude à Saltiel (Solal, 233) ; le loucoum, la moussaka et le cascaval, peut-être parce qu’il s’agit là de noms et de produits d’origine turque ? Et enfin le halva, terme authentiquement turc, prononcé du bout des lèvres par Ariane, prémices de la discorde entre les amants (qui auraient mieux fait d’en consommer davantage !).
Outre ce souci, légitime, d’employer un français épuré, d’extension universelle, chez un auteur dont la langue maternelle, le judéo-vénitien nous dit-il, n’était pratiquée que par un millier de personnes à Corfou, à l’époque où il y naquit, il y a peut-être celui de renforcer le mythe des Valeureux de France, émancipés par la Révolution française, « faits citoyens français parfaits par l’effet du charmant décret de l’Assemblée nationale du vingt-sept septembre 1791 » selon Saltiel, fiers de le rester et d’entretenir « le doux parler » de notre pays.
En tout état de cause, l’absence remarquable du vocabulaire étranger, le refus de l’emprunt témoignent du souci d’assimilation, voire d’intégration, de la part d’Albert Cohen. Intégration réussie, non seulement par sa carrière de haut fonctionnaire international, mais encore comme écrivain français.
N’oublions pas qu’il est un immigré, juif de surcroît, ce qu’il ne risque pas d’oublier, comme en témoigne la scène du camelot antisémite, l’injuriant et le désignant à la vindicte publique le jour anniversaire de ses dix ans (Ô vous, frères humains, p. 38), scène indélébile, qui revient à plusieurs reprises et ne sera jamais oubliée puisqu’il en traitera encore passé ses 80 ans (Carnets 1978, p. 19). Scène fondatrice, symbolique, lui révélant l’impossibilité de toute assimilation. Ce n’est pas exactement la leçon qu’il en tire, de même que Swann évincé du clan des Verdurin ne croit pas un instant que son éviction puisse provenir de sa judéité, lui qui, parallèlement, est reçu et même réclamé par le Faubourg Saint-Germain. Tout lecteur de bonne foi, parvenu à la fin d’À la Recherche du temps perdu, c’est-à-dire au Temps retrouvé, ne manquera pas de s’en rendre compte. Reste que la question de l’assimilation ne manque pas d’être toujours actuelle, et que, par la contradiction qu’elle comporte en elle-même, elle confère une grande richesse à l’œuvre qui en est issue.
Henri BÉHAR
Psst ! un auditeur est intervenu pour me dire qu’il se souvenait de sa lecture des Valeureux, il y a 40 ans, et qu’il y avait rencontré le terme almodrote dans la lettre que Mangeclous adresse à la reine d’Angleterre.
Vérification faite, et bien faite, ce terme, désignant une sauce d’origine séfarade, encore employé en Espagne pour désigner diverses compositions, ne se trouve nulle part dans le texte d’Albert Cohen. Outre que cela me rassure sur l’attention que je porte à mon travail, et confirme ma théorie du texte, selon laquelle l’auteur, assimilé, se garde bien de mettre de la couleur locale dans son vocabulaire, il y a là un « témoignage de lecture », pour parler comme les théoriciens, fort révélateur.
Il y a quarante ans, donc, ce lecteur s’éclate en lisant la prose de Mangeclous. Il lit ce paragraphe :
« Avec de la viande hachée, achetée de bon matin, j’ai confectionné des boulettes par l’adjonction de pain azyme finement pilé, d’œufs battus, de persil, de sel et d’une grande quantité de poivre ! D’autre part, j’ai composé une délicieuse sauce en faisant mijoter des piments forts, des oignons et des tomates ! Mais le triple secret est d’employer de l’huile d’olive, de faire mijoter au moins cinq heures à petit feu, et d’ajouter un peu de sucre ! Excellente recette que Vous pourriez essayer ! Sa Majesté le Roi s’en lécherait les doigts ! Naturellement, n’oubliez pas de saler et mettez aussi un peu d’origan ! »
et cela lui rappelle la cuisine maternelle, les keftedes et la sauce d’accompagnement qu’elle nommait almodrote. Cette remémoration, associée à sa lecture, vient donc se superposer au texte de manière indélébile, à tel point qu’il pense ma lecture superficielle, pour ne pas dire erronée ! Je ne lui en suis pas moins reconnaissant d’avoir pris la parole pour confirmer, involontairement peut-être, l’importance que revêt la lecture de certains livres et les mouvements de l’esprit qui l’accompagnent.
Voir à table avec Albert Cohen
http://editionsnonlieu.fr/A-Table-avec-Albert-Cohen?var_recherche=Henri%20BEHAR
Argumentaire : À TABLE AVEC ALBERT COHEN
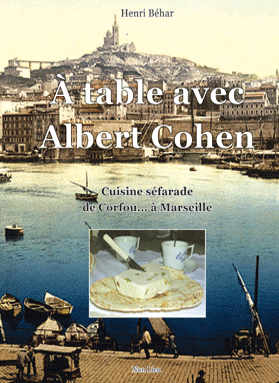
L’ouvrage vise à faire apprécier la littérature d’Albert Cohen à partir des nombreuses références à la nourriture et particulièrement aux plats d’origine judéo-balkanique qu’elle contient. Ce projet fait partie d’un ensemble, plus vaste, d’analyse culturelle des œuvres littéraires. Je pars du principe qu’on ne peut goûter un texte (c’est le cas de le dire) que si l’on en possède les clés, les sources culturelles dans lesquelles l’auteur baigne, inconsciemment parfois. Dans le cas présent, il s’agit de faire entrer la littérature par l’estomac ! On a donc recensé tous les fragments mentionnant cette nourriture, en ne retenant que ceux qui se réfèrent à la culture séfarade (à laquelle il appartenait corps et âme) et, pour en marquer la spécificité, on y joint des recettes. L’ouvrage contient 40 entrées et 20 recettes. Ces recettes sont celles de l’époque évoquée par Albert Cohen dans ses romans, conformes aux règles alimentaires de sa communauté. Il est préférable que l’éditeur fasse appel à un chef cuisinier, capable de préciser la confection de chaque plat et d’en fournir une photo. À défaut, je donne ma propre recette ancestrale, qui coïncide très exactement avec les coutumes alimentaires de Cohen (voir les exemples fournis dans le “manuscrit”). Ainsi, j’indique la manière de cuire les aubergines au feu de bois, comme faisait la mère d’Albert Cohen, ce qui leur donne un fumet qu’on ne retrouve pas dans les recettes actuelles du caviar d’aubergine. Illustration : au minimum photos de 20 plats réalisés. Ajouter des illustrations de magasins d’épices orientales au début du XXe siècle, à Corfou et à Marseille. Plan de l’ouvrage : Introduction, justifie le projet, la méthode et met en garde contre les erreurs répandues par Internet. 1 e partie : Savoir : ce qu’il faut connaître pour comprendre au minimum les usages des personnages et la toile de fond historique à laquelle se réfère l’auteur. 2 e partie : Voir « les marchandises aux fortes odeurs » : bref panorama des nourritures mentionnées, citations à l’appui, sous forme d’entrées de dictionnaire. Cette disposition, essentiellement pratique, peut être réduite et transformée en un texte continu. 3e partie : Cuisiner les « splendeurs orientales » : les plats évoqués dans le texte, parfois avec la recette de Mangeclous, illustrés par une recette pratique. Conclusion : dans mon esprit, ce livre pourrait adopter la maquette d’un ouvrage de cuisine, ne serait-ce que pour amener le lecteur à s’intéresser à cet aspect nutritif de l’œuvre d’Albert Cohen. Henri Béhar


Plaque apposée sur la maison de naissance d’Albert Cohen
Pour information, la maison de naissance d’Albert Cohen à Corfou (2013)
Recension de l’ouvrage par Alain Chevrier dans la revue Europe, mars 2016, n°1043, p. 345-346 :
Voir l’article déjà en ligne sur le site :