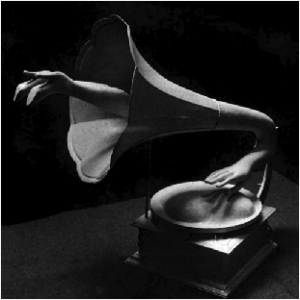THOMAS HUNKELER (dir.), Paradoxes de l’avant-garde. La modernité artistique à l’épreuve de sa nationalisation, Classiques Garnier, 2014, 327 p.
THOMAS HUNKELER, Paris et le nationalisme des avant-gardes : 1909-1924, Paris, Hermann, 2018,
260 p.
Compte rendu par Catherine DUFOUR
[Télécharger cet article en PDF]
Ces deux ouvrages traitent du même thème, le nationalisme des avant-gardes.
Le premier, Paradoxes de l’avant-garde. La modernité artistique à l’épreuve de sa nationalisation, réunit, sous la direction de Thomas Hunkeler, les actes d’un colloque qui s’est tenu à l’Université de Fribourg en mars 2011. Trois chapitres développent les trois grands « paradoxes » des avant-gardes : le conflit entre aspirations cosmopolites et rivalités nationales (I), entre centre et périphérie (II), entre modernité et traditionalisme (III). Ce volume se compose d’études assez éclectiques, qui constituent une mosaïque de cas centrés autour de personnalités emblématiques ou marginales, de revues ou de mouvements. L’introduction de l’ouvrage, « Vers une ‘’contre-histoire’’ comparatiste des avant-gardes » explique que, si les mots « rupture » et « internationalisme » ont longtemps servi à caractériser les avant-gardes, la réalité est plus complexe. En effet, l’histoire des avant-gardes a été forgée par leurs protagonistes mêmes, souvent hagiographes ou mythologues dans l’après seconde guerre mondiale. Mais cette historiographie a elle-même été remise en question par une « contre-histoire » qui, au lieu de chercher à unifier et idéaliser, a établi les disparités, les ambivalences, les contradictions, les zones d’ombre. L’approche comparatiste est revendiquée ici comme outil méthodologique propre à « relativiser » au lieu de « totaliser » : elle ne perd jamais de vue que le cosmopolitisme a souvent cédé le pas au nationalisme, même dans le cas de Dada, champion de l’internationalisme. Le propos est donc de repenser la notion d’ « avant-garde » de façon moins totalitaire. Hélas les rivalités entre historiens ne sont toujours pas closes, et les chercheurs ou critiques s’identifient souvent aux artistes, courants ou pays qu’ils étudient.
Le deuxième volume, Paris et le nationalisme des avant-gardes 1909-1924, est une synthèse réalisée par Thomas Hunkeler, qui prolonge les thématiques abordées dans le premier volume, en six chapitres consacrés à des mouvements et revues essentiels de l’avant-garde européenne : le futurisme et le cubisme à Paris (I), l’expressionnisme allemand (II), l’avant-garde russe (III), le vorticisme anglais (IV), les revues d’art en France (V), Dada à Paris (VI). L’introduction plaide de nouveau pour « une autre histoire des avant-gardes », qui reconnaisse la place prise par les nationalismes au cœur du projet internationaliste. L’auteur y précise ses intentions en se défendant de tout « relativisme » (qui ne verrait dans le nationalisme des avant-gardes qu’un fait normal pour l’époque, se rapprochant ainsi de la droite ou de l’extrême droite) et de tout « révisionnisme » (qui consisterait à lire les avant-gardes en termes de nationalisme exclusivement). Une approche dialectique est revendiquée, qui n’oublie pas, comme dans le précédent volume, que l’histoire des avant-gardes a été écrite dans un premier temps par ses propres acteurs. Cette introduction insiste longuement sur les contradictions d’Apollinaire : « bâtard, métèque et fauché » à l’origine, mis longtemps à l’écart du fait de ses origines (décrites parfois comme juives !), puis traumatisé par une guerre qui le rendit patriote, Apollinaire se mit à chérir l’idée d’une tribune internationale où à défendre la supériorité nationale parisienne, menacée à sa périphérie par des nationalismes en éveil. Cet exemple nous ramène à une évidence : si les avant-gardes, Dada au premier chef, ont revendiqué l’internationalisme, c’est parce que le nationalisme faisait rage et que les désirs hégémoniques parasitaient l’idée cosmopolite. Ainsi s’explique que la proximité culturelle d’Apollinaire avec l’Italie ait pris des allures paternalistes, chauvines et dominatrices, et que Marinetti ait tenté d’inscrire le futurisme sur le territoire parisien. La position centrale de Paris dans l’histoire des avant-gardes se trouva inévitablement remise en question. Il faut rendre hommage à La République des Lettres de Pascale Casanova d’avoir étudié en détail ces mécanismes. Si le futurisme est souvent cité comme l’exemple de la collusion entre nationalisme et cosmopolitisme, il ne faut pas oublier que toutes les avant-gardes ont participé de cette ambiguïté. C’est pourquoi elles sont souvent appréhendées d’abord en fonction de leur origine nationale : allemande pour l’expressionnisme, italienne pour le futurisme, etc.
Paradoxes de l’avant-garde. La modernité artistique à l’épreuve de sa nationalisation.
I. L’Avant-garde entre aspirations nationales et rivalités internationales
Cette première partie se présente comme un catalogue qui envisage successivement des collectifs (le dadaïsme zurichois, Der Sturm, L’Internationale lettriste), une revue (Europe), des personnalités majeures (Tzara, T. S. Eliot, Cendrars) pour mettre en évidence dans chacun des cas la tension entre cosmopolitisme et nationalisme.
Wolfgang Asholt (Dada de Zurich à Paris. Une nationalisation de l’internationalisme ?) détaille la stratégie par laquelle Tzara à Zurich aurait œuvré dans le sens d’une francisation de Dada, afin de pouvoir, originaire lui-même d’une petite nation, intégrer les cercles littéraires parisiens qui se méfiaient de la part trop allemande de Dada, comme Apollinaire ou les revues Sic et Nord-Sud. Accordant une place de plus en plus grande aux artistes et écrivains français, qui culmina dans sa collaboration avec Picabia ou Arp, il aurait contribué sciemment à une déradicalisation d’un mouvement très cosmopolite à ses débuts, ce que Huelsenbeck ne se priva pas de lui reprocher. Mais Tzara ne se doutait pas qu’il serait à son tour, en conformité avec les analyses de Bourdieu, mis à l’écart de la vie littéraire française…
L’article de William Marx (Le modernisme entre internationalisme et nationalisme. T. S. Eliot : Paris aller-retour) se consacre aux ambivalences de T. S. Eliot, fasciné par Paris, la culture française et le destin de ces immigrants nés outre-Atlantique, tels Stuart Merrill ou Francis Vielé-Griffin, qui devinrent de vrais poètes symbolistes français. Mais paradoxalement, les influences qu’Eliot subit à Paris en 1910-1911, de La NRF, de Paul Claudel, Saint-John Perse, Bergson, et surtout Maurras, le conduisirent, dans un désir d’enracinement indispensable au travail d’écriture, à s’installer quelques années plus tard, et jusqu’à sa mort, dans un village du Somerset, berceau de sa famille, soutenant la monarchie et l’église anglicane par fidélité aux principes de l’Action française…
Hubert van den Berg (Der Sturm. Une revue et une galerie berlinoise d’avant-garde entre internationalisme et nationalisme ») se consacre à la galerie Der Sturm et à la revue du même nom, animés par Herwarth Walden à Berlin, dont l’internationalisme légendaire dans les années 1910-1920 contribua pour beaucoup, à l’heure de l’écriture des avant-gardes dans les années 60-70, à rendre indissociables les mots « internationalisme et « avant-garde ». Mais on sait depuis que Der Sturm a participé pendant la guerre à des activités de renseignement pour les services secrets allemands, utilisant l’expressionnisme comme étendard culturel d’un nationalisme qui ne disait pas son nom. Les artistes du Sturm ont donc joué diverses partitions, de l’internationalisme convaincu de Kurt Schwitters à des positions franchement nationalistes, comme celles de Lothar Schreyer, artiste « dégénéré »… qui fit allégeance à Hitler.
Bruno Curatolo (Promotion et réception des avant-gardes dans la revue Europe : 1923-1939) tente de comprendre les ambiguïtés de la revue Europe, fondée en 1923 sous l’égide de Romain Rolland et officiellement favorable aux avant-gardes, en traquant le flou sémantique et les jugements contradictoires qui entourent le mot « avant-garde » dans différents articles sur la musique, la littérature, les arts plastiques, le théâtre. Chemin faisant, l’auteur constate qu’en progressant vers les sinistres années 30 la revue délaissa peu à peu les significations associées aux expérimentations d’après-guerre, pour adopter le sens humaniste et démocratique que prendrait le terme quelques années plus tard, à l’heure du TNP de Jean Vilar ou des Maisons de la Culture d’André Malraux.
Question de terminologie encore : Cendrars était-il d’avant-garde ? C’est la question posée par Claude Leroy (Modernité chez Cendrars. L’amour des commencements) à propos de cet écrivain qui assouvit ses pulsions destructrices et sa haine des Boches à « l’avant-garde » des champs de bataille, mais qui détestait, comme Baudelaire, la métaphore militaire appliquée à la littérature, sauf quand elle était utilisée au premier degré par Marinetti. Indéniable pionnier de la pensée européenne, Cendrars eut des affinités avec les dadas et les surréalistes, mais il détestait les « ismes », les groupes, les chefs (notamment Breton), et les rivalités de clans. Il préférait la modernité délirante et singulière de Moravagine et chérissait le Présent plus que les « lendemains qui chantent ». Se méfiant des dadaïstes embusqués qui guerroyaient avec des mots, il devint après 14-18 un vrai moderne, un créateur-défricheur (descobridor) débarrassé des accessoires modernistes. Il laissa alors libre cours au tropisme du « partir » et des commencements, en hommage à « la partition originaire du corps de la mère », son premier départ manqué, et à un corps amputé d’une main « partie au combat ».
Laurent Jenny (Entre fonctionnalisme et surréalisme. L’Internationale lettriste) montre comment L’Internationale lettriste, après avoir posé les bases du Situationnisme, échoua à cause d’une incompatibilité foncière entre les deux avant-gardes dont elle était issue : l’architecture fonctionnaliste d’Asger Jorn, volontariste et constructive, et le surréalisme de Debord, voué à la passivité de l’inconscient. Jorn contestait l’urbanisme de Le Corbusier, aussi répressif que celui d’Haussmann : les « cités radieuses », destinées à améliorer les conditions d’existence, négligeaient les aspirations esthétiques et imaginaires de la Nouvelle Babylone rêvée par Constant dans les années 60. Debord de son côté voulut dépasser la déambulation hypnotique de Breton en la menant vers un « urbanisme unitaire » activiste. Mais chez Debord, comme chez Constant, la construction tua la situation, et, au carrefour du fonctionnalisme et du surréalisme, la Révolution n’eut pas lieu… La Nouvelle Babylone se mua en musée d’art contemporain géré par des commissaires, plagiaires dévoyés des équipes techniques situationnistes.
II. Entre Centre et Périphérie
La Flandre, le Danemark, la Serbie et la Roumanie, nations périphériques autour desquels s’organise la deuxième partie du recueil, ont multiplié les paradoxes et les tropismes nationalistes.
L’avant-garde flamingante évoquée par Geert Buelens (« En Flandre, les révolutionnaires qui ne sont pas des nationalistes flamands sont bien rares ». Quelques remarques sur le nationalisme, l’internationalisme et l’activisme dans l’avant-garde flamande après la Grande Guerre) fut tiraillée, pendant et après la guerre, entre une tendance conservatrice néo-symboliste, et une tendance progressiste influencée par l’expressionnisme allemand humaniste, le vers libre de Whitman, Dada, l’art abstrait et le Bauhaus, la Révolution avortée de Berlin en 1918. Or cette deuxième tendance, contre toute attente, se rallia à un nationalisme flamand… qui sympathisait avec l’internationale communiste ! Paul van Ostaijen et la revue Het Overzicht (1921) de Fernand Berckelaers (alias Michel Seuphor) y jouèrent un rôle de premier plan. Ce nationalisme paradoxal, très minoritaire, combattit activement le nationalisme belge traditionnel renforcé par la guerre. Mais la belle impulsion révolutionnaire prit fin … et le nationalisme flamand se radicalisa jusqu’à rejoindre plus tard le nazisme…
Sylvain Briens (La Renaissance gotique et Le grand voyage de Johannes V. Jensen. Fantasmagorie cosmopolite et historiographie nationale aux origines de l’avant-garde danoise) a choisi deux ouvrages de l’écrivain danois Johannes V. Jensen, La Renaissance gotique (1901) et Le grand voyage (1908-1922), pour mettre en évidence les thèmes entrecroisés de l’identité nationale et du cosmopolitisme, et leur influence décisive sur les avant-gardes du Danemark et de Suède. La Roue, un des figures récurrentes de Jensen, inspirée d’un fonds mythologique scandinave, est à la fois représentation cosmique atemporelle et hymne au progrès technique. Le grand voyage, gigantesque épopée qui remonte à la Préhistoire, établit d’étonnantes passerelles entre les Vikings, la découverte de l’Amérique et la modernité industrielle, célèbre le génie des Gots, source d’un nationalisme danois ouvert à l’universel. Jensen a inventé un nouveau genre, le « mythe », court texte fictionnel en prose consacré à un aspect du monde contemporain, qui fait penser aux mythologies d’Aragon (Le Paysan de Paris), de Barthes ou de W. Benjamin. Sa « fantasmagorie de l’histoire » est proche de « l’illumination profane » de W. Benjamin. Jansen influencera le suédois Harry Martinson dans les années 30, puis le Situationnisme danois et CoBra, ses héritiers directs.
Jens Herlth analyse les contradictions de Miloš Crnjanski (« Tout cela donc sans aucune prétention ». Miloš Crnjanski, la nation et l’avant-garde serbe), chantre de l’avant-garde serbe dans les années 1919-21, mais accusé dans les années 30 d’un nationalisme illustré dès 1929 par son roman Migrations. Jens Herlth refuse d’utiliser le mot « avant-garde » selon les critères normatifs des années 1960-70. Ce serait en effet oublier que, pour la jeune Yougoslavie multiculturelle de 1918, le mot « nationalisme » avait un sens bien particulier. Miloš Crnjanski souhaitait que la jeune nation intègre le modernisme européen, mais il voulait aussi qu’elle se distingue de la tabula rasa des Occidentaux ou des futuristes russes. Son unique manifeste, « L’Explication de Sumatra », plaide pour une poésie sans posture guerrière, inspirée du « neutre » de Roland Barthes et quasi bouddhiste. Un « sous-texte » engagé y affleure toutefois, une vision poétique de la « nation », fruit d’une tension entre le jugoslovenstvo, le modernisme yougoslave multiculturel affranchi du provincialisme, et le srpstvo, inspiré du passé national serbe. De même les écrivains de Zagreb ne pouvaient-ils ignorer leurs racines croates, ni Ivo Andrić ses origines bosniaques… L’idée romantique de nation se mua hélas chez Crnjanski en un nationalisme qui dériva vers le pire…
Quatre articles sont consacrés aux prolifiques avant-gardes roumaines. Ion Pop (Offensives et défensives de l’avant-garde roumaine) en retrace les étapes depuis la fin du XIXe siècle, partagé entre courants littéraires nationalistes d’inspiration rurale et tendances symbolistes cosmopolites. Le début du XXe siècle donne lieu à une offensive poétique anti-traditionaliste (Ion Vinea, Adrian Manu), qui culmine en 1913-1916, sans jamais atteindre la radicalité de Tristan Tzara. La Roumanie n’était pas prête pour l’onde de choc dadaïste, pas plus qu’elle ne l’avait été pour le manifeste de Marinetti publié à Bucarest dès 1909. Il fallut attendre les années 1924-30 pour qu’émerge une avant-garde digne de ce nom, incarnée par Ion Vinea, Ilarie Voronca, Max Hermann Maxy, Geo Bogza. Ses détracteurs, xénophobes ou antisémites, la taxaient de phénomène de mode « importé », oubliant que la littérature roumaine puisait depuis toujours à des sources étrangères et que Dada, mouvement « exporté », s’était inspiré de certaines spécificités déconstructives de la littérature traditionnelle. L’avant-garde roumaine évolua du constructivisme futuriste des années 20 vers le surréalisme des années 40 (Gellu Naum, Ghérasim Luca), en une « mosaïque de tendances » ponctuées par des accès de fièvre et recouvertes par l’occupation soviétique. Saşa Pană ou Geo Bogza se rallièrent alors au communisme prolétarien, tandis que Gherasim Luca, D. Trost ou Paul Păun prenaient le chemin de l’exil…
Ionannah Both (Comment peut-on être roumain ? Brève histoire de la réception critique des avant-gardes roumaines, en Roumanie) s’est intéressée à la réception des avant-gardes roumaines dans les histoires littéraires, rythmée par les revirements idéologiques. En 1924, pour qualifier les artistes d’avant-garde, « communiste » est une insulte qui rime avec « juif », malade mental ou dégénéré. En 1941, en temps de domination hitlérienne, Tzara et ses amis, jugés complices de l’Occident, sont évalués à l’aune d’une judaïté méprisée. Mais en 1944, quand l’Armée Rouge entre en Pologne, les « fils prodigues » de retour d’Occident sont encensés comme conquérants roumains de la culture européenne, dont on « redécouvre » les origines judaïques… Le socialisme d’inspiration soviétique fait bon ménage avec le surréalisme triomphant des années 40, mais les surréalistes dissidents doivent quitter le pays… Saşa Pană en 1969 publie la première anthologie qui « canonise » les avant-gardes, envisagées sous le seul angle « esthétique », et omet leurs compromissions avec le pouvoir stalinien. En 1983, sous Ceaușescu, le « protochronisme » est roi : les avant-gardes n’auraient rien inventé qui ne se trouve déjà dans la littérature roumaine ! Ion Pop, autorité critique essentielle, fait lui aussi, de 1970 à 2006, le jeu de la dépolitisation au profit du structurel, de l’éternel ou de l’intertextuel. Paul Cernat, membre éminent de la nouvelle critique roumaine, publie en 2007 un ouvrage d’un nationalisme encore vivace…
Adriana Copaciu (Les revues roumaines d’avant-garde à la recherche d’un nouvel espace de parole) dresse un panorama des revues d’avant-gardes roumaines, depuis le manifeste fondateur de Vinea, en 1924, jusqu’au surréalisme. L’auteure y approfondit les trois logiques déployées entre 1923 et 1928 : la synthèse, la synchronisation, l’internationalisation. La synthèse a été réalisée grâce à l’« Intégralisme » de Voronca, cette variante roumaine du constructivisme, distincte à la fois du radicalisme importé et du traditionalisme. La synchronisation ce fut l’adaptation au présent, qui permit aux revues de combler le « retard » pris par une culture périphérique méprisée. L’internationalisation enfin correspondit à une sorte de « colonialisme culturel inversé » – conforme aux théories de Bourdieu ou à celles de Pascale Casanova dans La République des Lettres – par lequel les revues triomphèrent des résistances nationales tout en consolidant leur lien à la nation grâce à des réseaux extérieurs ; ainsi fut légitimée, sans soumission ni plagiat, une culture roumaine jusque-là tenue à distance par les grands centres européens.
Adrian Tudurachi (« Le stéréotype ethnique dans la littérature roumaine d’avant-garde et les dérives de l’internationalisme ») a étudié le « stéréotype ethnique » mis au service de l’internationalisme par le futurisme, et par le dadaïsme zurichois qui porta sur scène les spécificités linguistiques de ses artistes au profit du polyglottisme. Dans l’avant-garde roumaine on relève une tension entre la résistance au parisianisme de la génération symboliste, et l’impossibilité, propre à toute culture mineure, de récuser les emprunts extérieurs. Cette avant-garde oscilla, dans les années 20, entre le modèle spirituel d’une sensibilité esthétique universelle prônée par Vinea et la quête matérialiste d’une égalité d’accès aux moyens culturels. Après avoir tergiversé, Voronca opta pour le modèle spirituel, apte à valoriser les différents stéréotypes ethniques. Mais, sous prétexte de cosmopolitisme, l’empathie pour « le cowboy agile du Colorado » ou « l’hindou vendeur de bananes à Calcutta » (Integral, 1925) perpétuait un monde ethniquement réifié. Et si philosophe Agamben inscrit ces stéréotypes dans le cadre d’une ironie ethnique antinationaliste, ceux-ci ne peuvent masquer un fond nationaliste… Bref, le stéréotype ethnique, qui a occupé dans l’avant-garde roumaine des fonctions diverses, ne saurait se réduire au désir de préserver le nationalisme au cœur de l’internationalisme.
III. Quelles traditions pour la modernité ?
La troisième partie se penche sur l’inscription plus ou moins explicite du traditionalisme dans des collectifs ou chez des personnalités d’avant-garde.
Roxana VICOVANU (Le difficile équilibre du « retour à l’ordre », du « classicisme moderne » et de l’avant-garde. Le cas de L’Esprit nouveau) dresse un catalogue des nombreuses concessions au « retour à l’ordre » dans L’Esprit Nouveau (1920) de Paul Dermée, Amédée Ozenfant et Le Corbusier. Cette revue, officiellement ouverte aux avant-gardes, omet El Lissitzky, la typographie constructiviste, Lajos Kassák, etc. Prétendument cosmopolite et pacifiste, elle aspire à l’hégémonie européenne de Le Corbusier. Élitiste, elle défend la perfection, l’éternel, et un art consacré à l’utile. Elle s’oppose, malgré Dermée, aux conceptions artistiques subversives et aux idées politiques révolutionnaires. Ses préférences sont nationales et traditionalistes : le cubisme est apprécié parce que compatible avec Ingres ! Le retour au métier et aux « académismes » y domine. Paris y est très prisé car il concilie le rayonnement cosmopolite et le génie français. L’Esprit Nouveau hésite finalement entre deux tendances distinctes : le « classicisme moderne » du « retour à l’ordre » et le « modernisme esthétique », qui s’intéresse au passé (le Parthénon) sans exclure les recherches formelles des avant-gardes internationales.
Ce n’est un secret pour personne, comme le rappelle Isabel Violante (Les gares cosmopolites d’Ardengo Soffici) que les avant-gardes italiennes, cosmopolites avant 1914, sont devenues nationalistes après 1918. Le futuriste Ardengo Soffici ne fait pas exception à la règle. Ses écrits sur les gares italiennes, sensibles au charme cosmopolite de ces lieux, sont imprégnés de mélancolie, de nostalgie rurale et d’hymne à la lenteur, aux antipodes des conceptions futuristes de l’architecte Antonio Sant’Elia. Quand Mussolini dans les années 30 projette une reconstruction mégalomaniaque des gares, dont celle de Florence, Soffici s’insurge : en effet, malgré l’utilisation des pierres et marbres régionaux et le respect de certaines traditions locales, cette gare est un hymne aux formes, matières et tendances de l’architecture européenne d’avant-garde. Nikolaus Pevsner, peu suspect d’indulgence pour les régimes totalitaires, en chante d’ailleurs les louanges. Et alors que les artistes italiens, fascistes ou pas, sont divisés par ce projet selon leur degré d’adhésion aux innovations européennes, Soffici se déchaîne contre une modernité dominée par les étrangers, métèques, Juifs, francs-maçons, bolchéviques et autres dégénérés ; ou par le monde « nordique et protestant » ligué « contre Rome et sa latinité ». L’orientation fasciste de cet ancien futuriste, devenu allié des nazis, ira crescendo…
Denis Pernot (Barrès et les princes de la nouvelle jeunesse. Les vertus avant-gardistes d’un cadavre) montre comment Barrès considéré, avant la guerre de 14, comme un écrivain dépassé et concurrencé par Maurras, œuvra habilement pour redevenir « prince de le jeunesse » et guide de la nouvelle avant-garde. S’éclipsant derrière les paroles des combattants et endossant, après la guerre, le rôle de chantre des « écrivains morts pour la patrie », il alla jusqu’à contester la légitimité de la littérature, se sentant ainsi autorisé à fédérer l’avant-garde, fût-elle son ennemie. Très ambivalents, les dadas lui firent un procès en 1921, tout en aspirant à sa reconnaissance comme référence majeure d’une vie littéraire française… qu’ils récusaient. Barrès remit aux écrivains d’avant-garde son œuvre en héritage, pour qu’ils l’inscrivent dans un patrimoine qu’il avait lui-même négligé, de Rimbaud à Apollinaire. La distance prise, en apparence, vis-à-vis de sa « magistrature intellectuelle » facilita la « rupture intégrante » des jeunes rebelles, à l’origine d’une « filiation d’un projet inabouti du maître », très perceptible notamment chez Joseph Delteil.
Pierre Drieu la Rochelle, c’est aussi une histoire paradoxale, étudiée par Fabien Dubosson (Pierre Drieu la Rochelle et le surréalisme. Un « avant-gardiste de droite » dans une « arrière-garde de gauche » ?). Malgré sa formation de droite, Drieu s’engage aux côtés des surréalistes dès 1924, avant de se compromettre avec le fascisme dix ans après. Son expérience du front le liait au groupe de Breton. Mais pour lui la guerre était chargée d’un signe mystique de refondation des valeurs, y compris esthétiques. Sa Terre symbolique, qui n’était pas le sol sacré de Barrès, glorifiait le sacrifice de soi et les amitiés viriles. Drieu attendait de Dada et des Surréalistes qu’ils en soient les passeurs. Mais ces alliés d’un moment étaient antinationalistes ! Bien avant Gilles (1939), Drieu leur reprocha leur abandon de Dieu, puis, après les événements du Rif, leur adhésion au communisme, à Hegel, à l’amour de l’Orient contre l’Occident. Il voyait les surréalistes comme des hommes du XIXe siècle, préférant l’engagement réel à la révolution de l’esprit… dont il aurait dû être le guide. L’indécision de ses écrits, entre lyrisme mystique et déconstruction, reflète l’ambivalence d’un homme tenté aussi par l’Action française, contestée pour d’autres raisons … Ses polémiques avec les surréalistes ont peut-être révélé les aspects totalitaires du mouvement, ceux-là même qui le fascinaient. Irrémédiablement solitaire, il renvoya dos à dos deux groupes autoritaires entre lesquels il ne put se décider… avant d’opter pour des choix plus radicaux…
Avec Alain Clavien (Les « helvétistes », entre avant-garde et réaction) nous sommes à Genève au début du XXe siècle, quand de petits groupes d’avant-garde cherchent à s’émanciper de la tutelle parisienne. Une mouvance nationaliste, dite « helvétiste », voit le jour, notamment dans La Voile latine de 1906 à 1910, et s’engouffre dans les débats suscités par les bouleversements structurels de la Suisse des années 1908-1910 : industrialisation, urbanisation, mouvements sociaux, exode rural, présence étrangère croissante. Les helvétistes s’orientent vers des positions antidémocratiques, xénophobes et antisémites, au nom de l’esprit guerrier ancestral, du patrimoine et des traditions contre les étrangers, de l’Ancien Régime contre le XIXe siècle décadent. Drôle de mouvement, qui, d’un côté, se dit d’avant-garde, sur le modèle du poète-prophète et de l’artiste éclairé, et de l’autre adopte les idées réactionnaires d’un ordre moral, religieux, rural, frugal, voué au travail. Les helvétistes n’hésitent pas à prendre en otage la figure parisienne de Ramuz et à utiliser Maurras et Barrès comme alibis « avant-gardistes ». Tant de contradictions laissent pantois ! Fédérés en ligue patriote à partir de 1912, ces nationalistes accueillent la guerre avec satisfaction…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La synthèse qui suit, prise en charge intégralement par Thomas Hunkeler, propose une vue d’ensemble du nationalisme des avant-gardes européennes, envisagé sous l’angle de leur désir de conquête symbolique des grands centres culturels dominants, Paris en tête.
Paris et le nationalisme des avant-gardes : 1909-1924
I. « Nous avons pris la tête du mouvement de la peinture européenne ». Le futurisme et le cubisme à Paris
Le futurisme et le cubisme sont en rivalité à Paris. Les futuristes y mènent à partir de 1909 une véritable guerre de conquête, qui culmine au moment de l’exposition de février 1912 à la Galerie Bernheim-Jeune. Mais dès 1911 ils mettent leur italianité à distance pour être reconnus maîtres de la peinture européenne et Boccioni essaie de démarquer le futurisme d’un cubisme soupçonné de progermanisme. Officiellement ami des futuristes, Apollinaire oppose à leur volonté d’ascension une démonstration de supériorité nationale, et prend parti sans partage pour le cubisme, aux côtés de Salmon et Gleizes, qui veulent le sacrer « « art parisien » au détriment de son jumeau futuriste. Le cubisme est interprété alors comme héritier de Courbet, Manet, Cézanne ou Matisse, et le futurisme comme descendant de la Renaissance italienne, cet « attentat » au génie national. Gleizes se réclame du « celtisme » des néo-symbolistes et du retour à l’art médiéval ; de nombreux peintres cubistes illustrent cette francisation par le traditionalisme de leurs sujets. La revue Montjoie ! fondée en 1913 par le franco-italien Ricciotto Canudo devient un « organe de l’Impérialisme artistique français », celtique et parisien, antisémite à l’occasion, sorte de passerelle entre le Moyen-Âge et les innovations de l’avant-garde. En Italie, Papini et Soffici militent quant à eux, avant et après la guerre, pour une bonne entente entre une France gallo-romaine, celtique, et une Italie de sang grec, sémite et étrusque. Mais le Traité de Versailles redonnera vigueur à l’ italianisme anti-français !
II. « L’Ennemi n’est pas là où l’on a lancé les flèches ». L’expressionnisme allemand
Ce chapitre approfondit les analyses de Hubert van den Berg exposées dans le précédent volume. Les nationalistes s’en prennent à la « conspiration étrangère » des peintres futuristes exposés à la galerie du Sturm en 1912, mais aussi, à l’heure du « coup d’Agadir », des peintres français qui envahissent le marché. Une réponse aux polémiques lancées par le peintre nationaliste Carl Vinnen réunit toutefois, à l’initiative de Kandinsky et Franz Marc, de très nombreuses signatures favorables à l’internationalisme esthétique. Mais Franz Marc, dès 1912, sous l’influence du théoricien Wilhelm Worringer, propose une lecture « gothique » du Blaue Reiter, le rattachant à une peinture intemporelle, abstraite, spirituelle, tournée vers l’art des peuples, des enfants et des primitifs, la Russie et l’Orient. Représenté surtout en Europe du Nord, ce courant, antérieur à la Renaissance originaire du Sud, lui serait supérieur. Avec la Brücke, une étape est franchie : le « gothique » devient exclusivement germanique. Franz Marc, engagé volontaire mort au front, pense que la guerre est un « purgatoire » nécessaire à la refondation de l’esthétique allemande, en crise certes, mais destinée à triompher en Europe… Au même moment, les activités cosmopolites du Sturm masquent le double jeu nationaliste de Walden, qui prospère sur le marché de l’art et à l’écart du front… Ses convictions esthétiques, sincèrement internationalistes, comme celles de Franz Marc, ont assuré le succès de grandes œuvres… expressionnistes allemandes notamment…
III. « Salut à toi, magnifique Orient ». L’avant-garde russe, de la xénomanie au russocentrisme
L’avant-garde russe du début du XXe siècle connaît les mêmes vicissitudes qu’un empire divisé entre un désir d’émancipation à l’occidentale et un nationalisme croissant. La Toison d’or, publiée en russe et en français (1906-1909), subit l’influence du symbolisme français et des peintres postimpressionnistes exposés à Moscou. Mais Larionov et Gontcharova s’intéressent de plus en plus aux loubki (estampes populaires à connotation religieuse), à l’art médiéval russe, à l’icône et l’artisanat national. Le groupe « Hyleïa » (1912), animé par le peintre David Bourliouk et le poète Bénédikt Livchits s’éloigne de l’imitation française au profit du primitivisme et de l’Orient. L’écart se creuse entre ceux qui, comme Bourliouk, restent fidèles à l’avant-garde occidentale malgré le particularisme « cubo-futuriste », et ceux qui s’en désolidarisent. Une gifle au goût public (1913), qui marque l’apogée du futurisme russe (Bourliouk, Khlebnikov, Kroutchonykh, Maïakovski), s’inspire des manifestes italiens. Mais Khlebnikov puise dans les archaïsmes de la langue russe et s’inspire de la poétique de la steppe plus que de celle de la ville ; la Russie est élargie au continent asiatique. Gontcharova et Larionov se rapprochent du géorgien Ilia Zdanévitch, thuriféraire d’un nationalisme rural anti-citadin. Rien d’étonnant à ce que « l’impérialisme italien » de Marinetti se heurte, à Moscou et Saint-Pétersbourg en 1914, au nationalisme esthétique d’un nouvel Orient, intérieur et spirituel plus que territorial…
IV. « Oh oui, à bas la France ». Le vorticisme anglais, une avant-garde en trompe-l’œil ?
Le futurisme proclamé en Angleterre par Marinetti et le peintre Christopher R. W. Nevinson en 1914, cède rapidement la place au « vorticisme » de Thomas Ernest Hulme, Ezra Pound et Wyndham Lewis. Hulme, influencé par Worringer, défend l’art « géométrique » des temps préclassiques et « gothiques », l’art des Byzantins, des primitifs, des expressionnistes et des cubistes. Le postimpressionnisme de Fry, le « modernisme esthétisant » du Bloomsberry et le flux universel des futuristes sont récusés au profit du cubisme d’Epstein, Cézanne ou Picasso. Compatible avec l’abstraction de Balla ou Severini, la nouvelle avant-garde revendique le Présent et l’art populaire spontané. Le premier numéro de Blast, de connotation nationaliste en juillet 1914, est un bric-à-brac de références contradictoires, calqué sur la typographie et les provocations futuristes – malgré l’anti-futurisme de Lewis – d’où ressort une apologie du génie moderne : résolument nordique, anglo-saxon, anti-français et anti-parisien. Avec la guerre, tout change. Le vorticisme, allié de l’esthétique allemande, est contesté. Le deuxième numéro de Blast, en 1915, s’inscrit du côté de l’Entente, tout en faisant la distinction entre une Allemagne nationaliste, anti-cubiste, anti-expressionniste et une Allemagne souterraine, esthétiquement alliée. Lewis énonce un credo artistique au-dessus des nationalismes, qui devrait être cubiste après la guerre… C’est ainsi que le vorticisme réussit à se dégager des influences dominantes, italiennes et françaises, pour affirmer une identité compatible avec une orientation universaliste.
V. « Les premiers sont les premiers ». Les revues d’art en France à l’épreuve du patriotisme
SIC, Le Mot et L’Élan sont trois revues antérieures à L’Esprit Nouveau analysé dans le précédent volume. SIC (1916-1919) est née des opportunités offertes par la guerre à son directeur, Pierre Albert-Birot. Après un premier numéro alliant patriotisme et éclectisme esthétique, l’orientation futuriste de la revue se précise, à la faveur d’une exposition de Severini à Paris en 1916. Inventeur du « nunisme », sorte de fourre-tout moderniste, Albert-Birot aspire à une synthèse, « typiquement française », qui intègrerait la tradition. Son patriotisme, influencé par Apollinaire sans être réactionnaire, se distancie peu à peu du futurisme. Quand paraît Littérature en 1919, Albert-Birot, ridiculisé par Aragon, met un bémol à ses prétentions de chef de file avant-gardiste. Sa revue avait pourtant pris parti pour Dada et Tzara… Comparée à SIC, Le Mot (1914-1915) est foncièrement patriotique. La caricature des « boches » y est omniprésente et le cubisme y est critiqué pour ses sympathies allemandes. Cocteau met un frein à cet anti-germanisme systématique et, sans renier son patriotisme, s’efforce d’ouvrir la revue à un art contemporain réputé anti-français. Mais ses hésitations nuisent à son désir de synthèse, bientôt remis en chantier par L’Élan d’Amédée Ozenfant. Plus élitiste et moins conformiste, cette revue, loin d’être pacifiste, s’intéresse à l’international malgré l’admiration de son directeur pour Barrès. Le dernier numéro de 1916 annonce le « purisme » et soutient Edouard Jeanneret (Le Corbusier) qui, oubliant son chauvinisme, se mobilise avec Auguste Perret en faveur des architectes pro-allemands… en prévision d’une reconnaissance de l’architecture française dans l’après-guerre ! Pour Ozenfant, Jeanneret ou Perret, l’ennemi ce n’était pas l’Allemagne, mais le parisianisme petit-bourgeois, nationaliste et réactionnaire… Internationalisme et fierté nationale pouvaient coexister, ce que L’Esprit nouveau confirme à partir de 1920.
VI. « Ces toqués n’ont pas un bon accent ». Dada à Paris
Ce chapitre prolonge l’article de W. Asholt du précédent volume. C’est un réquisitoire quelque peu attristant contre le nationalisme parisien qui va crescendo de 1920 à 1922. L’arrivée à Paris de Tzara en janvier 1920 déconcerte et éclipse rapidement le mythe du jeune poète-messie. Ce métèque d’Europe de l’Est, ce juif à la pâleur de Dracula, et ainsi de suite, suscite des articles d’un racisme de la pire espèce. Accusé d’avoir été à Zurich ami des expressionnistes allemands (en réalité réfractaires), Tzara connaissait bien les réticences de la France à son égard. Confronté à la hantise d’un Dada boche diffusée par Apollinaire, il avait lutté pour se concilier des personnalités majeures de la vie intellectuelle française. Son intégration parisienne ne fut pas gagnée pour autant. A la suite de Rachilde ou de Cocteau dont la revue Le Coq (1920) devait s’intituler initialement Cocorico, Gide se méfia ouvertement du jeune écrivain, prometteur… mais juif. Jacques Rivière, directeur de la NRF, qui publia une « Reconnaissance à Dada » (1920) remarquée, tint par ailleurs des propos fort nationalistes. Et que dire de l’attitude de Breton ? Après l’euphorie des chahuts dadaïstes et de la riche contribution de Dada à Littérature, il prit ses distances vis-à-vis de Tzara lors du Procès Barrès (1921), cet hommage masqué au grand ancêtre, et du « Congrès international pour la détermination des directives et la défense de l’esprit moderne » (1922). Dans Comœdia et Littérature en 1922, il dénonça les affinités allemandes de Tzara et rendit hommage aux véritables inventeurs, français, de Dada : Picabia, Duchamp et Vaché. Le Projet d’histoire littéraire contemporaine d’Aragon, élogieux pour le dadaïsme dans sa première version, opta pour une interprétation française de la littérature contemporaine depuis 1913, le rôle de Tzara y étant juste effleuré…
Qui pourrait encore, après la lecture de ces deux ouvrages, ne considérer les avant-gardes que comme des véhicules de l’internationalisme ? Ils ont le mérite de détisser les mythes forgés dans les années 60-70, tels que Peter Bürger a pu les relayer dans sa célèbre Théorie de l’avant-garde (1974). Leur point de vue est riche, très documenté, nuancé. On peut certes reprocher au premier son éclectisme parfois discontinu et, à tous deux, une sorte de naïveté : qui pourrait croire en effet que les désirs de subversion cosmopolite des avant-gardes aient pu échapper, en toute pureté, au nationalisme constitutif de l’histoire de l’Europe du début du 20e siècle, comme encore aujourd’hui ? Mais ces deux volumes, dont le deuxième approfondit et synthétise les approches du premier, ont le mérite d’avoir « historicisé », selon le terme même de Thomas Hunkeler, des avant-gardes parfois fétichisées du vivant de leurs inventeurs-hagiographes, et de révéler les ambiguïtés et les paradoxes qui leur confèrent une profondeur vivante.
Mai 2020