L’Utopie d’une révolution quelconque
par Christian Arthaud
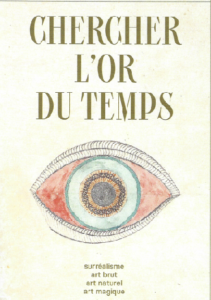
Le commissaire de l’exposition, « Chercher l’Or de temps » nous offre la lecture de l’article publié dans le catalogue de l’exposition.
par Christian Arthaud
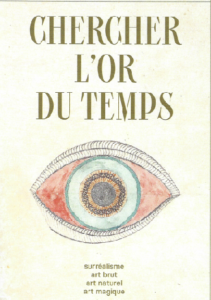
Le commissaire de l’exposition, « Chercher l’Or de temps » nous offre la lecture de l’article publié dans le catalogue de l’exposition.
Surréalisme et mythes celtiques par Patrick Lepetit
Texte de la conférence donnée le dimanche 30 octobre 2022 à la Halle Saint-Pierre. Les numéros en rouge renvoient aux numéros des diapositives projetées dans la salle.
2a Lors de la publication, en 1978, d’un numéro spécial surréalisme international de la revue Le Puits de l’Ermite, Jean Markale déclare à Gérard Bodinier, auteur de l’article « Celtie et surréalisme – L’Antre des bardes » : 2b » Le surréalisme et le celtisme, c’est pareil, mais il faut des nuances. Ils ont des démarches parallèles : ils refusent l’un et l’autre le dualisme et le socratisme. Le surréalisme est une vision du réel débarrassée de l’acquis méditerranéen, un détonateur pour le futur. Il arrive aux mêmes conclusions que le celtisme. » Que doit donc effectivement le surréalisme au celtisme compte tenu de la proximité objective entre eux ? Qu’est ce qui a pu interroger ou inspirer les surréalistes et leurs proches dans les mythes celtiques et quel a pu être l’impact de ceux-ci sur leur pensée et leurs productions ?
Le mythe est ici à prendre au sens étymologique de récit fondateur relatant des réalités, récit religieux d’une création originelle, mettant en scène des êtres surnaturels en lien avec le sacré, récit se référant à un ordre du monde antérieur à l’ordre actuel. Une manière de « retour sur le passé où dorment les doubles », comme dit Yves Elléouët. 3a Quant au celtisme, selon Paul-Marie Duval, c’est 3b » la projection instinctive sur le monde sensible d’une vision formée au plus profond de soi « . Et la Celtie, c’est moins, pour reprendre le mot de Michel Leiris à propos de la Bretagne, « une région qu’un microcosme, parcelle exemplaire du monde contenant tout », loin de toute « idéologie identitaire », tant il est vrai que le surréalisme ne saurait être d’un pays, fut-il virtuel.
C’est autour de quatre thèmes que j’ai décidé d’aborder la question, 4a les surréalistes et la Celtie, 4b le roman arthurien et la quête du Graal, 4c la ville engloutie, métaphore de la civilisation engloutie, et 4d la légende de la mort, titre emprunté à Anatole Le Braz. Autour de ces thèmes, un certain nombre de noms, 5a Julien Gracq, 5bAndré Breton ou 5c Yves Elléouët, pour les écrivains, 5d Leonora Carrington, 5ᵉ Yves Tanguy et 5f Ithell Colquhoun pour les peintres, parmi d’autres. Avec une place particulière pour 5 g Jean Markale qui, dans les années cinquante, joua de fait dans le domaine du celtisme le rôle d’initiateur qu’avait joué Kurt Seligmann dans celui de l’ésotérisme dans les années quarante, et qui fut de l’aventure surréaliste du début des années cinquante à l’année 1976, au moins, puisque l’on retrouve sa signature dans l’ouvrage collectif 6a La Civilisation Surréaliste, publié sous la direction de Vincent Bounoure dix ans après la disparition de Breton. Il est piquant de noter que c’est le fameux recteur de Tréhorenteuc, l’abbé Gillard, dont Breton avait fait la connaissance lors de ses séjours en Brocéliande, qui permit la rencontre entre les deux hommes ! C’est en effet sur la recommandation de cet ecclésiastique atypique et mal vu de sa hiérarchie que le jeune homme est reçu par Breton en 1950… Du reste, Breton conclut sa lettre de 1956 à Markale par ses mots : 6b « Veuillez, je vous prie présenter (…) mon discret souvenir au Recteur qui m’a fait boire dans le verre du pape après m’avoir découvert le Val sans Retour »…
Les surréalistes, comme je l’ai montré dans mon livre 8 Le Surréalisme : Parcours souterrain, se sont très tôt intéressés à l’ésotérisme dans leur combat contre la froide raison positiviste, “bourgeoise”, qui avait mené aux carnages de la Grande Guerre. En quête de racines, ils verront dans le celtisme la trace d’une “tradition” occidentale, « dans sa nudité éblouissante, comme elle se lève du ‘Combat des arbrisseaux’ dans Taliesin » dit encore Breton en 1962. Ayant toujours entretenu des liens étroits avec la Bretagne, ils ont compté parmi eux de nombreux Bretons, sous l’égide de 9a Jacques Vaché, bien sûr, né à Lorient et mort à Nantes. Dans le premier groupe, on relève ainsi les noms de 9b Péret, originaire de Rezé, en Loire alors inférieure, de 9c Tanguy, de 9d Baron… Un pays qui sera « l’autre lieu fictionnel » de la jeunesse 9ᵉ d’Alice Rahon qui se prétend née dans le Finistère alors qu’elle est originaire du Doubs mais passe bel et bien ses vacances chez ses grands-parents à Brest. Suivront plus tard 9f Claude Cahun, puis 9 g Gracq, qui n’est pas breton mais est venu aux mythes celtiques par le biais de Wagner et a longtemps vécu à Nantes, tout comme 9h Maurice Fourré, « homme de l’Ouest » pour qui donc « la quête du Graal n’est pas loin », comme l’écrit Breton dans sa préface à La Nuit du Rose-Hôtel, rédigée en août 1949 entre l’ile de Sein et la forêt de Paimpont. Sans oublier 9i Jean Markale, Charles Estienne, Yahne Le Toumelin, dont le journal Ouest France du 12 octobre 2022 révèle encore qu’à près de 100 ans, « elle parle sans cesse de sa cabane au Croisic », Jean Pierre Guillon, Jean-Claude Charbonel, 10 Suzel Ania ou Yves Elléouët, le gendre de Breton, qui de famille bretonne, reviendra dans le Trégor avec les Calder… Elléouët, l’auteur du 11a Livre des Rois de Bretagne et de 11b Falc’hun, à propos desquels Gilles Bounoure écrit : « La veine à la fois rabelaisienne et épique de ces grands dits, ce qu’ils doivent à l’admiration de leur auteur pour l’Ulysse de Joyce et sans doute aussi pour (…) Maurice Fourré (sans parler de Jarry l’adulé), tout cela passa inaperçu. On ne comprit pas qu’au rebours des “celteries” passéistes et druidisantes alors en vogue, le triporteur de Falc’hun (…) prolongeait jusqu’en plein XXᵉ siècle le tournoiement des triskèles 11c marquant les monnaies gauloises ». Elléouët, comme dit Michel Dugué, un « auteur chez qui » le temps de l’histoire s’efface au bénéfice de celui du mythe » qui, télescopant envolées lyriques et notations triviales dans un français parsemé de mots et tournures bretonnes inscrit le mythe dans le réel de 12a l’Armorique mais évoque aussi 12b « le pays kymry », 12c « Ivernia, l’ile de nos frères gaëls » et la 12d « Bretagne bleue », faisant gaiement un sort à la vision stéréotypée du pays datant du XIXᵉ siècle et tuant ainsi dans l’œuf tout “folklorisme”. Et ce sans complaisance excessive : invoquant notamment les Irlandais Joyce et Beckett1 ainsi le Gallois Dylan Thomas2 qu’il apprécie particulièrement, il écrit : 12ᵉ » Nous Celtes ivrognes errants / et tout pleins d’amertume » – ce que sont précisément les « Amis des anciens jours » du Livre des rois de Bretagne ! En parlant de Celtes d’Outre-Manche, il faut dire ici un mot d’une surréaliste méconnue, 13a Ithell Colquhoun, née aux Indes en 1906, mais d’ascendance maternelle cornique. Peintre et écrivain, mais aussi 13b druidesse dont la participation à de nombreux gorsedds est avérée, notamment à Paimpont en 1964, Ithell Colquhoun, très tôt intéressée par le celtisme et l’hermétisme, se rapprocha des surréalistes dans les années 30. Membre du groupe de Londres de 1936 à 1940, elle en fut exclue à cause de son trop grand intérêt pour l’occultisme mais elle se revendiqua toujours – à juste titre – de l’esprit du surréalisme. Son recueil Grimoire of the entangled thicket (Le Grimoire du fourré impénétrable), titre partiellement emprunté à un vers du « Combat des Arbrisseaux » de Taliesin, recèle un cycle de poèmes sur les fêtes des Celtes et un autre sur les mois de leur calendrier. Elle pensait que « le fond celtique en Grande Bretagne, et dans une moindre mesure en France, est l’équivalent collectif de l’inconscient réprimé chez l’individu (ce qui) explique pourquoi la race anglo-saxonne, qui joue le rôle d’un surmoi, se méfie de la race celte, l’imprévisible ça, et la méprise ». Auteur de deux livres singuliers sur l’Irlande en 1955 (The Crying of the Wind : Ireland) et la Cornouaille (The Living Stones : Cornwall) en 1957, elle finit par s’installer près de Land’s End, dans la vallée de 14a Lamorna, où elle vécut jusqu’à sa mort en 1988, un endroit où l’on trouve la plus grande concentration de vestiges archéologiques à l’hectare de toutes les iles britanniques et où l’esprit celte peut même prendre la forme 14b d’hallucinations auditives qui lui rappellent les « récits d’antan » à propos des cortèges de fées » ! Son œuvre picturale est caractérisée par l’utilisation fréquente de motifs floraux stylisés, détail qui prend un relief particulier à la lecture de ces lignes de Delmari Romero Keith à propos du travail de… Leonora Carrington : « L’héritage impressionnant laissé par les Celtes se mesure à leur haute maîtrise du dessin de la flore et de la faune. Les plantes revêtaient des significations religieuses selon qu’elles prenaient la forme de spirales, de ronces ondulantes, de feuilles de lotus, de palmes et de cercles concentriques. Les images de divinités, de monstres hybrides et d’animaux mythiques étaient ornées de motifs végétaux. Cette calligraphie rappelle 15 le Livre de Kells, manuscrit enluminé très élaboré de moines chrétiens irlandais du VIIIᵉ siècle, dont le style en circonvolutions est proche de celui de Leonora » ! Une Leonora Carrington dont Elena Poniatowska écrivait en 2008 16 qu’elle était « la dernière surréaliste, la dernière survivante, la seule qui tienne du dolmen et du menhir, de la dalle et du pilier, de la pierre, de la roche et du lézard, de la bergère et de la semeuse. Leonora, déesse celte, druide, reine des spectres, maîtresse de l’inframonde, connait la formule des potions magiques et résout dans sa peinture les énigmes qui parfois nous angoissent dans la nuit obscure » ! Ithell Colquhoun et Leonora Carrington, ces deux femmes si proches… Breton lui-même, bien que né en Normandie, à Tinchebray, fut imprégné dans son enfance de l’atmosphère générale de l’Armorique et initié aux traditions et légendes bretonnes par son grand-père Le Gouguès. Imprégnation que manifeste symboliquement dans ses textes l’image récurrente de l’hermine, 17 « l’hermine assassine et pure (qui) règne sur la Bretagne » également représentée par Carrington dans une belle œuvre de 1950-51 ! Dans les années cinquante encore, 18 il rappelle qu’il est « d’ascendance maternelle purement bretonne et (que) (s)on patronyme donnerait à penser que cette filiation ne s’arrête pas là »… Il a parcouru la Bretagne en tous sens, à commencer par Nantes, « peut-être avec Paris », dira-t-il, « la seule ville de France où j’ai l’impression que peut m’arriver quelque chose qui en vaut la peine (…), où un esprit d’aventure au-delà de toutes les aventures habite encore certains êtres. » Il ne se familiarisera vraiment, comme ses amis, qu’assez tardivement avec les mythes celtiques. En témoigne cet extrait d’une lettre de 1956 à Markale à propos de la préparation de « Braise au trépied de Keridwen » : « Vous savez que je ne suis guère ferré sur le celtisme – et je le déplore spécialement. Je suis perdu si je ne dispose pas d’un minimum de documentation »… Le déclic, préparé par la sortie du Roi Pêcheur, de Gracq, en 1948 et la rencontre avec Markale, survient en 1954 avec la publication de L’Art Gaulois des Médailles, de Lancelot Lengyel puis en 1955 l’exposition Pérennité de l’Art Gaulois à Paris, partiellement organisée par Charles Estienne, Lancelot Lengyel et Breton lui-même, et à laquelle prennent part les surréalistes. Cela lui inspire deux textes, « Triomphe de l’Art Gaulois » et « Présent des Gaules ». Parallèlement à l’exposition, « le vieux fond arthurien fit surface » et plusieurs communications, par Adrien Dax, Lengyel et Markale, sont publiées dans Médium puis dans Le Surréalisme même en 1955. Suit en 1956 « Braise au Trépied de Keridwen », la préface de Breton au 19livre de Markale sur Les Grands Bardes Gallois – Aneurin, Llywarch Hen, Mirddyn et Taliesin… La manière dont Breton y présente l’auteur montre d’ailleurs qu’il connaît très bien Brocéliande. En 1981, lors de la réédition du livre, Markale écrit : « Pour André Breton, comme pour moi, (…) il fallait crier, par la voix des bardes du VIᵉ siècle, ce que nous sentions en nous-mêmes, à savoir que le réel qu’on nous imposait n’était qu’une imposture, et qu’au-delà de la vision quotidienne, il existait un point où toutes les contradictions s’estompaient, un point où le jour et la nuit n’étaient que les deux aspects d’une même réalité. » Pourtant, c’est plus de reconnaissance d’une convergence que de découverte qu’il s’agit : cet univers-là était déjà depuis longtemps celui de Breton.
Même si peu de surréalistes, à l’exception d’Artaud, se sont aventurés outre-manche, les mythes celtiques, par leur formidable charge poétique, les ont tout de suite marqués. Et ils continuent à le faire. J’en veux pour preuve le travail de Jean Claude Charbonel autour de ce « peuple imaginaire » que sont 20 les “Armorigènes”. Dans un entretien avec Laora Maudieu en 2008 il expliquait ainsi : « La notion de mythe et de légendes s’y retrouve tout à fait, et ce qui m’intéresse dans cette charge mythique et légendaire de la Bretagne, c’est celle qu’on 21 retrouve à la fois dans le cycle arthurien, le cycle du Graal, dans les poèmes traditionnels, les chants traditionnels bardiques du Pays de Galles du XIIᵉ siècle »… 22 Jean-Claude Charbonel a été à l’honneur, en compagnie de son ami le surréaliste gallois John W. Welson, lors de l’exposition 23 Surréalisme : l’Œil Celte à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, à Aberystwyth au cours de l’été 2011. Les œuvres de John Welson, dont la famille laboure, au moins depuis le Domesday Book de 1086, le « comté sauvage et désolé du Radnorshire, au Pays de Galles », sont » un reflet du pays, de ses monts et de ses vaux, des mythes et de l’histoire qui reposent sous les collines couvertes de bruyères », collines dont les « sommets émoussés et les vallées encaissées » 24 prennent sous la lumière particulière l’allure de « grandes bêtes endormies », à moins qu’il ne s’agisse là d’“illusion”…
Les textes qui forment la Matière de Bretagne, au cœur du mythe, ces « romans de la Table Ronde (…) tenus dans le surréalisme en grand honneur », comme dit Breton, datent souvent des IVᵉ ou Vᵉ siècles et ont été transcrits par des moines autour du IXᵉ siècle voire aux XVIIIe et XIXᵉ siècles par les “folkloristes” comme Hersart de la Villemarqué (Barzaz-Breiz, 1839), ou Anatole Le Braz, en France, Iolo Morganwg au pays de Galles ou James Macpherson, en particulier, en Écosse, dont on sait l’influence déterminante sur le Romantisme.
Les noms de Merlin, l’homme des métamorphoses, Tristan, qui meurt d’un amour fatal, et Lancelot, type même du chevalier arthurien, reviennent très tôt sous la plume des surréalistes. Peut-être sous l’influence d’Apollinaire qui avait remis le thème au goût du jour dès 1909 avec son 25 Enchanteur Pourrissant, l’un de « ses plus admirables livres », selon Breton, relecture parodique ou prosaïque du mythe, et aussi, c’est moins connu, avec la Très plaisante et récréative hystoire du très preulx et vaillant chevallier Perceval le Galloys, jadis chevallier de la Table Ronde, lequel acheva les adventures de Sainct Graal, au temps du noble Roy Arthus, revisitation de Chrétien de Troyes datant, elle, de 1918. Peut-être y a-t-il là également quelque souvenir de Saint-Pol Roux, ce Magnifique 26a que les surréalistes appréciaient tant et dont Elléouët évoque 26b la demeure aujourd’hui en ruines… Ou de Victor Ségalen, 27a ce « voyageur-né » à qui Jean Louis Bédouin consacrera un essai, né à Brest et retrouvé mort 27b en forêt d’Huelgoat. Ou de Jarry, 28 qui revendiquait hautement, selon Audoin, sa qualité de Breton – « non tant de la Bretagne côtière où pourtant il avait pêché aux crevettes dans son enfance, que de l’Ar-Coat, terre ignorée dont il semble s’être fait un refuge : un nid d’aigle – ou de faucon, selon que chacun se prononcera sur l’envergure ». “Faucon” se dit « Falc’hun » en Breton… 29 Xavier Grall qui, bien que chrétien avéré, brille quelque part de l’éclat surréaliste, résume ainsi la question : « La vraie matière de Bretagne, pour peu qu’on délaisse les niaiseries régionalistes, est surréaliste. Et l’a toujours été. C’est la nuit. Nous y sommes. (…) Max Jacob, Villiers, Corbière et ce jeune mort que nous pleurons, Yves Elléouët, sont Celtes et surréalistes. Et ces retables et ces saints dans leurs niches et ces démons et ces dragons. Et ces rois dans les rues d’Ys. Et ces femmes dans les lacs. Les malédictions, les enchantements. On ne peut dire le monde que poétiquement »…
31 On sait l’importance que Breton accordait au premier roman de Gracq, Au Château d’Argol qu’il voyait comme une réécriture du mythe du Graal. Or, 32 Julien Gracq donne sans doute une des clés permettant de comprendre l’intérêt des surréalistes pour le roman arthurien en écrivant dans l’Avant-propos de sa pièce Le Roi Pêcheur, en 1948 : « Le compagnonnage de la Table Ronde, la quête passionnée d’un trésor idéal qui, si obstinément qu’il se dérobe, nous est toujours représenté comme à portée de main, figurent par exemple assez aisément en arrière-plan un répondant – au retentissement indéfini – pour certains des aspects les plus typiques de phénomènes contemporains, parmi lesquels le surréalisme… » Et le celtisme sous-tend nombre de ses textes souvent placés sous le signe de la Matière de Bretagne. La figure, par exemple, du Roi Méhaigné traverse toute son œuvre. Probable avatar de Bran le Béni, héros des Mabinogion gallois qui deviendra le Ban de Bénoïc de la Table Ronde, le Riche Roi Pêcheur, ce mutilé victime d’une blessure entre les cuisses, est une des figures-clé du Roman Arthurien sous sa forme tardive, christianisée. Figé par Chrétien de Troyes à la fin du XIIᵉ siècle, il pourrait trouver son origine dans un récit plus ancien, relevant de la tradition orale, peut-être » The Spoils of Annwn » (les Dépouilles de l’Abime), un poème attribué à Taliesin dans lequel Arthur et ses compagnons partent sur le navire Prytwenn vers Kaer Sidi – source d’inspiration probable du 33 Dernier matin à Kaer Sidhi de Yahne Le Toumelin. Quant au Graal, il n’est, avant Chrétien, qu’une simple coupelle ou un chaudron, comme il y en a tant dans la littérature arthurienne. Celui du Maître de l’Abîme, « Peir Pen Anwn, le chaudron d’inspiration et de renaissance » de Taliesin, chauffé par le souffle de neuf vierges – ici, on pense au cycle d’aquarelles 34 Dance of the Nine Maidens d’Ithell Colquhoun. Celui de la déesse Keridwen, figure clé du « Combat des Arbrisseaux », qui a inspiré 35 Yahne Le Toumelin, encore. La « jeune vieille Keridwen », qui, dans Falc’hun « fait bouillir un chaudron selon l’art des livres de Fferyllt afin qu’au bout d’un an et un jour, trois gouttes magiques de ‘grâce et d’inspiration’ soient obtenues ». Et, si c’est par le biais de Wagner que les mythes celtiques sont convoqués par Gracq dans « La Presqu’ile », il y décrit une errance à travers un « Marais Gât » qui évoque irrésistiblement la Terre Gaste entourant ce château du Roi Pêcheur où Perceval, dont le modèle gallois se nomme Peredur, n’ose poser LA question qui lèverait la geis, la malédiction qui pèse sur le roi impur et la contrée ! En tout état de cause, ce vase, est comme dit le surréaliste Octavio Paz, « un moyen de consécration et de métamorphose : ‘Boire la coupe de la vie’, vases sacrés des rituels, calices contenant des breuvages qui transforment, ressuscitent ou tuent, etc. La richesse d’associations à partir du vase est infinie et, à toutes, préside l’idée de changement ». Et Philippe Audoin de commenter : « Cette justification spontanée épuise à peu de choses près les aspects et les qualités qu’on peut prêter au Graal surréaliste, à partir d’une représentation parfaitement acceptable du Graal légendaire. »
D’origine anglo-irlandaise Leonora Carrington, considérait que son adhésion enthousiaste au surréalisme trouvait sa source dans les contes populaires irlandais que lui contaient sa nurse et sa grand-mère maternelle et, de fait, on en retrouve souvent l’esprit dans ses œuvres, comme ce 36 Cheval rouge du Sidhe, à tel point que le musée d’art moderne de Dublin lui a consacré, il y a peu, une exposition intitulée : Leonora Carrington, the Celtic surrealist. Elle a aussi écrit un « authentique roman surréaliste, 37 The Hearing Trumpet (1956 – Le Cornet Acoustique), qui est directement et explicitement un roman du Graal ». Leonora Carrington y décrit notamment, par la voix du « Facteur Taliessin (sic) », « barde errant », les tribulations du Saint Graal d’Irlande en Angleterre, puis en Amérique. On y apprend que le vase sacré a été dérobé à une sorte de déesse-mère, la Mère-Grand, ce qui a provoqué son bannissement de cette terre et par voie de conséquence, « abomination et désolation sur le genre humain ». Ce vol a été commis par les adorateurs de Dieu le Père, « initiés spéciaux » sachant bien « que leur pouvoir d’hypnose sur l’humanité ne pouvait durer si Mère-Grand reprenait possession du Graal ». Seule la restitution de « la Coupe (…) pour qu’elle la remplisse de Pneuma et la confie à la garde de son consorts, le Dieu cornu » peut permettre son retour… Seul, en fait, le basculement du monde permettra la découverte du Graal ! Le mythe du Graal rejoint ici la Grande Déesse et certaines croyances gnostiques, ce qui n’est pas étonnant quand on sait l’intérêt de Carrington pour l’ésotérisme ! Ce Graal-là peut sans doute aussi être rapproché du Chaudron de Keridwen et le « facteur Taliessin », proche parent du Troadic Cam d’Elléouët, également présenté comme un barde, pourvu d’une « fiole enchantée » contenant un « puissant élixir », n’est autre que le Taliesin dont Markale a tiré les textes de l’oubli !
Dans son court essai, « The Waterstone of the wise3 » (« L’Aquarium des sages »), publié en 1943 dans la partie surréaliste de l’anthologie New Roads, Ithell Colquhoun, clairement influencée par les Prolégomènes à un troisième manifeste du surréalisme ou non, donne sa propre vision du nouveau « mythe en rapport avec la société » qu’au nom du surréalisme (Breton) jug(e) alors “désirable” d' »imposer. » Parmi les éléments permettant de parvenir à sa définition, elle mentionne « the unceasing chauldron rimmed with pearls », le chaudron magique d’émail bleu bordé de perles, qui apparait dans « The Spoils of Annwn » et qu’elle semble avoir découvert dans le livre du “folkloriste” irlandais Thomas W. Rolleston Myths and Legends of the Celtic Race 38, qu’elle possédait. Son roman, Goose of Hermogenes, 39 probablement le « texte surréaliste le plus abouti en langue anglaise » contient également des allusions à la littérature du Graal et au roman gothique. Ithell Colquhoun, qui était aussi franc-maçonne, a par ailleurs appartenu du début des années 60 au milieu des années 70 à la loge du Saint Graal n°5, à l’Orient de Tintagel, une loge qui axait notamment son travail sur la recherche autour du « symbolisme et des légendes du Saint Graal et de la tradition Arthurienne » et dont les membres « s’efforçaient de mettre en pratique dans la vie quotidienne les principes mis en avant par la quête du Saint Graal. »
Même Aragon, qui toute sa vie se réclamera du surréalisme, le Aragon de 1942, se souvenant sans doute aussi d’Apollinaire, commet un Brocéliande dans lequel, autour du personnage de Merlin, il revendique la reprise de « tous les merveilleux français » : 40 » Le temps torride étreint l’arbre étrangement triste / Tord ses bras végétaux au-dessus de l’étang / Et des chaînes d’oiseaux chargent ce chêne-christ // L’enchanteur n’en est plus l’invisible habitant / Et si ce n’est Merlin qui s’est pris à son piège / Qui demeure captif dans le bois palpitant? » Un fragment qui fait écho à ce passage du poème « Merlin et la vieille femme » d’Apollinaire : 41 « Au carrefour où nulle fleur sinon la rose / Des vents mais sans épine n’a fleuri l’hiver / Merlin guettait la vie et l’éternelle cause / Qui fait mourir et renaître l’univers. » Un Merlin bien loin de celui dont Elléouët nous décrit, dans le Livre des Rois de Bretagne, de manière assez crue, les ébats avec une Viviane « extrêmement nue » dont la « chair drue le hantait » : 42 « Elle est venue dans la bulle d’air. ‘Tout ce que tu voudras, disait-elle. Fais de moi ce que tu voudras.’ Il l’a prise ; l’a écartelée. Pas un pli de sa chair qui n’ait été fouillé par le sexe… » – mais Apollinaire ne nous montrait-il pas déjà une Viviane prise de frayeur à l’heure où « coulaient le long de ses jambes les larmes rouges de la perdition » ! En tout état de cause, le vieux mage est encore à l’honneur en 1960 à l’occasion de l’exposition 43 Surrealist intrusion in the Enchanter’s Domain aux D’Arcy Galleries de New York. Et puis, Merlin n’est-il pas le nom que Jacqueline Lamba, l’amour fou de Breton, a choisi de donner au fils qu’elle a eu avec le surréaliste américain David Hare !
Pierre Mabille dans 44 Le Miroir du Merveilleux donne son interprétation, très surréaliste dans l’esprit, du Graal : « Et l’homme poursuit la quête du Graal ; il parcourt périlleusement les espaces à la recherche de la coupe d’or, grâce à laquelle le rite pourra se célébrer. Il heurte les invisibles obstacles, se meurtrit dans des essais infructueux ; il frappe aux portes closes ; il tend son effort frémissant vers la belle inconnue, vers celle dont la seule présence lui révèlera enfin le but qui est le sien, lui donnera la véritable connaissance du monde et rompra à jamais, par la vertu de l’amour, la stérile solitude. » Le Graal serait-il tout simplement la femme aimée ? On peut le penser en regardant La Goutte d’eau 45, ce très beau collage d’Aube Elléouët, l' »émerveillée-émerveillante », mais c’est en tout cas aussi l’opinion de Jean Markale qui écrit : « Le Graal, sous quelque forme qu’il apparaisse dans les textes, est une figuration féminine, et la quête que le chevalier entreprend pour découvrir le Graal est une quête de la féminité. »
Les surréalistes de l’après-guerre, s’identifient aux personnages du roman arthurien comme le montrent bien ces mots de Jean Louis Bédouin : « Ceux-là (les surréalistes autour de Breton) se veulent errants, et c’est à juste titre qu’on les comparerait en cela aux chevaliers légendaires de la cour d’Artus, qui ne consentaient jamais à s’arrêter, ni à se laisser arrêter, même par la fatigue, même par les monstres… » 46 Et si Gracq dit que certaines phrases de Breton « auraient pu sans invraisemblance trouver place dans la bouche du roi Arthur en son château de Camaalot », Audoin va jusqu’à la comparaison : « On ne rira pas, sinon sottement, que je présente Breton comme chevalier du Graal, le plus ardent, le plus et le mieux exposé, le plus aventureux, celui qui s’absente et dont on attend le retour. Était-il le Roi de la Table 47 ? Sans doute, mais pas comme on l’entend (…) Breton séduisait surtout par cette aura propre à ceux qui reviennent de loin, sans pour autant en être revenus. » Les surréalistes se sont parfois donnés des noms de chevaliers de la Table Ronde 89 ! Breton écrit ainsi à Elléouët : « Vous êtes aussi Lancelot du Lac au jeu des analogies quand je le pratique seul avec moi-même ». Lui-même s’identifiait parfois implicitement au vieil enchanteur4, à qui il est comparé – et on se souviendra ici que Merlin/Myrddin, est l’un des bardes de Markale. Stanislas Rodanski aussi prend le nom de Lancelo, mais sans “t” et fait grand usage de ce personnage, de la Dame du Lac et du Val sans Retour, dans son « Lancelo et la Chimère » où il écrit : » L’horizon est moi, Lancelo le lointain « . Et c’est d’ailleurs sous le signe du Dernier Lancelot 49 que Jacques Hérold a placé le numéro 2/3 de la revue Cée consacré au poète en 1977 ! Mais c’est surtout à Tristan et Iseut, cette extraordinaire quête amoureuse à laquelle même la mort ne suffit à mettre un terme, qu’il fait référence : « Par la suite, j’appris que la plage à qui j’attribuais tant d’importance est celle de Penmarch. Penmarch, c’est là que Tristan agonisant se fit porter pour guetter sur la mer le retour d’Iseut la Blonde ». Or quelques lignes auparavant, Rodanski confiait : « Ce que je n’ai encore raconté à personne, c’est que j’écrivis mon nom dans le sable comme on le ferait sur une tombe »… Comment ne pas y repérer un processus d’identification et ne pas se demander si Iseut n’est pas, pour lui, cette « personnification du rêve » dont parle Markale ! Rodanski, mentionnant aussi « philtres et sommeils hypnotiques », poursuit ainsi : « Ce roman celtique me passionne depuis l’enfance. En 1947, je me rappelle avoir souvent dit à Véra (Hérold) que j’étais Tristan, l’abréviation que l’on donne à mon prénom – Stan au lieu de Stanislas – pouvant être la dernière syllabe de Tristan. J’ai depuis bien souvent médité sur ce roman. Je ne pense pas qu’il soit bon d’en faire une histoire. Mais je me fie par trop à la fatalité pour ne pas reconnaître que si j’en suis imbu, le hasard objectif – beau comme la rencontre d’un aviron et d’une aile blanche tachée de sang frais sur le bord de la mer – l’a justifié ». « Je ne pense pas qu’il soit bon d’en faire une histoire » ! C’est là l’aveu que la « matière de Bretagne » est bien une de ses sources d’inspiration… Une source à laquelle vient également s’abreuver Elléouët dans le Livre des Rois de Bretagne où Troadic, que l’arthrose tient « sous son funeste charme », attend qu’on lui apporte le bâton sans lequel un barde n’est pas un barde. Il « guette à l’horizon l’apparition des ‘Amis-des-Anciens-Jours’ (car) ils sont convenus ensemble, renouvelant l’histoire de Tristan, que la voilure du vaisseau les ramenant de l’ile sera(it), en signe de succès de leur entreprise, de la blancheur du lait (et que) dans le cas d’un échec, l’antenne arborera(it) l’obscurité du deuil »… Mais là aussi, Elléouët qui est de ces auteurs pour qui « le patrimoine culturel dont est riche la Bretagne, n’est pas seulement constitué de vieilles pierres, de paroles légendaires ou d’une longue tradition historique », mais se forge dans « ce qui du passé survit dans le présent et travaille l’avenir », ne se laisse pas emporter par le côté mythique du personnage et, maniant l’anachronisme avec talent, fait se télescoper, peu après, deux réalités qui valent bien la rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection : son « Tristan de Loonois », « va, sur les vagues de la mer d’Irlande dont l’écume lui fait de beaux sabots de mie de pain. Il aborde à une terre avec ses villages dans les creux où les tracteurs caparaçonnés de purin et de paille – armures de rois africains – stationnent sur les places, devant l’église » ! 50 Le mythe, pourtant, fait toujours surface, fut-ce allusivement : bien qu’Arthur comme Tristan soient depuis longtemps associés à la Cornouaille, c’est à l’amant d’Iseut que l’on pensera en lisant 51 le poème “Tintagel” du même Elléouët. Ifern ien5 de l’amour !
S’il y a peu de représentations artistiques directes du mythe Arthurien chez les surréalistes, Thérèse Tremblais-Dupré émet une hypothèse troublante à propos des « objets merveilleux » des romans de la Table Ronde » : « Les objets merveilleux inhérents au ça, dit-elle, appartiennent à un monde totalement contraire ; sans origine, sans finalité, atemporels, échappant à toute loi du réel, ils sont étymologiquement ‘étonnants et impossibles’. » Françoise Hann prolonge cette idée en signalant, après avoir souligné la proximité chez les Celtes entre le monde des vivants et celui des morts, que la communication entre les deux, qui est constante, « se fait par l’intermédiaire des héros, requis d’aller chercher les objets merveilleux qu’ils obtiennent en échange de grands risques… Des règles analogues ne définissent-elles pas les rapports de la poésie avec le poète ? Que le risque couru par le héros celtique exige des qualités presque surhumaines ne va pas à l’encontre des aspirations surréalistes. N’a-t-il pas sa transposition dans le ‘long immense et raisonné dérèglement de tous les sens’ et les images rapportées par les voyants ne sont-elles pas les épées, les coupes enchantées ? Le poème surgi au moyen de l’écriture automatique n’est-il pas un objet venu d’ailleurs, l’irruption du féérique dans le quotidien ? » Comment ne pas songer ici à ces merveilleux objets symboliques réalisés par les surréalistes, comme 52 le Loup-Table de Victor Brauner ou le Déjeuner en Fourrure de Meret Oppenheim… Si 53 The Bird (c. 1940) d’Ithell Colquhoun ou 54 Midi/Minuit (1966) de Toyen semblent bien relever aussi du clin d’œil au mythe, c’est dans 55 La maison d’en-face de Leonora Carrington, représentation selon Whitney Chadwick « de l’Autre-monde inspiré des légendes celtiques », qu’il s’épanouit le plus ouvertement sous la forme du chaudron d’immortalité, un parmi tant d’autres, autour duquel s’affairent trois femmes, trois comme les sorcières de Macbeth… Et dans une de ses toiles trône, central, un calice qui pourrait bien être le fameux vase sacré ! A moins qu’il ne s’agisse 56 de celui représenté par Seixas Peixoto en 2014 ou de cette Nanteos Cup 57 peinte par John Welson, cette coupe conservée à la bibliothèque nationale du Pays de Galle, à Aberystwyth et qui passe pour être le vrai Graal… Breton, lui-même, en donne sa version dans De la survivance de certains mythes et de quelques autres mythes en croissance ou en formation : 58 Il le symbolise par une crucifixion de Picasso, coupée par collage par l’as de coupe du jeu de tarot. Or, le tarot ayant toujours été suspect aux yeux de l’orthodoxie, cela pourrait montrer la volonté de Breton de replacer « une scène majeure du christianisme (…) dans la dépendance d’un mythe qui la déborde. » En légende figure une citation tirée d’Au Château d’Argol : » L’amère devise qui semble à jamais clore – et ne clore à jamais sur rien d’autre que lui-même – le cycle de Graal : ‘Rédemption au Rédempteur »… Riche de sens, ce Graal, singulièrement “déchristianisé”, parmi les symboles que Breton retient en vue de la création du « mythe nouveau » qu’appellent les surréalistes !
Pour Breton et ses amis, la christianisation du Graal, symbole païen de régénération et de fertilité, est tentative de récupération par l’Eglise d’un mythe bien plus ancien… Dans l’Avant-propos au Roi Pêcheur, Gracq écrit ainsi : « Mais les deux grands mythes du Moyen Age, celui de Tristan et celui du Graal, ne sont pas chrétiens : par beaucoup de leurs racines ils sont préchrétiens : les concessions dont leur affabulation le plus souvent portent la marque ne peuvent nous donner le change sur leur fonction essentielle d’alibi. L’étrangeté absolue de “Tristan” tranchant sur le fond idéologique d’une époque si résolument chrétienne a été mise en évidence par Denis de Rougemont. A toute tentative de baptême à retardement et de fraude pieuse, le cycle de la Table Ronde se montre, s’il est possible, plus rebelle encore. La conquête du Graal représente – il n’est guère permis de s’y tromper – une aspiration terrestre et presque nietzschéenne à la surhumanité tellement agressive qu’elle s’arrange décidément assez mal d’un enrobement pudique et des plus hasardeux dans un contexte chrétien aussi incohérent que possible… » Quant à Breton, Audoin explique que, « si la geste arthurienne a exercé sur (lui) une fascination croissante, c’est à proportion de ce qu’elle retenait de mythes antérieurs à l’évangélisation, voire à la romanisation, et en lesquels il pressentait une force émancipatrice propre à contrebalancer le joug d’un humanisme responsable à ses yeux des multiples entraves imposées à l’imaginaire et au désir. »
La Quête, dans le roman arthurien, est quête d’une autre réalité mais dans ce monde ci, une aventure impliquant courage et détermination. 59 Elle n’est « ni un cheminement linéaire et horizontal, ni une posture verticale et intellectuelle, mais une immersion dans un espace-temps ouvert, illimité et imprévisible » selon Bernard Rio qui ajoute : « Ainsi les vagabonds de la Table Ronde trahissent-ils dans leurs allures et comportements des héros d’une antiquité sans frontière, un temps où le monde des vivants côtoyait le monde des morts, où le simple mortel appréhendait le royaume des dieux et des fées, où la quête était l’essence de l’existence. » Chez les surréalistes, aussi, les voyages périlleux à travers le monde tel qu’il est, mènent vers le royaume obscur dont ils ramènent, qu’ils soient créateurs ou non, des trésors – fabuleux ou non – à condition d’avoir conservé cette pureté qui permet l’émerveillement. Mais la quête, manière de traverser la Terre Gaste où nous vivons, est également chez eux métaphore du désir de découvrir les secrets dissimulés dans l’inconscient, de rencontrer l’amour, de préférence fou, et, au-delà, éternelle recherche du merveilleux ! Les convergences sautent aux yeux…
L’attrait de Breton pour le celtisme est donc fondé sur le rejet de la culture latine puis chrétienne tenue pour responsable de l’état d’un monde dominé par cette froide raison positiviste et bourgeoise, si loin de la « raison ardente » des surréalistes. La tentative d’éradication de la culture celte par Rome a provoqué, « chez l’Occidental », explique-t-il dans « Braise au trépied de Keridwen », un « refoulement “honteux” de son passé, en conséquence durable de la loi du plus fort, imposée il y a dix-neuf siècles par les légions romaines ». Or la prise en considération de la situation nouvelle en 1945 a entraîné « un sursaut atavique nous porta(n)t’à interroger sur ses aspirations profondes l’homme de nos contrées tel qu’il put être avant que ne s’appesantît sur lui le joug gréco-latin »… et il poursuit ainsi : » La révélation – pour le grand nombre – de l’art celtique, qui se donne libre cours dans les médailles et se prolonge dans la sculpture après la conquête, avec en arrière-plan, celui des mégalithes tel qu’il se déploie avec faste dans le tumulus de Gavr’inis, est pour faire 61 amèrement déplorer le manque de documents écrits de l’époque, de nature à nous renseigner plus précisément sur l’organisation des idées-forces qui y présidaient. » Artaud, quant à lui, n’expliquait-il pas, déjà, dans une lettre de 1937 à sa famille : « Je suis à la recherche de la dernière descendante authentique des Druides, celle qui possède les secrets de la philosophie druidique »… Ithell Colquhoun, elle, place, en 1957, en exergue de son livre sur la Cornouaille une phrase du druide et poète irlandais Amergin – « Qui, à part moi, peut dévoiler les secrets du dolmen de pierre brute » – et y décrit une cérémonie druidique contemporaine. La même année, Lengyel émet l’hypothèse que le « souci intransigeant » mis par Breton à défendre « une vision du surréel dont les deux pôles d’attraction sont (…) l’automatisme et l’art magique » (…) « vient de loin comme le commandement secret du dernier rassemblement des druides indépendants, (ses) frères, avant la persécution latine ». Et ce n’est pas par hasard qu’Yves Elléouët cite Tuàn Mac Cairill, le 62 druide primordial de la mythologie irlandaise, celui qui assure la transmission du savoir… Ni qu’il intitule son premier récit, où sont par ailleurs cités tous les bardes gallois ressuscités par Markale, Le Livre des Rois de Bretagne, titre qui, au passage, ressemble fort à celui de l’Historia Regum Britanniae du gallois Geoffrey de Monmouth – ce récit qui fonde la légende de la colonisation de l’Armorique par les Bretons de Conan Mériadec ! Le texte d’Elléouët, selon Marc Gontard, « peut – dans une intertextualité très lâche, évoquer les sources du corpus bardique : Le Livre noir de Camarthen, le Livre rouge d’Hergest, Le Livre de Taliesin, tandis que dans le prédicat titulaire s’inscrit la fonction essentielle du barde, personnage officiel et mémorialiste des sociétés celtiques »… C’est du reste cette même fonction qui est assignée à Troadic Cam, « barde originel » dont « l’archétype modélisant » n’est autre que Taliesin. La culture celte fait donc figure de monde englouti, même s’il faut noter la survie d’une église celtique au message original – au moins jusqu’au VIIIᵉ siècle – ainsi que la permanence des anciens mythes dans l’oralité. Roger Renaud le souligne bien dans son article « Nos Descendants les Gaulois » : « Au reste la pensée, la tradition européennes existent : à partir de la renaissance qu’elle connut au Moyen-Age, par exemple, l’éclosion de la première poésie lyrique, autour de la Matière de Bretagne, montre que la pensée celtique survivait encore à toutes les agressions dont elle était l’objet depuis plus de mille ans. Et l’on peut aisément suivre son cheminement jusqu’à nous. » Or ce « passé submergé », comme dit Lengyel, quel meilleur symbole en trouver que le mythe de la Ville d’Ys. 63 C’est du reste ce qui ressort d’une note consacrée par Alain Jouffroy à Yahne Le Toumelin où dit que la Bretagne lui a donné, outre son nom, « l’arrière-fond d’eaux remuantes, d’eaux peu transparentes où une certaine ville engloutie a tué avec elle la signification de la plupart des mythes celtes qu’une relecture des romans de Chrétien de Troyes ne permet de réveiller que par échos interposés »… Ys, ainsi évoquée par Breton à la fin de son second texte sur Yves Tanguy : » Un marin de Douarnenez, ne pouvant après la pêche dégager son ancre, plonge et la trouve engagée dans les barreaux d’une fenêtre de la ville d’Ys. Dans cette ville engloutie, appelée par la légende à renaître, tous les magasins sont restés illuminés, les marchands de drap continuent à vendre la même pièce d’étoffe aux mêmes acheteurs. Yves derrière la grille de ses yeux bleus » ! Lignes qui montrent, au passage, que Breton connaissait parfaitement La Légende de la Mort d’Anatole Le Braz. Outre le fait que la phrase « Les marchands de drap continuent de vendre la même pièce d’étoffe aux mêmes acheteurs » figure mot pour mot dans Le Braz, le chapitre XI de son livre, sur les villes englouties, commence par un récit très semblable. Certes, Breton omet de préciser que le filet s’est pris dans les grilles de la fenêtre de la cathédrale d’Ys, mais Elléouët le fera… 64 « Les ruines cristallines de cet ancien continent s’accommod(a)nt des bavures amorphes de la mer », l’Armorique compte nombre de cités et de contrées englouties mais on retrouve cette légende dans d’autres pays celtes et à la forêt de Scissy, engloutie en baie du Mont Saint Michel avec ses villages, fait écho, dans le roman arthurien, le pays de Lyonesse, terre natale de Tristan et fief de Galaad, qui se trouvait, dit-on, quelque part entre la Cornouaille britannique et les îles Scilly… Au pays de Galles, c’est la ville du roi Gwyddneu noyée en baie de Cardigan et qui a fait l’objet de poèmes recueillis à la fin du XIIᵉ siècle, mais sans doute bien antérieurs. En Irlande, c’est celle qui repose sous les eaux du Lough Neagh… Ys, la plus célèbre de ces cités englouties, apparait aussi sous la plume d’Elléouët 65 : « Falc’hun le Vieux parlait : ‘Ce sont les morts de la Ville engloutie. Tous les noyés font sonner les cloches des cathédrales dans la cave. (…) J’entends sonner les cloches de la Ville évanouie, au fond de la cave (…). Et dans chaque cathédrale, l’officiant célèbre la messe des âmes, encloses dans la malédiction de la ville. Il suffirait qu’un vivant répondît Amen à l’une des oraisons prononcées pour que toutes ces âmes soient délivrées et quittent la Cité engloutie dans la cave et dans les profondeurs froides de la mer. (…) La Ville elle-même referait surface comme au temps de Grallon Aenobarbe. Elle brillerait ainsi qu’un joyau à l’occident et deviendrait la capitale du monde ». Dans son premier livre, Elléouët raconte à sa manière la submersion d’Ys. Il évoque Dahut et lui donne une sœur, Oanez, métamorphosée en jument marine ayant servi de monture à Gradlon dans sa fuite. Oanez conte ainsi, de manière peu édifiante, la disparition de Dahut/Ahès, probable souvenir d’une « ancienne déesse bretonne honorée dans la région de la pointe du Raz », selon Markale : « L’anachorète Gwénolé participait au sauve-qui-peut sur un hongre assez peu véloce. Il exhortait le roi à se débarrasser de Dahut : Car sinon, roi Grallon, ululait-il, nous serons engloutis et damnés à jamais… Mais vous connaissez cette histoire. Et comment Grallon, roi de Cornouaille, d’une poussée brusque jeta la fille qui lui restait dans l’impétuosité aquatique, afin que la colère divine – c’est ce qu’ils ont toujours prétendu par la suite, pour justifier cet inqualifiable infanticide – s’apaisât ; en réalité, pour sauver leurs vies de vieillards en sacrifiant la Jeunesse et la Beauté » 66. Puis Oanez narre la métamorphose de Dahut en Marie-Morgane : « Les courants sous-marins l’avaient déjà entraînée à des milles de profondeur. Il était écrit que son destin devait ainsi s’accomplir et que sa propre mue s’élaborerait pendant un an et un jour loin des regards humains. Ce temps écoulé, elle réapparut plus éblouissante encore qu’auparavant, l’eau étant devenue son élément naturel. Depuis lors, elle hante, de l’orée de la nuit jusqu’à l’aube dissolveuse de monstres les eaux argentées du littoral « ! Le mythe est bien là, dans ses grandes lignes, mais subtilement réécrit par l’auteur qui ramène à leurs justes proportions la “sainteté” de Gwénolé et la sagesse de Gradlon – taxé d’infanticide – tout autant que la “perversité” de Dahut, « la plus folle d’entre les folles d’Ys aux portes marines ». A la manière de la femme celte qui, souveraine et libre comme la reine Maeve en Irlande, offre aux hommes « l’amitié de ses cuisses » et le réconfort, Dahut incarne, dit Markale, cette « souveraineté féminine (…) occultée, engloutie sous les eaux, dans les ténèbres de l’inconscient », qui, « lorsqu’elle réapparaitra en plein jour » permettra que se « réalis(e) l’harmonie du monde, que soit « retrouvé le paradis perdu où règne, toute puissante et éternelle, la femme-soleil, celle qui donne la vie et qui procure l’ivresse de l’amour ». Or, la légende d’Ys « était largement diffusée à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle par des feuilles volantes et des chansons populaires », autour de Locronan où Yves Tanguy passait ses vacances depuis 1912, près de cette baie de Douarnenez où il se baignait, où il entendait les récits des pêcheurs parlant de filets coincés dans les grilles de la ville engloutie, où les premiers archéologues parlaient de ruines sur les hauts-fonds et notaient l’existence de voies romaines, les chemins d’Ahès, convergeant vers un centre disparu… Locronan, 67 cette petite ville portant le nom d’un de ces saints de Bretagne qui sont « l’image fantasmatique du druide celtique devenu prêtre chrétien », avec ses Troménies citées plusieurs fois par Breton, version christianisée d’un très antique rituel solaire ! Et Tanguy, dont « le rêve n’avait pas plus de limites que n’en a la laisse, à marée basse », écrit Audoin, « un homme de l’ouest, familier de l’Ankou et des Lavandières de nuit ; un homme de légende, maître des orages magnétiques qui chargent ses premiers tableaux, puis s’éloignent en ne laissant qu’une brume légère et, sur les grèves, ces êtres-objets complexes, fruits de métalloïdes rares, polis et repolis par l’incessante fellation des marées. » Le père de Tanguy s’intéressait à l’ésotérisme et au druidisme et s’était rendu plusieurs fois en Irlande, au Pays de Galles et à Glastonbury… Comment s’étonner qu’Yves et ses frères se mettent en tête de cartographier tous les menhirs de la région ! Plus tard, le peintre se dira « descendant des druides chrétiens » et Eluard le qualifiera de » guide du temps des druides du gui ». Sa nièce, Geneviève Morgane Tanguy 68 écrit à son propos : « Sur le sujet du druidisme, il était très calé, ayant étudié depuis qu’il était en Amérique toute sorte « d’histoires de sorciers » autour de Salem, mais qui étaient en fait les vestiges de rites autrefois pratiqués dans ces régions comme en Irlande et en Armorique. Il consultait des ouvrages sur les civilisations celtiques, sur l’origine des Celtes et du druidisme, sur leur philosophie, leurs pouvoirs magiques ». Et Josick Mingam affirme qu’il rêvait « de voir liés le Carnac du Morbihan breton et le Karnak égyptien. » Tanguy ayant toujours dit que s’il « devai(t) chercher les raisons de (s)a peinture, ce serait un peu comme s'(il s’)emprisonnait (lui)-même » et même déclaré que « la géographie n’a(vait) aucune influence sur lui », André Cariou prend moultes précautions pour affirmer : « Il est absurde de vouloir trouver dans les peintures de Tanguy les paysages de Bretagne, de tenter d’identifier un phare ou de rechercher des formes ressemblant à des mégalithes. Mais on y retrouve beaucoup : les vastes plages de Saint-Efflam (à Plestin) et de la baie de Douarnenez où la marée est de forte amplitude et libère de vastes étendues de sable à basse mer, les brumes océaniques, une palette à dominante de gris, les plages voilées qui vont disparaître de l’œuvre ultérieurement ». « Une Bretagne engloutie carillonne au fond de son œuvre », note Patrick Waldberg ! Cité par José Pierre, John Sharkey, l’auteur de Celtic Mysteries écrit : « Les mystères celtes s’élaborèrent dans le flux d’états intermédiaires, (…) L’aire où se rencontrent des mondes différents, tels le passage de la vie à la mort, la brume flottante entre la surface de la mer et le ciel, le crépuscule, l’aube et le bord du gué, revêtait un sens particulier pour les Celtes ». 69 Cet indéterminé, cause, selon lui, de l' »étonnant dynamisme poétique, qui propulse l’être à travers tous les possibles, est ce qui inspire également le plus spécifique des productions de l’art celtique, des monnaies des Osismii et des Vénètes jusqu’au célèbre Book of Kells (…), dernier témoignage du génie créateur des Celtes dans le domaine plastique » – avant Tanguy ou Charbonel… Tanguy, lui, a confié : « Je sais que je possède une seule invention à moi : j’ai supprimé la ligne qui sépare l’eau du ciel » ! 70 Ses toiles apparaissent comme des décors dont toute vie est absente comme dans le roman O et M. de Charles Estienne, dont l’action se déroule dans « un pays de mer », jamais plus nettement désigné mais où l’on va « sur la lande » voir le soleil se lever sur « la grande pierre » : 71 » Un autre promontoire bas sur la mer, et l’on marche au milieu de pierres de toutes tailles éparses sur la dune ; vers une ombre géante, à dimension du spectateur pourtant, un énorme rocher fait comme un personnage, qui s’enlève vers le ciel avec une légèreté écrasante sur son socle où roule et déferle le ressac. La lumière de la lune fait ressortir l’affleurement des plans de clivage comme celui d’autant de marches. » Mais, à propos de paysage, parlons des dolmens et menhirs, qui s’y dressent, même s’ils sont d’origine pré celtique, et de ces tumuli qui, en Irlande en particulier, sont les portes d’entrée dans l’autre-monde ! A l' »arrière-plan » seulement dans l’œuvre de Tanguy, à l’image du « tumulus de Gavr’inis » pour Breton, cercles de pierre et alignements ont inspiré de nombreuses toiles 72 ou collages aux surréalistes, de Prévert à 73 Toyen ou Alice Rahon 74 en passant par Ithell Colquhoun – sa Dance of the nine opals (1942) 75, représentation artistique d’un cercle de pierres situé près de chez elle ou encore le Mên-an-Tol (1940) 76 montré à de nombreuses reprises. Et Raoul Ubac, en 1975 encore, déclare, au sujet de ses stèles d’ardoise 77 : « Je crois avoir des affinités avec les sculpteurs qui ne vivent plus depuis longtemps, par exemple ceux qui ont fait Carnac » ! Plus près de nous, le Gallois John Welson, ami de Jean-Claude Charbonel, peint aussi régulièrement les monuments mégalithiques de son pays, comme en témoigne cette Standing Stone 78 de 2013. Selon leur vœu, les cendres d’Yves Tanguy, auteur du tableau Les Profondeurs Tacites, et de son épouse, Kay Sage, ont été dispersées en 1964 en baie de Douarnenez, ce qui éclaire d’un jour singulier le « Yves derrière la grille de ses yeux bleus » de Breton mais aussi le surnom dont l’affubla le peintre après leur brouille de 1945 : » l’A.B. des Trépassés »… « Sous les flots de la mer, suggère Markale, la Ville d’Ys est toujours là, avec sa princesse engloutie : celui qui le premier, le jour de la surrection d’Ys, entendra sonner la cloche, celui-là possédera le royaume dans sa totalité, et Dahud-Ahès de surcroît » ! Cela aussi figure, presque mot pour mot, chez Le Braz ! Certains surréalistes, il n’y a aucun doute, ont entendu au moins l’écho de la cloche…
« On a pu dire de la Bretagne, avec quelque raison, qu’elle est le pays par excellence de la mort. Déjà, au temps de Pomponius Mela, les nautoniers de ses rivages avaient la réputation de conduire aux sombres bords les mânes des défunts, d’être de mystérieux passeurs d’âmes. Leurs descendants ont gardé, à un degré rare, le goût du surnaturel : les choses de l’Autre-monde les passionnent peut-être plus que les réalités de la vie présente, et l’on trouverait difficilement, parmi les nations civilisées, une autre race qui vive d’aussi près, en une communion aussi étroite, avec ses morts » expliquait Anatole Le Braz en 18946. Les anciens Celtes, dont la métaphysique occulte sophistiquée a résisté à la christianisation, considéraient la mort comme métamorphose, au milieu d’une longue vie. 80 L’Au-delà, qu’aucun peuple ne désigne avec plus d’abondance et d’exactitude qu’eux, est partout, sous terre aussi bien que sous l’eau. Et c’est vrai dans tous les pays celtes, en particulier en Cornouaille, si l’on en croit cet extrait de l’article de 1971 « Cornish Earth » d’Ithell Colquhoun : « Les morts sont ‘tout autour de nous’ : on sent qu’ils participent d’une vie diffuse dans l’atmosphère des endroits où ils ont vécu et sont morts. (…) Mais on n’a guère foi dans l’immortalité de la personne – ‘Nous ne les reverrons jamais’ dit-on de relations disparues. On envisage une perpétuation dépersonnalisée – nous étions sur terre avant et continuerons d’y être. « … ! Vie et mort, pour les Celtes, ne sont donc pas antinomiques. Les morts, tout simplement, vivent à côté des vivants, dans un monde voisin aux limites floues. Le Braz fait observer que « dans la croyance des Bretons, les morts ne sont jamais vraiment morts » et qu’ils « dorment le jour durant et une moitié de la nuit pour se réveiller à l’heure où, dans les chaumières et les manoirs, les vivants se sont endormis à leur tour. Ils se lèvent par grands essaims silencieux, frôlent de leur pas muet les routes désertes »… Elléouët s’en souvient peut-être en écrivant 81 : « Les lagunes habitées, les haies hantées, les chemins sont propices. Car les vivants dorment, tandis que les morts apparaissent dans les rues ; ils s’arrêtent devant le débit Cariou, dont les vitres reflètent la lune. Georges les entend. (…) Il ouvre la porte ; il est dehors, au milieu des ombres flottantes, suspendues dans l’air qu’elles colorent de bleus passés et d’ors vieillis. Il va vers les dunes, environné de ces présences à peine sensibles. Parfois se distinguent les linéaments d’un visage qui se confond bientôt avec le ciel plein de lumière blanche, avec l’herbe grisâtre. » Le verre comme limite entre les deux mondes, la nuit, la porte, les « ombres flottantes » « impondérables et qui ne laissent pas plus de traces que la fumée » : en franchissant le seuil de sa demeure, le héros est passé d’un monde à l’autre… « Ces deux mondes, dit Markale, ne sont en effet séparés que par l’apparence : ils coexistent » parce que les Celtes, et les Bretons en particulier, ont voulu négliger le réel sous son aspect illusoire et transitoire pour ne s’attacher qu’à la découverte d’un Réel absolu, caché sous l’autre, mais permanent, éternel. Quelque chose comme ce que décrit Estienne dans O et M. : « C’est à croire que ce pays », or il s’agit d’un « pays de mer », « est fait pour prouver dans le monde l’existence du gris, comment dire, les droits du gris, et ce n’est pas que la persistance du ciel à être ainsi soit triste, non : il semblerait plutôt que cette tonalité immuable de la lumière atmosphérique réponde à une autre tonalité, à une autre lumière, cette fois véritablement immuable, inaltérable, essentielle. C’était en somme comme si se réfléchissait, dans ce ciel présent et visible, la lumière d’un autre pays, peut-être plus proche – bien qu’il demeurât invisible ». Toujours cet indéterminé, cette imbrication de deux réalités qu’exprime bien la fameuse phrase d’Eluard et Breton : » Il y a un autre monde, mais il est inclus en celui-ci » tant il est vrai que « L’Au-delà, tout l’Au-delà » est « dans cette vie ». Or c’est précisément de leur coexistence confuse que nait la surréalité. Des passages existent entre les deux mondes, gué, entrée d’une grotte, marécage, pont, et ils s’ouvrent en particulier lors de Samain, le nouvel an celte, début novembre. 82 Deux mondes en miroir, mais un miroir que l’on peut traverser dans certaines conditions, souvent sur injonction de puissances surnaturelles.
C’est encore chez Gracq qu’on trouve les plus belles allusions à Samain, dans « Le Roi Cophetua », parfois considéré comme « une réécriture “occulte” du Roi Pêcheur ». En ce premier novembre 1917, le narrateur, un journaliste réformé, a été convié par son ami Nueil, pilote militaire, dans sa propriété près de Paris. Il traverse donc en train les plaines inondées du nord de Paris, puis une forêt, avant de parvenir chez son ami où une servante le reçoit. Nueil, dont l’avion a sans doute été abattu, ne viendra pas et au terme d’une très longue attente, le narrateur se laissera séduire par la servante avant de littéralement fuir, le lendemain matin, sans avoir d’ailleurs posé la moindre question… Or cette nouvelle semble inspirée par les légendes celtiques du voyage dans l’autre monde. Vu le goût de Gracq pour celles-ci, et la nature tripartite du voyage du narrateur qui lui fait traverser une Terre Gaste (la plaine dévastée), un Gué périlleux (la forêt “démontée”) jusqu’au château du Roi Pêcheur (la maison), on peut y voir une allusion à la mythologie celtique ! La maison de Nueil, isolée au sein « d’une forêt que tout désigne comme magique », est pourvue de « larges baies » vitrées « qui la coupent de son environnement immédiat » et on a vu l’importance de l’eau, ou à défaut du verre, comme frontière entre les mondes. La panne d’électricité qui prive la demeure de lumière est à rapprocher du fait que « les druides inauguraient la période de Samain en faisant éteindre, la veille, tous les feux d’Irlande ». En plus, « la coexistence au sein d’un même espace de l’élément igné (feu et lumière) et de l’eau nocturne est caractéristique de l’Autre monde celtique. » La “servante” ici fait plutôt figure de prêtresse d’un culte ésotérique et conjugue les trois fonctions essentielles des femmes des mythes celtes, pouvoir magique, force vitale et fertilité. Comme le suggère le parallèle tracé par Gracq avec le tableau 83 d’Edward Burne-Jones, elle fait « partie d’une dyade sacrée », incarnant « le principe féminin dont le masculin a besoin pour devenir un principe actif selon les celtes. » Nueil y figure le vieux roi que vient remplacer un successeur plus jeune afin de régénérer le royaume en train de basculer dans le sommeil ou la mort. Tout cela prend un sens particulier si l’on se souvient des paysages inondés, en odeur de guerre, traversés par le narrateur. Mais, tel Perceval au château du Roi Pêcheur, lieu d’affrontement entre les deux mondes, le narrateur ne comprend pas sa mission malgré une véritable initiation, attente inquiète dans une quasi-obscurité, toilette lustrale puis repas plus ou moins cérémoniel. La progressivité du récit de Gracq, de la traversée de la forêt tourmentée au début de l’hiver à la sortie du héros sous une lumière qui évoque le printemps est conforme au schéma des légendes celtiques à thème saisonnier. Mieux : comme le temps du mythe et le nôtre ne coïncident pas, le héros perdant conscience de l’écoulement du temps, on peut penser que le séjour chez Nueil a duré, non pas une nuit, mais toute une année et que le narrateur ressort en novembre 1918, à la signature de l’armistice, ce qui expliquerait l’aspect paisible d’un monde ayant recouvré la paix. Parfaite illustration du fonctionnement, peut-être souterrain, des mythes celtiques chez certains surréalistes.
Cette confusion entre le monde des vivants et celui des morts, le présent et le passé, dans le flou d’une hallucination, tant visuelle qu’auditive, Charles Jameux, membre du groupe surréaliste de 1964 à 1969, en a fait directement l’expérience et la relate dans son anamnèse-fiction Souvenirs de la maison des vivants. D’ascendance bretonne, Charles Jameux fut victime en novembre 2004, d’un très grave accident de la circulation. Pendant sa longue hospitalisation – « rite de passage de mort et de résurrection » – il raconte avoir fait, juste après sa sortie du coma, un rêve pour le moins étrange. Allongé un soir sur son lit de douleur, « vers minuit » – l’heure où s’ouvrent les passages – il entend de la musique, des chants et des danses au-dessus de sa chambre : Bombardes, binious et cornemuses, bruits de sabots et de chaussures de cuir. 84 « Et puis brusquement le bruit cesse et fait place à un silence total. A ce moment précis, détournant le regard vers la droite en direction d’une fenêtre – qui s’avère après coup ne pas exister – j’aperçois une scène extraordinaire. Sur le perron de l’hôpital, descendant gravement et en silence les quelques marches accédant à la porte d’entrée, défilent les uns après les autres les protagonistes de cette fête nocturne imaginaire. Viennent en tête les paysannes vêtues de velours noir et de tabliers de dentelle blanche ; elles tiennent leurs robes à deux mains en en déployant les plis. Chacune porte une coiffe. Viennent ensuite des cavaliers en selle qui descendent lentement les marches du perron. Ils sont vêtus d’un costume traditionnel ancien que je voyais encore pendant mon enfance lors de rassemblements folkloriques : pantalons rayés ou culottes légèrement bouffantes, chaussures et chapeaux noirs à boucles d’argent, vestes à parements tissés de fils d’or (…). Un léger brouhaha clôt le passage des dernières personnes du défilé, tandis que mon rêve s’affaiblit et que je retourne au sommeil. » Au réveil, l’infirmière qu’il interroge lui dit qu’il ne s’est rien passé de tel et le laisse avec « une sensation oppressante (…) liée à l’atmosphère pour le moins étrange (de cet) épisode et (à) sa ponctuation finale ». Un épisode qui a toutes les caractéristiques du rêve, gravité, silence, lenteur et majesté dans un climat d’inquiétante étrangeté, comme lorsqu’un mortel assiste en catimini à quelque cérémonie de l’Autre-monde à laquelle il n’est pas convié…
Chez Elléouët, dont le héros, Falc’hun rode, lui aussi, « sur les frontières de deux royaumes, celui des vivants et celui des morts, sans qu’on sache très bien auquel il appartient », c’est une autre forme de mythe celtique qui prend figure : celui de l’Ankou. 85 Même si, selon Markale, il n’apparaît pas avant le XVᵉ siècle, l’origine du personnage est obscure, et il semble très ancien, empruntant sans doute certains traits au Dagda irlandais. Dagda, dieu-druide ou dieu des druides, règne sur le temps, l’éternité, les éléments et l’Autre-monde, et a pour attribut, entre autres, une massue qui tue dans un monde et ressuscite dans l’autre. L’Ankou, dont l’attribut est une faux tournée vers l’extérieur, n’est cependant pas la version celtique d’un dieu de la mort. Ce n’est qu’un personnage psychopompe, »l’ouvrier de la mort », qui hante les chemins creux, la nuit, debout dans sa charrette, le Karrig an Ankou. Il doit certains de ses traits actuels aux prédications des pères Julien Maunoir et Michel Le Nobletz qui au XVIIᵉ siècle en firent « une exploitation terroriste », pour rechristianiser une population hantée par ses anciennes traditions… Chez Elléouët, qui en a laissé plusieurs représentations directement inspirées par Anatole Le Braz, 86 il s’agit d’une sorte… d’épicier ambulant, chez Maurice Fourré, d’un VRP, tous deux au volant d’une camionnette ! Dans le Livre des Rois de Bretagne, Jos l’Ankaw, « plus vieux que la mémoire et que la voix » avec « sa longue figure jaune (qui) exprime constamment une sorte de bizarre allégresse », parcourt tout le pays » en long, en large et en travers, en haut et en bas, ici et là, partout et nulle part, nuit et jour, par grand vent, par beau temps », se livrant à un commerce étrange, débarrassant à chaque étape son véhicule de ses denrées comme son homologue funèbre vide sa charrette des pierres qui la lestent chaque fois qu’il cueille une âme. « Je connais tout le monde, et un jour ou l’autre chacun me connait », se vante Jos, « le Grand-Pourvoyeur » 87. « Là-bas, écrit encore Elléouët, des pierres marquent l’emplacement du cimetière de l’âge du bronze. Là-bas, émerge, comme un sein coupé flottant sur l’eau, le tumulus de l’ile Carne avec l’ombre douloureuse du roi Carn » 88. Et l’auteur prête à Jos devisant avec Troadic les mots suivants : « Alors, j’apparus dans l’ile, dit l’Ankaw. Debout sur ma charrette dont l’essieu imite le cri du courlis. Et les larmes du roi tarirent dans ses yeux morts et cessèrent de couler sur la peau de sa face morte ». Ce qui renvoie Jos l’Ankaw lui-même aux temps d’avant l’histoire, à plus forte raison d’avant les prédications de Maunoir et Le Nobletz, au temps du mythe… Analyse confirmée par cette évocation, placée par Elléouët dans la bouche d’Eliezer Falc’hun : 89 « Je remonte le temps dans la contrée des hommes aux longs cheveux coiffés du chapeau à rubans, les cuisses dans des braies plissées. (…) Les Ombres attendent aux carrefours ceux qui rentrent d’une ripaille ou d’une beuverie lointaines. Il arrive qu’on puisse entendre, de nuit, grincer l’essieu de la fatale charrette. Elle roule à grand bruit sur les chemins blancs ; des crânes s’y entrechoquent entre les ridelles. Le cocher funèbre fixe la route de ses orbites vides, dans une face crispée comme un poing. » Dans Tête de Nègre 90, Fourré nous parle, lui, en termes saisissants de l' »ANKOU, la mort celtique, aux yeux de miroir, conduisant les légendes gaéliques, qui arrivèrent du Nord sur les vagues de la mer, dans des pirogues de granit ». Et Monsieur Maurice, « ce singulier personnage, furtif et monumental nautonier de notre secret Navire de Brumes », le VRP dont j’ai parlé, « énigmatique conducteur d’une ‘camionnette angevine’ qui parcourt, à l’instar de la charrette à l’essieu grinçant de la Mort Celtique, – les nuits ensorcelées de l’Ar-Coat », nous dit Audoin, y « est encore plus inquiétant que le vieil Ankou. Celui-là, au moins quand on le rencontrait, retour de ribote, ou qu’on entendait seulement grincer dans la nuit celtique les roues de sa charrette, on savait à quoi s’en tenir sur son sort prochain : une confession pour Itrun Varia et un drap neuf pour l’ensevelissement. Mais avec M. Maurice, rien n’est certain. Il se mêle de tout. Il, passons-nous l’expression, fout la merde, et repart comme il était venu. Il est pressé, il voyage, comme le juif errant ». Cas particulier et unique de traitement de la question, en un ébouriffant jeu de miroirs, « dans cette liturgie hilare et funèbre, Fourré s’incarne pareillement dans l’Ankou, double complice et affreusement cajoleur de tout vivant prétendu. Et il signe carrément l’hécatombe : « Le nommé Maurice/ est responsable/ de TOUT. »
Dans O et M., 91 de Charles Estienne apparaît une étrange figure, Louis, « le dernier des gardes », ainsi décrit : « … l’allure du personnage, sa vêture, – le chapeau de feutre à plumes noires, l’anneau d’or à l’oreille droite, l’autre déchirée – O reconnaissait – c’était… » – et on reste sur ces trois points de suspension ! Or Louis, peu après, emmène O et M., le maître, dans une charrette dont l’auteur dit : « Les ressorts bondissent irrégulièrement, mais on roule, et n’était ce cri des essieux, cette plainte… » et plus loin » Maintenant, la voiture s’éloigne – et l’essieu crie bas, où est-il cet oiseau à la patte cassée ! ». Comment ne pas penser à l’Ankou et au bruit de sa charrette, ainsi évoqué par Elléouët dans le poème “Pencran” : » l’essieu grince zig-a-zag / sur la route de nuit à la lune / wig-a-wag wig-a-wag / dans les chemins oubliés à la nuit voyante ». Chez Estienne, la légende de la mort rejoint le roman gothique car l’homme qui se trouve à côté de ce conducteur n’est autre que Melmoth, l’Errant, un autre errant…
C’est encore à l’Ankou que fait allusion Philippe Audoin dans un texte sur Jarry où il écrit : « Cette mort-là est celte. Elle ne frappe pas au hasard. Elle signe le destin prescrit et a la courtoisie de s’annoncer aux “élus”, retour de ribote, par ces grincements d’essieu ou ces bruits de battoirs qui dramatisent la nuit bretonne »… « Bruits de battoirs » ! D’autres figures celtiques de la mort, en effet, présentes chez Le Braz, hantent les textes surréalistes, comme les « lavandières du noir, les Maouès-noz » 92, qui dans Le Livre des rois de Bretagne, « battent de leur battoir que n’entend plus l’oreille de l’homme endormi. » Ces « lavandières de la nuit à la taille de diabolo qui battent au bord des rus les linceuls des morts à venir », comme l’écrit Elléouët expliquent peut-être le titre du poème énigmatique de Breton « Au lavoir noir », avec ses « obscurs présages », dans lequel la primauté de la nuit se conjugue à l’omniprésence de l’au-delà. Elles figurent également dans « Ce que Tanguy voile et révèle » en 1942 : « Souvenirs : la lavandière de nuit, agenouillée dans sa demi-caisse de bois, il faut absolument la faire taire ». Ces femmes de nuit, dont il faut s’abstenir de « prendre (l)a place, la nuit », clairement présentées comme malfaisantes, comme l’est l’étrangère du texte intitulé « celle qui lavait la nuit » dans La Légende de la mort apparaissent aussi dans un texte de 1948 de Stanislas Rodanski, » A bord de la nef des fous » : « … frayeur des lavandières, écrit Rodanski, mortes de peur en faisant une lessive de fantômes – une lessive de sang frais et de violence ».
« Pleurer les défunts, à la mode de Bretagne, guetter les intersignes relatifs à l’espérance de vie de tel ou tel membre de la communauté villageoise, c’est affaire de femmes, de sœur, d’épouse, de mère » rappelle Philippe Audoin, en écho à Le Braz qui dit que les intersignes, qui « sont comme l’ombre, projetée en avant, de ce qui doit arriver », annoncent la mort et que certaines gens ont plus que d’autres le don de voir ce qui reste invisible aux yeux de la plupart des hommes. Comme toutes les formes de prémonitions, ils ont intéressé les surréalistes et si je ne cite pas ici directement Elléouët, c’est que l’esprit-même de La Légende de la mort plane sur toute l’œuvre, avec ses ombres dans les nuages ou sous les eaux… Autre exemple, la cuisinière bretonne de La nuit du Rose-Hôtel de Maurice Fourré, vit dans un « monde silencieux d’intersignes, avec le cortège familier de ses défunts. » Une phrase de Desnos vient parfaitement illustrer cette atmosphère et ce rapport du mythe aux paysages qui l’ont fait naître : « Nous constatons de surnaturelles présences dans des paysages incroyables. « Dans Au Chateau d’Argol, récit dont la tension dramatique se nourrit de présages, de pressentiments, de signes annonciateurs, la prémonition prend même la forme d’une extraordinaire coïncidence proche du hasard objectif tel qu’André Breton le définit dans L’Amour fou. Et à propos de L’Amour Fou, que dire de cette scène où Breton évoque « un état affectif en totale contradiction avec (leurs) sentiments réels » qui se développe entre lui et sa femme après leur visite au Fort du Loch, près de Lorient : « Tout se passe comme si, en pareil cas, l’on était victime d’une machination des plus savantes de la part de puissances qui demeurent, jusqu’à nouvel ordre fort obscures. Cette machination, si l’on veut éviter qu’elle entraîne, par simple confusion de plans, un trouble durable de l’amour, ou tout du moins sur sa continuité un doute grave, il importe au plus haut point de la démonter. » Ces prémonitions, funestes ou non, relevant quelque part du hasard objectif, nous ramènent aux liens existant entre la conception celtique d’un monde duel et le surréalisme. Breton, dans son article « Le Pont suspendu », parle même une « autre dimension, inconnue dont John W. Dunne invite à chercher le secret dans le temps sériel. » Et il cite un long passage du livre Le Temps et le Rêve de cet irlandais : « Le sérialisme révèle l’existence d’un genre raisonnable d’“âme”, d’une âme individuelle ayant dans le Temps absolu une origine bien déterminée – âme dont l’immortalité, intéressant d’autres dimensions du Temps, n’entre pas en conflit avec la fin manifeste de l’individu dans la dimension temporelle du physiologiste« ! 93 L’Autre-monde des Celtes serait-il cette autre dimension ?
La présence des mythes celtiques dans les textes surréalistes, à l’exception de Carrington, d’Elléouët et de manière plus voilée, de Gracq et de Colquhoun, sauf chez le précurseur Apollinaire, n’est jamais massive. Ils n’y sont que latents, même s’il est clair que les surréalistes – et rappelons que le surréalisme est d’abord une manière d’être au monde – se sont vécus comme une communauté initiatique élective empruntant des traits à la Table Ronde. Inspirés par l’esprit d’une philosophie conçue comme celle des véritables lumières, ce n’est pas le mythe comme récit qui les intéresse, 94 mais les figures ou objets mystérieux, du Graal au Château sur fond de brume ou de ténèbres, en ce qu’ils sont énigmatiques et relèvent par là-même du merveilleux. De la même manière, l’épopée celtique, dans son ensemble, étant une quête, elle ne pouvait que croiser et contaminer l’aventure surréaliste par l’effet d’une convergence objective qui veut que « deux mille ans avant que le surréalisme parle de ‘beauté convulsive’, les médailles gauloises les plus élaborées (…) offrent l’image accomplie de cette beauté » comme dit Bédouin. Armand Hoog, ami de Gracq et de Breton, a très bien défini l’attitude surréaliste en l’occurrence : » Le cartésianisme a détruit pour deux siècles nos liaisons avec le rêve, avec une poésie aussi vitale que l’oxygène. Le romantisme et le surréalisme, ces deux tentatives miraculeuses dont on ne sait peut-être pas encore voir l’importance inouïe sont les sursauts révolutionnaires d’une conscience écrasée par le rationnel, le logique. Or, notre moyen âge a vécu de la Matière de Bretagne, 95 des romans arthuriens, des prestiges du Graal, de Camaalot et de Brocéliande. Trois cent ans de durée poétique se sont abreuvés à la Table Ronde. C’est pourquoi il fallait que les restaurateurs de la merveille retrouvent le chemin enfoui. 96 C’est pourquoi le chef du surréalisme s’appelle Breton (éblouissant hasard), même s’il s’adresse aux magies parisiennes. C’est pourquoi Julien Gracq ne pouvait situer le Château d’Argol ailleurs que dans le beau pays de Storrvan, et la maison où va mourir le Beau Ténébreux ailleurs qu’au fond d’un golfe, au bord de la mer celtique ». Ce qui a très vite intéressé les surréalistes dans les mythes celtes, c’est la trace d’une tradition occidentale préromaine, les surprenants vestiges d’une lignée native. 97 Ouvertes, en effet, sur l’immensité, du vieil océan, l’Armorique, et au-delà, la Celtie, sont terres où souffle l’esprit, où règne le merveilleux, où la vie et la mort, la terre et l’eau, le haut et le bas s’abolissent dans l’absence d’horizon, un dégradé de couleurs et de sensations qui pourrait bien être précisément quoique mythiquement ce lieu où les contradictions s’abolissent dont parlait Breton.
1C’est une phrase de Beckett qui figure en exergue de Falc’hun.
2Qu’il découvre grâce au surréaliste Jacques Bernard Brunius, notamment, traducteur, du long poème Under Milk Wood. Dylan Thomas, bien qu’il ait refusé d’être associé au surréalisme, participa à l’exposition internationale de Londres en 1936 – en offrant aux visiteurs « des rafraichissements de ficelle bouillie dans des tasses à thé » !
3Titre emprunté à l’alchimiste allemand Johann Ambrosius Siebmacher.
4« Moi qui entends cela du fond de mon tombeau je me garde d’y contredire, écrit-il dans « La porte de la maison de Lise… »
5Enfer blanc.
6Anatole Le Braz. « La Fête des morts en Bretagne. » Article publié dans le Journal des débats politiques et littéraires du 1ᵉʳ novembre 1894.