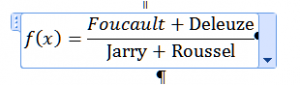« René Char : le poème et l’action », Études littéraires, vol. 47.3, automne 2016, sous la direction de Laure Michel et Anne Tomiche, Université Laval, 2018.
Compte-rendu par Catherine Dufour
[Télécharger cet article en PDF]
Le volume 47.3 de la revue d’Études littéraires consacre un dossier à Fureur et Mystère (1948) de René Char, qui rassemble des textes écrits de 1938 à 1947, réunis après la guerre en cinq recueils : Seuls demeurent (1945), Feuillets d’Hypnos (1946), Les Loyaux adversaires, Le Poème pulvérisé et La Fontaine narrative (1947).
Engagé dans les maquis et refusant toute publication pendant la durée de la guerre, René Char semblait entériner l’incompatibilité entre l’action sur le terrain et l’action par la poésie, « dérisoirement insuffisante ». La lecture approfondie de Fureur et Mystère incite cependant à nuancer de telles affirmations. Les questions abordées au fil des articles permettent de cerner les caractéristiques d’une poésie résistante qui refuse de se dire « poésie de la Résistance ». Il y est question notamment des relations entre l’action et le verbe, du recours au silence poétique et à l’obscurité, du choix des formes (prose, feuillets, aphorismes), du rôle joué par la figure de Sade.
Ce dossier est complété par une analyse de La Case du commandeur d’Édouard Glissant et un entretien avec Le Clézio, suivi d’un article sur son écriture « sismographique », qui prolongent, à leur façon, la question de l’engagement en littérature.
Bertrand Marchal, « L’action et le verbe dans Feuillets d’Hypnos »
La confrontation entre les « loyaux adversaires » (allusion au titre du troisième recueil de Fureur et Mystère) que sont « l’homme d’action » et « l’homme du verbe » sert de long préambule à B. Marchal, étayé par une étude serrée de l’Argument inaugural de Seuls demeurent et des métaphores, bibliques ou agropastorales, qui caractérisent ces deux protagonistes. Il en ressort que les opposer serait un contresens et que leur contradiction n’est pas de nature « hégélienne », mais « héraclitéenne ».
La suite de l’article s’organise autour des trois principes qui structurent cette dualité action/verbe : la suspension de la parole, l’éthique de l’action et l’invention d’une « poéthique ».
L’action clandestine suppose une « traversée du désert de la parole », qui renvoie à l’exode biblique. Le poète est un enfant (in-fans : celui qui ne parle pas encore). Le tarissement de la Sorgue est une image privilégiée de cette suspension. Mais Hypnos veille dans la nuit comme la Madeleine à la veilleuse de Georges de la Tour.
Une « éthique de l’action », qui se réfère au stoïcisme, remplit la place laissée vide par la suspension du verbe. Le « retour sur soi » poétique prépare à l’action, qui doit se réduire à l’essentiel, par « élagage de soi » et apprentissage de la liberté contre tous les déterminismes, darwiniens, marxistes ou freudiens.
La « poéthique » a pour mission de concilier l’action avec l’ascèse « du plus haut silence ». Le poète est tour à tour élagueur de branches mortes, aiguilleur, sourcier, boulanger de la « nouvelle eucharistie », berger nomade chef de maquis, antithèse des fermiers sédentaires (les généraux d’Alger).
La poésie de la Saison en enfer des années 1943-1944 est « en avant » (Rimbaud). Incarnée, elle ne doit pas céder au mysticisme. Elle est renaissance après une douloureuse « régression prénatale » : Char ne se prénommait-il pas René ? La poésie est vérité vivante et non soleil dénaturé comme la croix gammée. C’est une « infante » (féminin d’enfant ») en deçà de la parole. Mais elle n’est pas triomphale : elle dit « à voix basse » le langage de la sensation contre l’abstraction, de l’évidence subjective, de l’imagination. Elle irrigue l’action et ouvre l’horizon d’une espérance païenne, tandis que la « fécondité paradoxale de la nuit » prend à rebours les ténèbres hitlériennes. L’ange, ou la Femme du Prisonnier de Georges de La Tour, sont des allégories privilégiées de ce mystère métapoétique : la poésie est au « service énigmatique » de l’homme, non par son hermétisme, mais par l’hommage qu’elle rend au mystère même de sa condition.
Olivier Belin, « La “’voix d’encre”’ de René Char. Poésie et silence dans Fureur et Mystère »
L’article d’Olivier Belin complète celui de Bertrand Marchal par l’étude de la multiplicité des configurations du silence dans Fureur et Mystère. Il montre comment René Char fait « chanter le silence », repense le « mutisme éditorial » du poète et analyse les caractéristiques d’une « poésie asymptotique du silence ».
Le silence est un acte poétique à part entière. La parole doit être laissée un moment en suspens avant d’être relayée par l’action. La poésie de Char est aux antipodes de celle d’Aragon, épopée, « bel canto » ou « carmen ». Si le silence et la « parole entravée » sont constitutifs d’une certaine poésie moderne, chez Char ils témoignent d’une violence consentie pour échapper à la rhétorique et à la gratuité des images. Le silence est résistance contre la propagande nazie, mais aussi contre le bavardage littéraire.
Le « mutisme éditorial » de Char n’a pas été aussi radical que le veut la légende : le poète en 1940 propose à Gallimard une mouture de son premier recueil, qui est refusée, et ce n’est que peu à peu qu’il renonce à toute publication. L’intensification des combats de l’été 1943 n’autorise de toute façon que des notes hâtives, des bribes de parole arrachées par Hypnos, frère jumeau vigilant de Thanatos, à la parole bâillonnée. Les métaphores de l’incendie et du bélier illustrent la « fureur » de la plume.
Le silence a plusieurs visages. Il peut être hébétude, sidération, ou fragmentation de l’écrit dans les Feuillets d’Hypnos. Le mutisme de Saint-Just apprenant sa condamnation à mort est une réappropriation victorieuse de soi par le silence. Le recueillement sacré de l’homme ou de la « renarde », qui communient avec la nature, soulage de l’asphyxie ambiante. La parole murmurante est empreinte de religiosité, comme celle de l’ange, mais sans connotation chrétienne. À l’aurore ou au crépuscule, on croise parfois la silhouette d’une femme-fée, « héritière rurale et provençale de la passante baudelairienne et de la magicienne surréaliste », dont il serait sacrilège de troubler le mutisme recueilli. L’expérience érotique sublime la communion silencieuse avec la nature.
Aucun culte de l’ineffable toutefois dans l’écriture de Char : le silence est le préalable d’une parole authentique, la poésie est le « non encore formulé », le refus de la forme figée. La poésie résistante est « parole inchoative », parole d’enfance, parole émergente. La « voix d’encre » ne parle jamais qu’à « l’asymptote du silence ».
Mais à l’inverse le silence peut être cri, paroxysme et « fureur blanche », « gorge nouée par l’innommable, qui hésite entre le hurlement et le mutisme ». Il est parfois l’intensité visuelle des yeux, seuls capables de crier. Ou au contraire, chez Georges de la Tour, le halo d’une veilleuse intérieure.
Dans tous les cas il est politique et poétique, non pas privation, mais promesse de parole, non pas « absence de langage », mais attente de l’« inconnu de tout langage ». Le mutisme poétique est un art de la guerre conforme aux préceptes de Sun Tzu et des arts martiaux plus qu’à la tradition occidentale de la guerre, malgré le nom de résistance du combattant Char (Alexandre).
Laure Michel, « Obscurité de René Char »
Char s’est toujours défendu du reproche d’hermétisme poétique. Laure Michel préfère d’ailleurs parler d’obscurité plutôt que d’hermétisme, terme réservé à une acception philosophique. Après avoir analysé les particularités d’un contrat de lecture poétique qui présuppose l’obscurité, elle étudie les particularités stylistiques qui en résultent et propose un guide de lecture de la poésie de Char.
La question de l’obscurité ne se posait pas dans les premiers recueils de Char, tant le cercle restreint de ses lecteurs était acquis à l’idée du mystère inhérent à la poésie. Elle ne se manifeste qu’au lendemain de la Résistance, à la lecture de Fureur et Mystère, en même temps que progresse l’idée d’une poésie pour tous (Eluard). L’obscurité de Char ne coïncide pas pour autant avec un hermétisme élitiste à la manière de Mallarmé ou Valéry.
L’inspiration surréaliste est encore perceptible dans Fureur et mystère, mais Char tend à s’en éloigner, prenant congé également de l’agressivité verbale de ses débuts, influencée par Sade. Une poésie de l’échange amoureux apparaît, propice à la communication, bien qu’encore tributaire d’un certain ésotérisme, d’un cryptage amoureux à la manière d’Eluard, et de la tradition du merveilleux de la rencontre. Laure Michel relève la présence dans de nombreux poèmes d’une dimension cosmique, biblique, voire gnostique, d’un désir de déchiffrement du sens caché du monde. Les figures du mystère (l’ange, la passante) sont fréquentes dans les Feuillets d’Hypnos et la thématique des correspondances y est représentée, détournée cependant de sa signification première, car la poésie ne se limite plus à la connaissance, mais prépare l’avenir.
Mais pourquoi traduire par l’obscurité les mystères du monde ? C’est, répond Laure Michel, parce que l’obscurité dévoile en questionnant. Le symbole, le mythe ou l’énigme au cœur de l’activité poétique sont garants d’un sens indéfiniment ouvert.
L’obscurité est également reliée à l’action, car elle combat une autre obscurité : les ténèbres du nazisme. C’est la nuit des maquis, la nuit d’Hypnos, le clair-obscur et la bougie de Georges de la Tour, ennemie du soleil totalitaire des nazis. La nuit recèle tous les possibles, comme le noir des alchimistes.
Si toute poésie par définition cultive les écarts, dans Feuillets d’Hypnos le référent sans cesse affleure, mais ne suffit pas toujours à la clarté des énoncés, perturbée par le choix inattendu des formes ou l’absence d’un référentiel commun à tous les lecteurs.
Laure Michel montre bien que chercher à élucider le sens des nombreuses métaphores et figures énigmatiques, parfois triviales en apparence, parfois déguisées en maximes, mènerait à une impasse. En ce sens, l’obscurité de Char a encore quelque affinité avec le surréalisme. Plus intéressante cependant est la cohérence qui se tisse au gré des mots aimés du poète et de leurs significations spécifiques : l’amande, le torrent, la source, la fontaine, le velours, le givre, etc.
L’obscurité peut venir de la complexité sémantique et syntaxique des poèmes en prose comme de la brièveté des feuillets, des ellipses, des ruptures d’isotopie, des parataxes.
Cette « langue étrangère » nécessite un commentaire patient et ouvert. Mais l’essentiel c’est l’émotion, privilégiée par Char lui-même.
Laure Michel conclut sur la nécessité d’entrer avec confiance dans l’obscurité poétique, de se familiariser avec elle, sans fascination, et de mobiliser l’héritage poétique collectif pour l’apprivoiser.
Anne Gourio, « Le poème en prose, forme de la “’contre-terreur”’ »
Anne Gourio s’est intéressée à la place majeure du poème en prose dans Fureur et Mystère.
Un bref historique de cette forme en fait apparaître le caractère « incertain », symptôme de la crise moderne d’après Valéry. Chez René Char, elle cultive une « exaltante alliance des contraires ».
Après avoir replacé le poème en prose dans la logique d’ensemble de l’œuvre, et de Fureur et mystère en particulier, Anne Gourio tente de qualifier son lyrisme particulier et de comprendre ce qu’il nous dit de l’action.
Force est de constater que le poème en prose, qui s’impose dans la période surréaliste de Char comme débordement onirique, ne prend toute son ampleur qu’à partir de Seuls demeurent, précisément quand le poète s’éloigne du surréalisme. Au contact de la Résistance, il devient plus « massif » et correspond à ce que le poète nomme « le combat de la persévérance ».
Le poème en prose domine dans les sections I et III de Fureur et Mystère, celles de la « compacité résistante » ; la section II (Feuillets d’Hypnos) lui préfère en général le « tranchant » du fragment. C’est pourtant l’analyse détaillée d’un poème en prose de cette section (feuillet 141) et de sa métaphore du vallon ouvert sur l’espoir d’une « contre-terreur », qui conduit Anne Gourio à assimiler la structure même de Fureur et Mystère à un vallon, dont les sections I et III seraient les bords, et les Feuillets d’Hypnos le creux. De cette analyse elle dégage les pistes interprétatives nécessaires à la lecture de l’ensemble des poèmes en prose des sections I-III (l’espace vivifiant et créateur de la contre-terreur contre le précipité étouffant de la menace nazie) et met en évidence une double opposition formelle : prose/vers, poème en prose/aphorisme.
René Char a fait du vers un usage différent selon les époques : lyrique et harmonieux à l’époque surréaliste, il se disloque ensuite et devient heurté. Puis il évolue vers le chant ou la chanson. Dans Fureur et mystère, le poème en prose, hostile au prosaïsme baudelairien, propose un « lyrisme en mineur », qui mélange les procédés traditionnels de la musicalité (refrains, anaphores, scansion, rimes internes, invocations) avec des procédés d’atténuation du lyrisme : ruptures de ton, évocations concrètes de la nature – à l’inverse de l’onirisme surréaliste ou des hideuses métaphores du nazisme. La poésie tend au dépouillement et rejette les « légendes régressives » et le merveilleux. Char privilégie l’espace du sensible, les gestes simples du quotidien, la mémoire individuelle. Ces thématiques s’entrelacent dans les poèmes en prose : dans la section I ce sont la beauté de l’espace naturel, le quotidien, les gestes de l’artisan ; dans la section III, les motifs végétaux, les liens au passé, les éléments, la nuit, les inscriptions dans la pierre.
L’usage atypique de l’imparfait inchoatif exprime les promesses de l’avenir patiemment recherchées dans le passé, dont la résurgence de Fontaine de Vaucluse est le symbole.
Ancré dans l’imaginaire de la terre et de la mémoire, le poème en prose s’organise souvent autour d’un homme ou d’un lieu, et refuse la temporalité du « grand récit national ». La narration en pointillés, les ruptures induisent la présence, l’incantation, l’appel à l’action. Le déréférencement offre au lecteur la possibilité d’une recréation active du monde. En filigrane se tisse un « récit latent », dont la « lampe végétale » ou la chandelle de Georges de la Tour constituent des images séminales véhiculant une « contre-utopie ». À rebours du sens unilatéral que semble imposer l’Histoire se construit dans l’ombre une « résistance souterraine ».
Construits souvent en deux parties autour d’un point de basculement et de ruptures stylistiques, les poèmes en prose qualifient l’action : ils disent le passage d’un état ancien à un nouvel état, tandis que les finales performatives semblent préfigurer la reconquête. Mais la valeur prescriptive propre à l’aphorisme est toujours atténuée : par le flou référentiel, la polyphonie des voix et des énonciations, et le recul recherché par rapport aux événements.
Char indéniablement fuit le style « cocardier » : le poème en prose est allégé malgré la gravité du propos. Les nombreuses occurrences du motif de l’apesanteur traduisent le refus de toute morale édictée, au nom d’une conception nietzschéenne de la liberté. N’obéissant qu’à ses propres règles, cette forme coïncide avec une « morale du soulèvement, de l’autonomie, du dépassement ». Les ressources propres à la poésie y atténuent le sérieux de la sentence, tout en maintenant intacte l’énonciation d’une éthique de la révolte. Hostile à toute résolution des contraires, le poème en prose vit de mystère, d’ambiguïté et d’hybridité.
S’il a marqué l’entrée dans la modernité par refus d’un ordre, ici, paradoxalement, il tend à un équilibre dans le chaos du monde et annonce une contre-terreur « en creux ».
Jean-Michel Maulpoix, « “’Toi nuage passe devant”’. L’écriture résistante de René Char »
Le mot « résistance », terme inaugural dans l’œuvre de Char dès 1927, n’est pas synonyme d ’ « engagement », car le poète voit plus avant que l’intellectuel qui s’exprime sur la scène publique. La poésie est au contraire « dégagement », indépendance et vision d’avenir.
Elle est à la fois « proximité » du réel et « éloignement ». Résister c’est se tenir « à l’écart ». C’est combattre dans les maquis, mais c’est aussi produire une écriture « résistante », difficile d’accès contrairement à celle d’Aragon ou Eluard. Pas de grandiloquence héroïque, pas de lyrisme national.
Les Feuillets d’Hypnos, souvent brefs et fragmentaires, coïncident avec une disponibilité malmenée par les événements. L’épopée, la satire ou le pamphlet, genres traditionnellement consacrés à la guerre, en sont exclus. La poésie, comme l’action combattante, doit trouver ses propres règles. Feuillets d’Hypnos est un art poétique.
Le poème n’est ni plainte, ni consolation, ni « charme », ni divertissement, ni maniérisme, ni quête d’un sacré galvaudé, ni rhétorique gratuite. La poésie est un faire qui, travaillant avec la résistance de la langue, produit des « accès de sens » comparables à des « accès de fièvre », fulgurants, aphoristiques.
L’écriture résistante s’organise autour de trois motifs : l’action, instinctive comme celle de l’animal, du chasseur ou du stratège, la mission en quête de sens, et l’insoumission à tout ordre, politique ou poétique.
Le mot « fureur » reflète la violence dans la guerre et l’écriture. « Furor » en latin désigne la colère, la passion amoureuse, l’inspiration poétique. Chez Char, les trois sont liées, nourricières et destructrices à la fois.
Pour porter cette fureur, les mots se font silex, ils sont « repères éblouissants » ou au contraire rêveurs, obscurs, inquiétants. Lieu d’une expérience resserrée, l’écriture doit être précise et efficace comme les tirs du maquis. Mais elle se déploie aussi en « extension », adoptant toutes les formes et toutes les énonciations possibles. La dureté, les antagonismes, l’insécurité l’emportent. Les métaphores fluides, le lyrisme musical n’y ont pas leur place. Les Feuillets d’Hypnos ce sont des notes rapides, intermittentes comme l’action, ajustées à elle, au plus précis, au plus bref. Parallèlement sont revendiquées, dès le texte liminaire, les plus hautes exigences morales pour l’avenir.
Volontiers injonctive l’écriture énonce les commandements de l’éthique combattante et poétique. Elle s’adresse au lecteur, en signe de fraternité. Elle est sentence, aphorisme métaphorique ou énigme de la pythie. Les métaphores de la combustion ou du passage sont fréquentes. La vitesse, la discontinuité, la condensation, l’explosion inattendue produisent un poème « pulvérisé » – « gerbe d’étincelles » ou « essaim d’abeilles » – qui contraste avec l’écoulement paisible de la Sorgue…
Fureur et Mystère décline plusieurs formes de temporalité. Le temps long de la guerre, dont les cinq grandes sections suivent la chronologie, se conjugue avec des instants saillants, pris dans leur « immédiateté ». La sensibilité du combattant et la grande Histoire se rencontrent. Il y a enfin le temps de la nature, vaste, tenace, tranquille, permanent. La guerre plus que jamais permet aux hommes de communier avec la terre des origines.
L’action poétique instaure un nouveau rapport au monde selon trois instances : « l’attention » opposée au divertissement, le « témoignage » qui laisse des traces et énonce des vérités, enfin « l’avertissement » qui voit loin. Mais le regard visionnaire est haut et large : il refuse la vengeance et les vains honneurs patriotiques.
La poésie de Char est solidaire d’une poignée d’hommes réunis dans un paysage bien localisé du Vaucluse, à la fois champ de bataille et refuge. La nature complice se personnifie et souffre. Le poète préconise un engagement « terrestre », sensoriel et païen malgré sa soif d’infini. La présence silencieuse, pure, précaire est exacerbée par l’idée de la finitude. Les villageois, bergers, artisans, vagabonds, cueilleuses de mimosas, « princes » de la terre, sont les défenseurs d’une nature et d’un monde menacés, et le poète est le « conservateur des infinis visages du vivant ». L’homme qui lutte est double, lucide et souffrant, assoiffé, mais espérant indéfiniment, apte à transformer la défaite en victoire.
J.-M. Maulpoix conclut en commentant l’image du « nuage de résistance », déjà utilisée en 1927, ce nuage de fumée qui va devant, signe d’un feu poétique salvateur. L’écriture, disait Char en 1929, est « de la respiration de noyé », qui se débat dans l’irrespirable, mais dispense l’oxygène régénérateur. Résister est une épreuve qui peut compter sur de solides appuis : le paysage de Provence, ses habitants, les poètes, les philosophes et les peintres, Georges de la Tour et sa Madeleine à la veilleuse. La « présence » poétique est essentielle, incarnation de « la vraie vie » selon Rimbaud. La résistance porte l’idée, « physiquement éprouvée », que cette vie a un sens. C’est à ce titre que Char la déclare « invulnérable ».
Éric Marty, « Hypnos avec Sade »
La figure de Sade, dont Éric Marty cite plusieurs occurrences cryptées, s’invite dès la première page de Fureur et Mystère. Mais l’auteur cherche à l’arracher aux poncifs qui la guettent. Il est vrai que cette référence, lieu commun du XXe siècle, résonne dans Feuillets d’Hypnos comme une provocation, dans le contexte de la barbarie nazie et au regard de l’engagement du poète, décrit en exergue du recueil comme « la résistance d’un humanisme conscient de ses devoirs ».
L’article d ’ Éric Marty consiste essentiellement en une analyse approfondie du feuillet 210, consacré à ce personnage infréquentable, exclu de la poésie de la Résistance et cantonné dans des œuvres à la marge de l’horreur historique, de Bataille et Breton en particulier (1942-1943).
L’allusion au seigneur criminel dans le feuillet 210 prend la forme significative d’une parenthèse, dans laquelle Char se souvient d’un charbonnier affirmant que la Révolution avait purgé la contrée d ’ « un certain Sade » égorgeur de jeunes filles. De son exégèse Éric Marty conclut que le seigneur criminel, deux fois exclu de la région, par la Révolution et par la Résistance, est réintégré par le poète sur le terrain des combats… avec une incontestable empathie ! Magistrale provocation contre la doxa résistante ! Refusant de ne considérer cette réhabilitation que comme le « méchant pied de nez d’un ancien surréaliste », et s’appuyant sur l’étude stylistique d’un « flottement généralisé du sens », Éric Marty analyse cette provocation comme l’implication personnelle de Char dans un procès, instruit contre Sade et contre lui-même, au nom de leur ambiguïté criminelle, exprimée dans la première phrase du feuillet par la métaphore de la « verrue ». Char reprendrait donc à son compte les condamnations portées par les idéologues de le Résistance contre les poètes de la nuit. La confrontation entre le mensonge du charbonnier (Sade n’a pas tué) et la vérité du désir du Marquis, qui suscite l’enthousiasme du poète, permet de faire la lumière sur une vérité plus profonde : le désir sadien n’a pas besoin de crime pour exister. Le charbonnier, d’une « avarice montagnarde » – allusion au dogmatisme de 1791 ? – ignorerait tout de la logique lacanienne du désir « discordantiel » et incarnerait les politologues obtus de l’époque. La sexualité de Sade est interprétée par Éric Marty comme une allégorie de l’écriture, qui permet de dire, en toute innocence, les désirs légitimement reconnus, fussent-ils criminels. Le feuillet 174 semble lui donner raison en prenant le parti du « mal, non dépravé, inspiré, fantasque » contre « l’oppression de cette ignominie dirigée qui s’intitule bien ».
La référence à Sade du feuillet 210 n’est donc pas anecdotique : elle nous conduit, par un travail de mémoire dans l’espace des combats et dans le temps, à contredire le doute émis en début de feuillet sur la validité de l’action. Le flou énonciatif et sémantique de la parenthèse, l’entremêlement du vrai et du faux, du réel et de l’imaginaire, du politique et de l’érotique, créent une rupture qui, dépourvue de volonté dialectique de résolution, produit un nouveau registre de discours « provisoirement sans clôture », déjouant les faux semblants de la fausse ou de la mauvaise conscience, et s’accordant avec le nom de Sade.
Dans cet article comme dans l’ensemble du dossier, ce sont des analyses textuelles très précises et détaillées qui mettent à jour les répercussions concrètes de la guerre sur une écriture en affinité avec la stratégie des maquis. Les mises à distance énonciatives, formelles (le poème en prose) et figurales (le personnage de Sade) témoignent d’un désaccord avec toute poésie dogmatique de la Résistance. Obscurité, silence, suspension du verbe, travail souterrain d’une parole opprimée, paradoxale et ouverte, en constituent les éléments tactiques. La fureur et le mystère sont les attributs d’Hypnos, divinité héraclitéenne du feu et de l’énergie créatrice, mais aussi de la nuit protectrice, promesse de Renaissance contre les ténèbres.
ANALYSE
Yasmina Sévigny-Côté, « Narrativité et réécriture de l’Histoire dans le roman La Case du commandeur d’Édouard Glissant »
Dans La Case du commandeur Édouard Glissant a mis le récit de fiction au service d’une réécriture de l’histoire antillaise. Il est évident, dès l’incipit, que le véritable narrateur c’est le peuple – corps divisé à l’image du territoire insulaire des Antilles – dont la dispersion a causé une perte de la mémoire, qui se reconstitue peu à peu au fil d’une narration éclatée. Pour dégager la spécificité de « l’acte de synthèse » qu’accomplit le roman aux prises avec « l’hétérogène », Yasmina Sévigny-Côté se réfère aux analyses de Paul Ricœur dans Temps et récit.
La première étape de « l’acte de synthèse » se nomme chez le philosophe « préfiguration de l’expérience temporelle du sujet », c’est-à-dire expérience du temps dans son obscurité et son hétérogénéité. La narrativité discursive, sorte de mosaïque, permet de figurer l’oubli. Une multiplicité d’histoires relate une multiplicité de destinées, à des époques et dans des lieux divers, avec des retours et des similitudes qui disent une amorce de cohérence. La première partie tente de remonter le cours de quatre générations, jusqu’aux débuts de l’esclavage, mais la mémoire défaillante ne trouve pas toujours les mots pour exprimer la douleur. Un cri irrationnel y supplée, proféré dès l’incipit, « Odono », qui scande le récit.
Le roman s’interrompt à la « Mitan du temps » pour commenter sa propre expérience et tenter d’en défaire l’opacité obsédante.
La seconde partie est constituée de bribes de passé remontant peu à peu à la conscience. On saute de l’une à l’autre, « sur le mode de l’étoilement ». Des souvenirs ressurgissent, témoins d’une Histoire omise par les manuels scolaires.
Pour déjouer l’amnésie collective et traquer le passé occulté, la narration se mue en fouille archéologique. La troisième partie est consacrée à Marie Celat, en quête obstinée du vent furieux charrié par la traite. Avide de « traces », la recherche progresse dans l’espace géographique, les époques, les générations, au rythme des contes et légendes des Antilles. Cette nouvelle Histoire est racontée par une polyphonie de voix, dont celle du narrateur. La rage des questions explique l’abondance des formes hypothétiques. L’adresse du narrateur au lecteur, commentant la narration en train de se faire, produit un métatexte.
Une configuration singulière de l’Histoire se dessine alors, deuxième étape du processus défini par Ricœur, grâce à la « mise en intrigue » qui synthétise l’expérience du sujet par des récits enchâssés et une mise en abyme d ’ « histoires cassées », dont la voix collective reconstitue les morceaux.
La Case du commandeur a choisi la subjectivité sensible contre la prétention d’objectivité de l’Histoire mensongère des colonisateurs. Le désordre de la mémoire orale, imaginante et multiple, s’oppose à l’Histoire officielle écrite et ordonnée. Seule la poétisation de la langue, dont Yasmina Savigny-Côté étudie en détail les figures, permet en effet de dire le traumatisme.
Le peuple pourra désormais se reconnaître dans le récit fondateur qui émerge, autorisant les projections individuelles vers l’avenir. La reconfiguration collective, qui fait intervenir le lecteur, constitue la dernière étape du processus de synthèse défini par Ricœur. « Toute l’histoire de la souffrance crie vengeance et appelle récit ».
ENTRETIEN
Xu Jun (Université de Zhejiang), « L’aventure poétique : un dialogue avec J.M.G. Le Clézio sur la création littéraire »
Lors de l’un de ses séjours à l’Université de Nanjing (2015-2016), Le Clézio eut l’occasion de s’entretenir avec Xu Jun, et de revisiter avec lui l’ensemble de son parcours.
L’entretien s’ouvre sur l’évocation de la grande rupture existentielle des années 1980 qui éloigna momentanément l’écrivain de l’écriture pour le rapprocher d’un peuple de la forêt. Cette rupture coïncidait avec une prise de distance vis-à-vis du « nouveau roman » et des jeux formels de l’avant-garde – hormis les audaces antiacadémiques des Anglo-saxons, Joyce, Dos Passos, Kerouac, Ginsberg ou Pound – et avec un retour à la simplicité du conte, de la nouvelle et du roman, à une écriture en quête d’immédiateté « cratyléenne », en harmonie avec la richesse des mythes panaméens.
Le Clézio évoque l’Ancien Monde de l’encre et du papier et la croyance mallarméenne en un Livre absolu, entretenue par une lignée d’écrivains qui voulaient concilier l’héritage occidental avec la pensée zen, comme le fit aussi Michaux, aventurier du silence et admirateur de la peinture orientale et de sa poésie du vide.
Le Clézio naquit donc à la littérature entre les obsessions langagières des avant-gardes et le silence de John Cage, dont il put approfondir l’expérience auprès des Amérindiens, loin de la cacophonie du web. A partir de ce moment son écriture fut essentiellement en recherche d’équilibre. L’oralité y joue un très grand rôle, ainsi que la polyphonie linguistique et culturelle, en résonance avec celle des modernes, Pound, Joyce ou Sarraute. La littérature, singulière et riche en même temps de toutes les influences du monde, est une contribution à l’Histoire non officielle de l’humanité, inscrite dans le sillage de ceux que les Chinois appellent les « Grands Maîtres ». Comme Édouard Glissant, Le Clézio récuse les hiérarchies culturelles au nom d’une œuvre ouverte, poétique, préexistant à toute forme, et politique, au sens large du terme.
Le mélange des genres cher à l’écrivain est-il quête d’absolu, de déconstruction, d’un dialogisme à la façon de Bakhtine, d’un métissage stylistique ? Aux questions de Xu Jun Le Clézio répond qu’il a toujours refusé les cloisonnements, comme l’avaient fait la littérature expérimentale et le cinéma, jusqu’à l’excès. Mais c’est la mondialisation qui a mis fin aux débats d’autorité : tout est permis aujourd’hui dans le roman, qui évolue avec les techniques et les réseaux. La multiplicité des voix est la grande richesse du monde contemporain, dont ce « genre bâtard » participe. Mais peut-être ne sera-t-il pas éternel ? Le roman traditionnel anglo-saxon semble pourtant bien s’accorder avec les contraintes de la « mondialisation »…
À ce stade du dialogue, Xu Jun interroge la place des arts dans l’œuvre de Le Clézio, qui explique que son écriture est passée de l’expression imagée (graphiques, symboles, dessins) à une plus grande intériorisation. Le romancier, contrairement au poète qui vise la perfection, est un « bricoleur », et le roman est toujours imparfait, inachevé. Le temps est fini de la « culture de bronze », détrônée par la « culture de l’éphémère », du document malléable, de la consommation et de l’oubli. Et ces deux cultures sont « irréconciliables »… Le livre total c’est la toile ; à la littérature il reste la paille, les bribes, le glanage, les rêves perdus, les synesthésies, la sensation du vivre.
Quand Xu Jun sollicite des précisions sur les dessins qu’on voit dans ses œuvres (dessins sur la peau, constellations, dessins d’enfants) et sur le paysage urbain qu’il affectionne, quasi cubiste, Le Clézio répond qu’écrire et dessiner ont toujours été une même chose depuis un certain dessin de son enfance, premier témoin de son amour de l’écriture. Souvent encore il dessine des carnets pour écrire, parfois inclus dans ses récits. La poésie c’est regarder et dessiner une montagne, jusqu’à devenir soi-même montagne, comme l’enseigne la littérature des Tang. Le Clézio apprécie la peinture orientale plus que la peinture occidentale – avec des exceptions comme le cubisme – souvent individualiste, marchande, peu sensible au vide.
La littérature a des points communs avec toutes les musiques du monde. Le « rythme » est essentiel, rythme du cœur et des cycles de la nature, du cosmos, de la lune, du féminin. L’écrivain décrit l’émotion qu’il ressentait à écouter sa mère pianiste, imaginant dans sa musique de magnifiques histoires. Au lycée il inventa la « polyphonie sympoétique », sorte de poème simultané à plusieurs voix, dont il transposa les recherches dans le roman.
Le Clézio raconte enfin son apprentissage, dès l’enfance, grâce à un écran improvisé et à des petites bobines bricolées avec des bouts de pellicule, de « la grammaire du cinéma », de ses techniques, de son regard spécifique, et de ses ambiances, qui lui furent très précieuses pour apprendre l’écriture. Mais le cinéma c’est aussi l’intimité magique de la salle obscure, semblable à la complicité laborieuse qui se noue avec un lecteur de roman, très éloignée de l’« incantation collective » propre à la poésie ou au théâtre. Revenant sur le terrorisme intellectuel de sa jeunesse, Le Clézio dit avoir préféré la liberté jubilatoire de Salinger, de Godard et de la nouvelle vague. La « caméra-stylo » c’était la spontanéité, la liberté touche à tout, à l’époque du premier maoïsme, du bouddhisme zen, et de sa découverte de Michaux et Lautréamont. À ses débuts, il s’immergea dans les grands cinémas américain et japonais, Ozu notamment, et cofonda même une revue, Pyramide. Cette époque d’écriture et de cinéma mêlés fut celle de la parution de grandes œuvres : Géants, L’Inconnu sur la terre, La Guerre.
Simon Levesque, « L’écriture sismographique de J.M.G. Le Clézio (1963-1975) : vers une politique leclézienne de la littérature »
Simon Levesque analyse la dimension indexicale (ou indicielle) de la langue de Le Clézio entre 1963 et 1975, corrélée avec la question politique. Son approche n’est pas une étude sociologique du positionnement de l’écrivain, mais un repérage, dans son discours, d’une théorie de « l’écriture-action ». L’auteur s’appuie notamment sur un de ses articles, « Le sismographe » (1970), véritable manifeste pour une écriture réaliste à visée éthique, fondée sur un langage en adéquation avec le monde.
La référence au sismographe vient de Michaux, qui, comme Le Clézio, rêvait d’une langue non circonscrite à la seule fonction de communication. Tous deux traquaient, au cœur même du langage commun, une langue archaïque oubliée, non utilitaire, dans laquelle les mots fusionnaient avec le monde, une langue qui était danse, nage, vol, mouvement. L’extase matérielle (1967) de Le Clézio considérait cette langue comme « un être en soi », tandis que la « poiesis » de Michaux participait de la création divine du monde. De telles conceptions allaient bien sûr à l’encontre de la sémiologie saussurienne et du structuralisme des années 1960, notamment de la théorie de l’arbitraire du signe, qui rendait impossible toute idée de continuité, et a fortiori d’unité, entre la langue et le monde.
Dans la langue poétique, les mots, par leur présence matérielle, sont la réalité des choses. Ils ne s’adressent pas à l’intellect, mais aux sens. Faits de chair, de sang et d’affects, ils s’enracinent dans « l’ethos ». L’écriture poétique n’a plus dès lors de fonction de représentation, elle est « indexicale » : elle agit dans le monde, elle est un « acte moral ». L’introduction au Procès-verbal (1963) plaidait déjà pour un « roman effectif », qui agirait physiquement sur le lecteur et l’obligerait à adopter un regard nouveau, une vie plus intense, plus consciente.
L’écriture ainsi conçue est un « réalisme » de l’en deçà des mots, fruit d’un travail ardu comme le réalisme prôné par Lukacs. Car la réalité n’est jamais donnée… comme l’atteste l’obscurité des premiers écrits de Le Clézio.
La main qui écrit est le sismographe enregistreur des « tremblements » du monde, depuis le séisme originel de la création, et l’écriture n’en est que « le signal ». L’écrivain allume un « filament de tungstène qui vient de loin, va ailleurs ». C’est le langage de la forêt ou de la « poésie libérée », de Rimbaud, Artaud, Lautréamont…
Mais l’écriture, comme la Révolution, est aussi fondation d’une communauté nouvelle, adhésion aux rites collectifs. Elle est semblable au chant rituel des sorciers du Mexique et du Panama où Le Clézio a séjourné. C’est une incantation, parfois à la limite du lisible, et une « médecine ».
Le sismographe est la métaphore d’une « écriture morale », d’un réalisme actif en adéquation avec le monde, d’une poésie indexicale qui traverse le corps de l’écrivain pour transmettre les vibrations du monde à un lecteur bouleversé. Rites et mythes peuvent alors circuler librement parmi les hommes.
Yasmina Sévigny-Côté, Le Clézio et Simon Levesque ont proposé une analyse de l’écriture traversée par les souffles du monde, poétiques et politiques, et par des expériences existentielles, personnelles et collectives, qui agissent sur elle et la transforment. C’est à ce titre qu’ils ont toute leur place dans ce numéro des Études littéraires consacré à la poésie résistante de René Char.